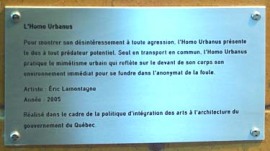L'art public : études de cas
Le blog des étudiants du cours FAM4500 (UQAM)Temple, Damien Hirst, de Philippe C. Lefebvre
L’oeuvre publique qui sera ici analysée, s’appelle Temple. C’est une sculpture, fait en bronze peint, éditée 1 de 3 et signée Damien Hirst. L’œuvre, datée 2008, s’est retrouvée cet été à Kiev, en Ukraine, dans la cour extérieure du PinchukArtCentre. Temple est une sculpture mesurant 260 pouces de haut et d’une largeur de 130 par 78 pouces de profond. L’œuvre prend place au milieu de centres commerciaux et des restaurants. Celle-ci était temporairement installée, faisant partie de l’exposition Requiem (Retrospective de Damien Hisrt, Kiev, 2009). Elle était en relation avec l’art publique et la sphère sociale. À travers cette œuvre, une problématique se présente : De quelle manière, l’œuvre Temple, de Damien Hirst, tisse des liens entre le monde de la science et celui de la culture? L’analyse se penchera sur la façon dont Hirst fait acte d’appropriation, de pastiche et d’indécidabilité, à travers son œuvre. Cette Sculpture sera décomposée sous son aspect de création, de diffusion et de réception. Une interprétation répondant à la question énoncée plus haut viendra conclure ce résumé.
À travers la création de l’œuvre, Hirst s’approprie le champ visuel des sciences médicales, en particulier, les schémas du corps anatomique. La référence au modèle anatomique humain est directe et presque exhaustive, si ce n’est que du changement d’échelle effectué. L’œuvre se situe autour des notions de transdisciplinarité et d’interdisciplinarité. Interdisciplinaire, car pour créer sa sculpture, l’artiste s’inspire des méthodes de représentation de la science et de la biologie. Elle est aussi transdisciplinaire, car elle se retrouve entre l’art et la science. Temple utilise le langage plastique des arts et le champ visuel de la science anatomique. La diffusion s’effectue grâce à l’esthétique sous la forme d’une simulation. Tout d’abord, l’œuvre utilise un code propre à l’établissement et au musée d’art. Hirst apporte un soin particulier à sa sculpture, en la présentant sur un socle noir brillant. Celle-ci, représenté par un homme tronqué sous l’entre jambes, ainsi qu’une absence de bras, pastiche la sculpture de personnages classiques. Ensuite, la simulation de l’objet éducatif, visant à nous apprendre les parties du corps, fonctionne, puisque l’œuvre ne renvoie pas à autre chose que cela. Alors, lorsque le public se trouve en contact avec l’œuvre, il comprend tout de suite ce qui est représenté. L’œuvre n’éduque pas, mais utilise plutôt l’iconographie de la biologie humaine comme sujet d’étude. En ce qui concerne son emplacement, l’artiste a choisi d’installer sa sculpture à côté d’un centre commercial brouillant, de cette façon, le sens de l’oeuvre. Le public peut se questionner sur le statut de celle-ci, hésitant entre un act de promotion publicitaire sur la santé ou une œuvre d’art dans un espace extérieur. Cette dualité joue sur des notions de vie, de mort, de santé, montrant l’être humain sous un angle de fragilité, mais en même temps, le représentant tout puissant. Une indécidabilité intervient, quant à savoir, si l’objet qui appartient à la science, où au monde le l’art.
L’artiste effectue un détournement quant au rôle d’éducatif de l’objet initial, pour modifier le regard que l’humain pose sur ces schémas anatomiques. À l’aide de stratégie, comme le changement d’échelle, le pastiche et l’appropriation faite par l’artiste, le spectateur est amené à se question sur la relation entre l’art et la science. Damien Hirst est un artiste interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, car il crée un art indéterminable, se situant à la limite de l’éthique morale, avec des œuvres plus audacieuses, telles que ses animaux morts, immergés dans le formole.
Bibliographie
Victor Pinchuk, Eckhard Schneider, Michael Bracewell, Damien Hirst – Requiem, Ukraine, Other Criteria/PinchuckArtCentre, 2009, 183 pages
Basarab Nicolescu, Encyclopédie de l’agora, http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Transdisciplinarite, visité le 12 octobre 2009
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst, visité le 13 octobre 2009
Michael Bracewell, Eckhard Schneider, PinchukArtCentre, http://pinchukartcentre.org/en/exhibitions/past/8826, visité le 13 octobre 2009
ESPACE VERT de Roberto Pellegrinuzzi par Carolyne Scenna
Les programmes d’art public entreprennent d’intégrer de plus en plus la photographie dans le paysage urbain. D’ambitieux projets comme celui de Nicolas Baier qui couvre une vaste partie de la façade du pavillon d’arts et sciences de l’Université Concordia existent au moyen du programme du 1%. Dans la collection d’art public de la Ville de Montréal, une seule œuvre photographique apparaît dans leur index rassemblant plus de 300 œuvres : Espace vert (2006) de Roberto Pellegrinuzzi, située à l’entrée du centre intergénérationnel d’Outremont (999, av. McEachran). Il s’agit d’un boitier lumineux d’aluminium d’environ 4 m par 2 m, dont l’éclairage est programmé et visible recto-verso. À l’intérieur du boîtier, deux images sont superposées, l’une représente une forêt et l’autre de jeunes pousses florales. Elles créent ensemble un effet de fondu enchainé entre les plans. Si la Ville de Montréal n’a pas montré une réelle volonté à inscrire la photographie dans sa collection avant la mise en place d’Espace vert en 2006, c’est parce que la matérialité fragile de la photographie apparaissait incompatible à l’intégration publique extérieure. Or, de quelle manière l’œuvre de Pellegrinuzzi est-elle parvenue à sortir de cette préconception pour prendre la place qu’elle occupe aujourd’hui dans la collection de la Ville de Montréal? Nous étudierons la question sous les aspects de la diffusion et de la réception de l’œuvre.
La proposition de Pellegrinuzzi a été retenue par le jury de sélection du concours sur invitation à l’intention des artistes professionnels en arts visuels dans le but de doter le parc Pierre-Elliot-Trudeau d’une œuvre d’art public, située dans l’environnement immédiat du Centre communautaire intergénérationnel d’Outremont. Le lieu en question est voué aux activités sportives, communautaires et culturelles de l’arrondissement : « L’établissement se veut un carrefour de rencontre des générations et d’horizons culturels distincts tout en favorisant l’interaction entre les différentes fonctions du lieu. »[1]
L’œuvre faisant partie intégrante de l’architecture, sa conservation n’incombe pas autant au propriétaire que s’il s’agissait d’une œuvre photographique imprimée sur papier. En effet les images sont imprimées sur verre, ce qui rend l’œuvre d’autant plus durable. L’entretien est le même que pour celui d’un panneau d’affichage publicitaire ou d’une vitrine de montre. Une attention supplémentaire, – à l’inverse, par exemple, d’une sculpture -, doit probablement être apportée pour veiller à ce que l’éclairage programmé perdure.
Selon Suzanne Paquet dans un numéro de la revue Ciel Variable consacré à la photographie dans l’espace public, « la photographie est un média public, possiblement le plus public de tous, le modèle et la source de tous les moyens de communication de masse »[2] Ici, avec la mise en place permanente d’une photographie d’art dans la ville déjà saturée d’images photographiques de toutes sortes, il s’agit de cohabitation et de vocation sociale. Il y a dans Espace vert l’expression du passage du temps rappelant de toute évidence la vocation de l’établissement l’intégrant, soit la rencontre des générations. Pellegrinuzzi fait le lien entre la nature et la fonction l’établissement, il crée une métaphore de la nature en devenir (la pousse) et la nature assumée (la forêt). La boîte lumineuse en forme d’écran fait surgir au cœur d’un espace bétonné un espace virtuel de nature, un « espace vert », et fait ainsi le pont entre l’environnement urbain et le parc avoisinant. De plus, l’image change de couleur au gré du temps et des saisons, comme un tableau animé, et interagit avec la profondeur de champ, la transparence et notre propre mouvement, modifiant continuellement notre vision. Dans cette perspective, l’œuvre et le lieu s’échangent une vision de mouvance, d’un monde fourmillant et varié, en perpétuel changement. La vocation sociale de l’image photographique possède cette force de « se démarquer comme une forme d’art qui peut tenir compte de ce contexte particulier. »[3]
De toutes les disciplines, la photographie est l’une des seules qui entretient un rapport aussi privilégié au réel. Le public reconnait les éléments de l’œuvre a priori de la connaissance de la démarche artistique qu’elle suggère. De plus, Espace vert de Roberto Pellegrinuzzi nous confirme que les œuvres photographiques dans l’espace public extérieur se sont affranchies de leur réputation de précarité. Avec la technologie et la diversité disciplinaire le permettant, la photographie s’assure une place incontestablement progressive dans les programmes d’art public.
[1] Mona Hakim (dans le dépliant explicatif)
[2] Paquet, Suzanne, « La ville, d’ores et déjà photographique… », CV art photo médias culture, n°82,
Canada, trimestre été 2009, p.38
[3] Bouchard, Stéphane, « La photographie : trop fragile pour le patrimoine? », CV art photo médias culture,
n°82, Canada, trimestre été 2009, p.55
Alain Paiement, Mosaïque fluide; Expansion. Gabriel L. Savage
L’UQÀM possède plusieurs oeuvres d’art publique à même sa structure, dans ses pavillons et sur son campus. Parmi elles, une des plus récentes, Mosaïque fluide et Expansion, créée en 2005, est l’oeuvre d’Alain Paiement, photographe bien connu du milieu artistique québécois. Elle est située au pavillon des sciences biologiques de l’UQÀM, un pavillon construit récemment, au design innovateur et à l’accès restreint. L’oeuvre peut se lire en deux temps: au rez de chaussé, on peut observer Mosaïque fluide, et au niveau métro, l’autre moitier de l’oeuvre, soit Expansion. L’oeuvre en deux temps est en fait une composition photographique de grande envergure représentant des bulles de savon, seules ou groupées, dans des prises de vues macro. L’oeuvre, à caractère intermédiatique, intègre des notions propre au langage de la photographie et suggère une parentée à la science. De quelle manière l’oeuvre Mosaïque fluide et Expansion d’Alain Paiement dresse-t-elle un parallèle en l’art et la science? Nous étudierons l’oeuvre Mosaïque fluide et Expansion sous les aspects de la création, la diffusion et la réception.
L’oeuvre Mosaïque fluide et Expansions présente un univers de bulles de savons photographiées sur un fond sans détail, uniforme. Mosaïque fluide est un univers chargée, une structure complexe et détaillée, tandis que Expansion est une juxtaposition espacée de bulles seules ou en petits groupes, sur un fond bleu uni qui annule toute perception de l’espace ou de profondeur de champ. Il s’agît d’impressions à jet d’encre sur supports en polyester montées sous acrylique de grande dimensions, installées sur de long murs, contribuant ainsi à l’immersion du spectateur dans l’oeuvre. Le résultat final est extrêmement propre et asceptisé, ce qui accentue la relation avec l’établissement, d’une grande propreté.
La thématique est en deux temps. D’un côté, l’oeuvre propose un macro d’un univers difficilement visible à l’œil qui permet de comprendre la structure, le système des bulles et de la mousse, son expansion à la fois ordonnée et chaotique. Paiement nous oriente vers l’univers de la science, des expériences. On note aussi qu’en physique, on étudie les lois de l’optique qui régissent notre perception de la lumière, les réfractions, la courbure des lentilles, etc. Ceci en lien avec des notions à caractère photographique, puisque la photographie est avant tout un exercice complexe scientifique pour capter la lumière et l’imprimer sur pellicule ou l’enregistrer numériquement. L’artiste est le concepteur et le créateur de l’oeuvre dans son intégralité et aberration optique trace un parallèle entre le geste artistique et le phénomène scientifique de l’optique. Il devient donc entremetteur en quelque sorte puisqu’il y a mise en abîme lorsqu’on y retrouve la présence du photographe en hors champs dans la réflexion des bulles: Elles réfléchissent leur environnement lors de la prise de vue, incluant parfois la lentille de la caméra et l’artiste. L’oeuvre est donc en deux temps une réflexion de son environnement original de création ainsi que référence au contexte scientifique dans laquelle elle se trouve.
L’oeuvre Mosaïque fluide et Expansion, d’Alain Paiement, est selon moi un exercice habile de mise en relation entre des notions artistique propre à la photographie, tels que le hors-champs, la profondeur de champs, la réfraction, la perspective, etc. ainsi qu’à des idées et de l’imagerie scientifique tels que les cultures bactériennes, les schémas cellulaires, la physique optique, etc.
Les Clochards célestes, de Pierre Yves Angers, par Janie Belcourt
Les grands centres urbains ont inévitablement chacun leur lot de problématiques sociales. Montréal s’inscrit en lice avec, entre autres, l’enjeu considérable que comporte le phénomène d’itinérance. L’artiste Pierre Yves Angers propose un temps de recueillement au Parc Miville-Couture, à l’angle des rues Amherst et René-Lévesque, avec l’œuvre Les Clochards célestes, une imposante sculpture de béton et de fer de 6,4 mètres de hauteur complètement peinte en blanc. Offert à la ville en 1983 en hommage et à l’effigie de la mission de la Maison du Père, établissement de réinsertion sociale des itinérants, ce monument statuaire met en scène trois personnages. Les deux premiers, en station debout, pointent le ciel d’un bras levé tout en enlaçant la troisième figure, qui jonche au sol en position assise. De quelle manière Les Clochards célestes tentent-ils d’influencer le spectateur lors de son passage au parc? Les notions de citation, de mise en abîme et de diffusion y jouent un rôle déterminant.
En premier lieu, la réalité de l’itinérance est représentée en citant le célèbre ouvrage littéraire Les Clochards célestes[1], du prolifique écrivain américain Jack Kerouac. Dans son roman, l’auteur narre la vie errante et le parcours insensé de quelques beatniks et poètes libertins dans un cadre de valeurs d’espoir et de liberté. Pierre Yves Angers s’approprie cette vision et dépeint les sans-abris comme de grands voyageurs en guerre contre les conventions. L’artiste sculpteur réinvestit donc l’idée de Kerouac en passant de la textualité à une représentation schématique tridimensionnelle, en quittant l’imaginaire narratif pour investir un espace réel. L’emphase n’est donc plus désormais mise sur l’histoire des personnages, mais sur leur état d’être. Le blanc de l’œuvre accorde en effet aux trois individus un statut d’ange, alors que ses matériaux lourds et bruts illustrent la difficulté de bouger, d’évoluer, de prendre leur envol. La position des figures ainsi que leur dialogue physique témoignent de la foi en l’amélioration par l’entraide. La sculpture Les Clochards célestes de Pierre Yves Angers reprend les valeurs catholiques évoquées dans le roman de Kerouac de façon fort pertinente, puisque l’œuvre souligne le dessein de la Maison du Père, un établissement à vocation religieuse.
En second lieu, la diffusion de l’œuvre donne à celle-ci toute son importance et tout son sens. Dressée au Parc Miville-Couture, dans le quartier Ville-Marie au centre-ville de Montréal, la proposition de Pierre Yves Angers détonne du paysage visuel. Géante de par ses 6,4 mètres de hauteur, lumineuse de par sa blancheur éclatante, elle trône sur la pelouse parmi les arbres, les lampadaires, les bancs et les sentiers. Son intégration dans ce lieu public et urbain lui confère une visibilité inévitable. Piétons comme automobilistes ne peuvent que difficilement ne pas remarquer Les Clochards célestes. L’impact majeur au niveau du lieu de diffusion de l’œuvre s’avère être cette quasi-absence de choix pour les passants de l’ignorer. Contrairement aux réels sans-abris dont on dénie souvent l’existence, les trois immenses clochards de béton apostrophent les spectateurs et les obligent à lever les yeux vers eux. L’expérience de la sculpture se fait dans un environnement associé inéluctablement à l’itinérance. C’est pourquoi, certes surdimensionnée, elle s’intègre bien au contexte physique de par le sujet qu’elle exprime.
En troisième lieu, la mise en abîme semble omniprésente dans le discours qu’entretiennent l’œuvre et le parc urbain. En effet, la sculpture fait référence aux itinérants cloués sur place parmi la foule qui déambule dans un lieu public. Les Clochards célestes peuvent ainsi donner l’impression de poser comme des personnages dans une mise en scène réelle, dans un espace en mouvement qui leur est propre. Ce dialogue amène l’observateur à questionner le phénomène de l’itinérance sous l’aspect d’une réalité immuable propre à la ville qui l’entoure et dont il fait lui-même partie.
En conclusion, l’œuvre d’art publique Les Clochards célestes s’inscrit dans une démarche à caractère social et tente d’influencer le spectateur par ses moyens de représentation et sa relation avec son lieu d’investissement. Pierre Yves Anger propose un temps d’arrêt pour porter une réflexion sur l’ampleur de la problématique de l’itinérance ainsi que sur l’importance de l’entraide dans une société inégale. En dépeignant ses clochards géants comme des créatures divines, l’artiste avance une perception remplie de poésie, de positivisme et d’espoir. Si la sculpture était non-titrée, pourrait-on parler de pluralité des lectures? Chaque spectateur y verrait-il des références autres que celles de l’itinérance? Et qu’arriverait-il si cette même œuvre, dorénavant non-titrée, prenait place dans un lieu totalement différent? Dans une cours d’école? Dans un champ en pleine campagne? Dans un parc d’attraction?
[1] KEROUAC, Jack, Les Clochards célestes, France, Gallimard, 1957, 373 p.
Révolutions, Michel de Brouin par Sabrina Desmarteau
Michel de Brouin, Révolutions, 2003, Aluminium, Parc Maisonneuve-Cartier
/ Station de métro Papineau. ( photographie de Michel E. Tremblay )
C’est par le biais d’un projet d’aménagement par la ville de Montréal, en collaboration avec la STM que Révolutions fera son entrée dans le parc Maisonneuve-Cartier à proximité du métro Papineau. À la fois sculpturale et architecturale cette installation se veut une œuvre interdisciplinaire prenant la forme d’un escalier en tourbillon. Mesurant huit mètres de haut, l’œuvre de l’artiste Michel de Brouin, réalisée en aluminium en 2003 se dit être le résultat d’une étude portant sur la métropole. En quoi les fonctions et les significations associées au travail de Révolutions ont un lien direct avec l’identité du paysage montréalais? Cette question sera traitée sous trois aspects différents, ceux de la diffusion, de la mise en abîme et de la pastiche.
Diffusion :
S’ajoutant à la collection d’œuvres d’art public de la ville de Montréal, Révolutions à sa place dans un parc public en bordure du boulevard de Maisonneuve. C’est au moyen de son emplacement que l’ensemble des éléments entourant l’œuvre répond avec l’identité du paysage montréalais en utilisant trois symboles de la métropole. En premier lieu, cette forme aux courbes vertigineuses est identifiable à celles des manèges de la Ronde. En deuxième lieu, cet écheveau de marches rappelle les escaliers mécaniques du métro. En troisième lieu, cette même forme résonne avec les structures de métal du pont Jacques-Cartier. Révolutions possèdent elle-même des structures de métal qui de par son choix de confection en aluminium marin, permet à l’œuvre un alliage possédant une forte résistance à la corrosion et une solidité supérieure aux alliages standards. Une sculpture d’art public vivant à l’extérieur exige certaines mesures quant à la conservation de l’oeuvre pour la maintenir en bon état. Aussi, étant visité par un grand nombre de personnes chaque jour, la confection d’ Évolutions se doit d’être résistante et par conséquent, sécuritaire.
Mise en abîme :
Dans une pratique dans laquelle la sculpture apprivoise l’architecture, Évolutions incruste une image en elle-même de l’escalier extérieur courbe, qui marque l’identité montréalaise. De manière à représenter de façon générale le procédé traditionnel à la réalisation de ce type
d’escalier, Michel de Brouin utilise la forme du limon qui sera d’abord découpée pour être courbée. Cette mise en abîme de l’escalier agit comme composante achitechturale typique du paysage urbain montréalais.
Pastiche :
S’appartenant aux formes de Escher, Révolutions suggère une pastiche. Ressemblant aux formes impossibles de l’anneau de Moebius, Michel de Brouin nous offre à son tour un jeu de trompe-l’œil. Ce qui nous fait souvenir que tout ce qui monte redescend, au rythme des transformations. Le paysage montréalais est sujet à de multiples transformations décrivant cette idée. La métropole est en développement, certains bâtiments sont détruit pour laisser la place à d’autres, symbole de la révolution. Ici le terme révolution évoque deux significations. En premier lieu, il indique la rotation d’un corps dans cet espace fictif qu’a créé l’artiste. En un deuxième lieu, le terme révolution évoque l’avènement de changements dans notre environnement tel que l’aménagement de ce projet artistique dans le parc Maisonneuve-Cartier.
En mettant l’accent sur les similitudes des formes présentent dans l’œuvre et dans la métropole, Révolutions résonne de l’architecture de Montréal, faisant naître un faisceau d’associations qui inspirent les spectateurs à l’identité montréalaise. Si l’oeuvre Révolutions de Michel de Brouin se trouvait dans une autre ville, de quelle manière percevrait-on l’oeuvre différemment?
Notice bibliographie :
Livre :
De Blois, Nathalie, Michel de Brouin, Canada, ABC livres d’art Canada, 2006
Articles de périodique :
Labelle, Guillaume, «DESIGN PAR RELATIONS Pratiques informatiques de la géométrie»,
ARQ Cahier de la jeune arcjitecture, No 137, nov. 2006, p. 30-40
Uzel, Jean-Philippe, «Michel de Brouin : l’éclaireur éclairé», Espace, No 60, été 2002, p. 40-
41
Site Internet :
Lamarche, Bernard, le Devoir.com, http://www.ledevoir.com/2002/12/31/17378.html, visité le
12 octobre 2009
Rocher, Claire, INFO STM, http://www.stm.info/info/infostm/2003/030912.pdf , visité le 12
octobre 2009
Maurits Cornelis Escher, L’anneau de Moebius, 1963, Gravure sur bois de
bout rouge, noir et vert sur papier japon vergé.
VOILES de Jean-Jacques Besner, par Thierry Labonté
Jean-Jacques Besner, Voile I et Voile II, 1990, Montréal-Nord
Acier inoxydable, éléments cinétiques (avant restauration)
Longueur 2,74 mètres x hauteur 4,88 mètres (chacune)
Les œuvres choisies, Voile I et Voile II, sont des sculptures cinétiques en acier inoxydable de l’artiste québécois Jean-Jacques Besner. Elles font partie de la collection d’art public de la Ville de Montréal. On peut les voir au parc Albert-Brosseau de Montréal-Nord, à l’angle des rues Albert-Brosseau et Drapeau, sur les berges de la rivière des Prairies.
Avant tout, un mot sur l’artiste vaudreuillois Jean-Jacques Besner (1919-1993). Diplômé de l’Université de Montréal, il a enseigné les mathématiques avant d’œuvrer comme concepteur industriel. Il a d’ailleurs dirigé le pavillon L’Homme à l’œuvre lors de l’Expo 67. Son travail, qualifié de néo-constructiviste, se retrouve dans plusieurs collections d’art autant en Amérique du Nord, qu’en Europe. Ses œuvres aux formes géométriques et linéaires présentent souvent des éléments cinétiques. Sa pratique interdisciplinaire intègre des thèmes poétiques comme le mouvement de l’eau et du vent, mais avec une approche très architecturale, qui bousculent nos références habituelles et notre rapport aux matériaux.
Au regard des Voiles de Jean-Jacques Besner, nous verrons comment le matériau utilisé, en relation au thème, soutien l’indécidabilité de l’œuvre. Nous verrons également une mise en abîme dans le choix de l’emplacement et l’impact de ces deux observations sur la réception de l’œuvre.
Tout d’abord, le choix de l’acier inoxydable en dualité avec le vent impose un rapport de force qui déjoue les lois de la nature et bouscule nos perceptions de celle-ci. La toile frêle mollit sous le ciel sans vent et cède à la moindre rafale un peu rude. Le métal quand à lui demeure dur et intransigeant, même au creux de l’orage. Parallèlement, son inertie et sa lourdeur rendent ces voiles impassibles au mouvement du vent. Aussi, par interaction, le passant est invité à manipuler avec amusement ce jeu de voiles dans un bruit sourd, ce qui le confronte à un paradoxe entre la représentation et le matériau utilisé.
Dans un deuxième temps, comme l’œuvre se trouve aux abords de la rivière des Prairies, nous pouvons voir une mise en abîme du thème de la voile en référence aux bateaux qui naviguent sur ce plan d’eau en saison estivale. Ce détournement est d’autant plus marqué par le fait que, de la rivière, les plaisanciers peuvent difficilement voir ces voiles d’acier et inversement, le spectateur ne voit pas complètement la rivière, laquelle est dissimulée par les nombreux arbres qui longent la berge. Cette forme de dissimulation additionnée des jeux d’inter-références ajoutent également à l’aspect ludique de l’œuvre.
Pour finir, l’œuvre a subi une restauration au début des années 2000. L’artiste étant décédé en 1993 et ce sans succession, c’est le Bureau de l’art public de la Ville de Montréal qui s’est chargé des travaux. Étrangement, les panneaux d’acier autrefois mobiles ont été soudés en place, figeant ainsi le rapport physique et ludique que les deux sculptures entretenaient avec le spectateur. Bien que le Bureau ait affirmé avoir agit sous les recommandations de l’artiste (décédé à l’époque rappelons-le), nous sommes en mesure de porter un nouveau jugement sur notre rapport à l’œuvre et de questionner son intégrité. L’objet enfanté par l’artiste a-t-il des droits?
Thierry Labonté
_________
Références :
Jean-Jacques Besner, http://www.metrodemontreal.com/art/besner/index-f.html, visité le 12 octobre 2009.
Art Investors Internationnal, http://artvoices.com/art4sale/besner.htm, visité le 12 octobre 2009.
» La montagne des jours » de Gilbert Boyer par Stéphanie Laurin

Gilbert Boyer, La montagne des jours, 1991, granit, parc du Mont Royal (photographie de Stéphanie Laurin)
Gilbert Boyer, artiste montréalais reconnu pour ses installations d’art public, a réalisé dans le cadre des Cent Jours d’Art Contemporain en 1991, une œuvre à l’intérieur des sentiers du Mont Royal. Cette sculpture, intitulée « La montagne des jours » se compose de cinq disques de granit de 1,70 m chacun, disposés sur le sol de la montagne, à cinq emplacements différents. (voir figure 3 en annexe) Sur chacun de ces disques sont gravés des phrases complètes et fragments. Ceux-ci sont disposés de façon circulaire. Ainsi, écriture et sculpture se mêlent pour former une œuvre interdisciplinaire. À ce sujet, il est intéressant de formuler la problématique suivante : En quoi l’utilisation du texte dans l’œuvre « La montagne des jours » de Gilbert Boyer contribue-t-elle à la mémoire collective du lieu ou elle se trouve ? Cette question sera traitée selon les trois aspects de la création, de la diffusion et de la réception de l’œuvre.
Tout d’abord, il est important de noter que Gilbert Boyer a créé « La montagne des jours » en s’inspirant directement du Mont Royal. En effet, l’artiste s’est baladé dans la montagne, puis y a récolté dans divers lieux, des bribes de conversations provenant de marcheurs inconnus. Il a donc sélectionné des fragments de paroles entendues, se les est appropriés, puis y a juxtaposé ses propres réflexions pour en faire une œuvre. Ce processus d’appropriation rappelle celui du glanage. Gilbert Boyer a récolté des paroles volatiles, qui autrement s’effacent avec le temps. Ces paroles éphémères témoignent de la vie, du quotidien et de l’intimité des promeneurs du Mont Royal.
En gravant ainsi des fragments de conversations dans le granit, Gilbert Boyer a créé une œuvre durable, intemporelle. Ces disques de granit deviennent alors des monuments, figeant les paroles oubliées dans leur lieu d’émission, le Mont Royal. Cette montagne est reconnue comme lieu de nature et de détente, au centre d’une ville active, pour les solitaires, couples et familles. En plaçant ainsi, à des endroits différents, les cinq disques de La montagne des jours, l’artiste inscrit une trace multiple, susceptible d’être découverte à plusieurs reprises par un grand nombre de visiteurs.
Par sa textualité, « La montagne des jours » interpelle le marcheur à la lecture. Ainsi, l’individu est amené à reconstituer le sens des fragments de phrases gravés sur chacun des disques. Ces bribes de conversations renvoient aux perceptions personnelles de l’intime et du quotidien. Ainsi, le lecteur se rappelle de paroles déjà entendues ou vécues, mots faisant référence à sa propre identité. L’œuvre témoigne d’une histoire sociale oubliée et de la réalité quotidienne des individus qui ont aussi sillonné la montagne.
En résumé, c’est par le glanage de paroles de promeneurs gravés dans cinq disques de granit, un matériau durable, que Gilbert Boyer a constitué son œuvre « La montagne des jours ». Cette œuvre interpelle l’individu et le place au centre du sujet, en ravivant la mémoire collective du quotidien. En fixant à jamais les paroles perdues, l’artiste rend hommage de façon poétique et subtile à l’intime et au quotidien de la vie de tous et chacun, démontrant ainsi à l’individu que son existence compte dans l’histoire. D’un autre côté, il serait intéressant de voir si l’appropriation de paroles de la vie privée d’inconnus, serait susceptible de causer des problèmes par rapport aux enjeux éthiques d’aujourd’hui.
Verna, Gaétane. (Collaboration) Beyond words, Au-delà des mots, Art Gallery of Bishop’s university, Lennoxville & Mount Saint Vincent University Art Gallery, Halifax, 2004.
Debat, Michelle. « Gilbert Boyer Le Langage de l’art : pour une langue en migration » Parachute, Numéro 120, Montréal, 2005, pages 73 à 89.
L’art public à Montréal http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154690&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=342 (visité le 12 octobre 2009)
Paws takes Bishop par : Isabel Marceau
 Pawn takes Bishop (2007) est une création de l’artiste Peter Gibson, mieux connu sous le pseudonyme de Roadsworth. Situé au parc Émilie-Gamelin, l’œuvre peinte au pochoir est constituée de damiers d’échec géant s’intégrant aux carrés de granit de la place centrale. Réalisé grâce au financement d’art public Vill’Art Marie et du groupe Dada Art actuel, elle fut instaurée afin de redonner vie à un endroit déserté du centre-ville. Comment, la reprise des codes du jeu et de ses notions contribue à l’anonymat de Pawn takes Bishop face à son statut d’œuvre d’art? Nous étudierons la question sous trois aspects distinct soit; la diffusion de l’œuvre, la réception du public et l’indécidabilité qu’elle provoque.
Pawn takes Bishop (2007) est une création de l’artiste Peter Gibson, mieux connu sous le pseudonyme de Roadsworth. Situé au parc Émilie-Gamelin, l’œuvre peinte au pochoir est constituée de damiers d’échec géant s’intégrant aux carrés de granit de la place centrale. Réalisé grâce au financement d’art public Vill’Art Marie et du groupe Dada Art actuel, elle fut instaurée afin de redonner vie à un endroit déserté du centre-ville. Comment, la reprise des codes du jeu et de ses notions contribue à l’anonymat de Pawn takes Bishop face à son statut d’œuvre d’art? Nous étudierons la question sous trois aspects distinct soit; la diffusion de l’œuvre, la réception du public et l’indécidabilité qu’elle provoque.
Pawn takes Bishop est en contradiction directe avec notre relation face à l’art muséal, en plus d’être facile d’accès et gratuite, elle entretient un contact directe et physique dans son dialogue avec le spectateur. En effet, celui-ci est invité à marcher directement sur » la toile » de Roadsworth. Au niveau de sa diffusion, l’œuvre est située dans un parc public ou elle est incorporée au lieu sous forme d’un jeu d’échec au niveau du sol. Les damiers simplement peints sur le granit, sont automatiquement associés par les spectateurs aux tracés faits dans une cours d’école comme par exemple, ceux de marelle. Nous pourrions le qualifié d’objet Tricsker[1] et c’est justement ce qui vient brouiller les pistes de sa réception car, il y a ici coexistence de deux réalités; jeu et art. L’œuvre invite les gens à participé de façon interactive entre eux. Elle accorde une place privilégiée à son spectateur, contrairement à l’art traditionnel qui se place souvent au premier plan. Ici Roadsworth met en scène l’être qui l’observe. Installation In situ sans cadre signalétique, Pawn takes Bishop résiste à l’identification grâce à sa discrétion. En effet, par sa réalisation à l’aide de moyen simple (pochoir) et par sa volonté de mimétisme du jeu, l’œuvre reste anonyme pour la plupart de ses visiteurs. Elle est exposée sans que son titre ou son auteur ne soient cités comme il serait identifié dans un musée, voici une raison du sentiment d’indécidabilité chez le spectateur qui a besoin pour la plupart du temps, de ses formalités afin d’orienter sa compréhension.
En axant son travail sur la reprise des codes du jeu d’échec et en proposant au public de participer à l’expérience sans lui mentionner visuellement ses qualités artistiques, l’œuvre de Roadsworth rappel l’importance de questionner l’utilisation du lieu. Premièrement, mise en place pour redonner vie au parc Émilie-Gamelin et créer un sentiment d’appartenance chez les montréalais, l’œuvre introduit un élément surprenant dans un environnement uniforme et prévisible. Selon Roadsworth; «Déclarer son existence c’est la chose la plus naturelle au monde, surtout dans le milieu urbain qui essai d’homogénéiser notre identité »[2]. Si l’expression de l’être est viscéral afin de se différencier de la masse en arts visuels en est-il de même dans les autres disciplines ou bien est-ce exclusif au domaine artistique ?
Bibliographie
Article de périodique :
- Caron, Jean-François, «La face cachée de la ville», Le Voir, Septembre 2007.
- Paré, Isabelle, «Un échiquier géant pour la place Émilie-Gamelin», Le Devoir, Mai 2007.
Site internet :
- Roadsworth (site officiel), http://www.roadsworth.com, visité le 8 octobre 2009.
- Les beautés de Montréal, www.lesbeautesdemontreal.wordpress.com/page/17/, visité le 4 octobre 2009.
Télédiffusion :
- Mange ta ville, L’urbanité, saison 1, Artv.
- Mange ta ville, L’espace publique, saison 4, Artv.
- Bons baisers de France, Radio Canada.
Radiodiffusion
Vous êtes ici rencontre, Peindre la rue, 13 novembre 2008, Radio Première
[1] Jean-Philippe Uzel, « Les objets tricsker de l’art actuel », dans L’indécidable, écarts et déplacements de l’art actuel, sous a direction de Thérèse St-Gelais, Montréal, Éditions Esses, 2008, p.39-50.
[2] Entrevue à l’émission Mange ta ville, L’urbanité, saison 1, ARTV
Entrelacement de Michel de Broin, par Pierre-Luc Verville
Entrelacement est une œuvre d’art publique qui a été réalisée par Michel de Broin en 2001. Utilisable jusqu’à une certaine limite, elle se veut un embranchement de la piste cyclable située en bordure du canal Lachine. Constituée de 12 tonnes de bitume, d’un pictogramme et de peinture signalétique, elle mesure 40 mètres de long et comme son titre le rappelle, elle est recroquevillée en forme de gribouillis. Elle fut installée dans le cadre de l’atelier de sculpture Artefact 2001. Puisque dans cette œuvre plusieurs frontières sont franchises, notamment celles du musée, la lecture de l’œuvre peut être ambiguë et sa signification indécidable. Comment l’œuvre dans sa création, sa diffusion et sa réception est-elle porteuse d’indécidabilité à la lumière des notions de d’appropriation, de détournement et d’interdisciplinarité ?
L’indécidabilité de l’œuvre ressort premièrement par la notion d’appropriation. L’œuvre est véritablement une piste cyclable, au moins une annexe. En effet, les composantes de la piste cyclable ont toutes été utilisées et conservent en partie leurs fonctionnalités. Le bitume, le pictogramme et la peinture signalétique permettent au spectateur de reconnaître son environnement de promeneur immédiatement. Puisque les matériaux utilisés ne sont pas traditionnellement rattachés au monde artistique, la frontière entre art et non-art semble transgressée. En outre, l’œuvre n’est pas sacralisée par l’aura du cube blanc, mais elle s’active par le déplacement des codes signalétique en vigueur. Comme le remarque Jean-Philippe Uzel « De Broin a compris que l’espace public est un lieu aussi institutionnalisé que le musée, que le lieu public est en fait aujourd’hui l’ultime extension du musée. »[1]
D’autre part, l’indécidabilité du tronçon de piste cyclable qui fait œuvre est le résultat d’un détournement savamment orchestré. Dans une gestualité qui contrecarre toute linéarité, le parcours asphalté est aménagé dans une forme qui ressemble à un griffonnage. Alors que cette forme très irrégulière aux angles aigus apparaît sur le panneau signalétique en guise d’avertissement, la logique rationnelle du déploiement urbain est complètement contrée par l’irrationalité du geste. En ayant incorporé cette part de subjectivité où il n’y en avait pratiquement pas, de Broin amène le spectateur à vivre une expérience déroutante. La ligne jaune, qui divise normalement la piste en deux parties égales pour éviter les collisions, ne remplie plus son rôle mais engendre désormais de multiples croissement. L’indécidabilité apparaît donc dans le déplacement de la fonction initiale de la piste cyclable vers une fonction esthétique, de par sa forme.
L’indécidabilité de l’œuvre est finalement rendue par son interdisciplinarité. Dans la réalisation du projet, l’artiste a dû, par l’intermédiaire d’exécutants spécialisés, faire appel aux disciplines d’urbanisme, d’aménagement paysagé et de la construction. Celles-ci sont confondues dans le résultat final car elles participent toutes à sa mise en place et à sa réception vers un même but : l’art. Puisque l’ouvrage fait appelle à un tiers ouvrier, il y a un écart entre l’artiste et la notion d’objet mais aussi entre les positions esthétique et politique.
En conclusion, Entrelacement de Michel de Broin fait cohabiter des réalités contradictoires qui la rendent ambiguë et insaisissable, au point où sa signification est indécidable.[2] L’artiste amène le spectateur à vivre une expérience déroutante par le déplacement de la fonction initiale de la piste cyclable. En utilisant celle-ci et les codes qui régissent l’espace public dans un jeu de forme, de Broin se permet de repousser la limite entre l’art et la vie. « Ce que nous retenons ici de l’indécidable décrit donc une multiplicité de zones où s’amenuisent, voire s’effacent les frontières entre l’artiste et la notion d’objet, le monde de la fiction et de la réalité, le vrai et le faux, les positions esthétique et politique, et l’art et le non-art. »[3] Mais ces frontières peuvent-elles véritablement être effacées ?
[1] Jean-Philippe Uzel, « Michel de Broin : l’espace public mis à nu par l’artiste même», Spirale, no 191, juillet-août 2003, p. 47. 13 M. de Broin, « Résistance et expérience du circuit », dans Eurêka, Hull, AXENÉO7 art contemporain, Éditions d’art Le Sabord, 1999, n. p.
[2] Ouvrage collectif, L’indécidable : écarts et déplacements de l’art actuel, Esse, Montréal, 2008, Les éditions esse, 296 pages
[3] Idem
RÉVOLUTIONS – Michel De Broin (par Geneviève Hébert)
La ville de Montréal possède une collection impressionnante d’œuvres d’art destinées à embellir ses lieux publics. Parmi celles-ci, nous comptons une sculpture monumentale de Michel de Broin. Ce projet audacieux a été érigé en 2003 au cœur du parc Maisonneuve-Cartier, situé dans l’arrondissement Ville-Marie. Ce n’est qu’à deux pas de la station de métro Papineau que nous pouvons admirer cette pièce unique intitulée Révolutions. Cette représentation abstraite d’un escalier qui se torsade fait directement référence à un élément particulier de l’architecture de notre ville : les typiques escaliers extérieurs des habitations montréalaises. Entièrement fait d’aluminium, ce monument est la représentation directe d’un escalier infini et courbé, formant un nœud de trèfle au sommet de six piliers. Cette composition fait aussi référence aux lieux avoisinant son emplacement : la structure métallique du pont Jacques-Cartier et les manèges de La Ronde. La notion d’interdisciplinarité est au cœur du travail de cet homme, car nous y retrouvons des notions architecturales intégrées dans un contexte sculptural. Le tout en s’apparentant aux formes dans les logiciels de modélisation 3D.
Je m’interrogerai donc sur cette problématique : « Comment l’utilisation de la courbe dans l’œuvre Révolutions de Michel de Broin vient donner un tout autre sens à cet élément architectural habituellement banal de notre environnement urbain ? » J’explorerai la question à l’aide des trois notions suivantes : la citation, l’appropriation/l’intégration et la simulation/le simulacre.
Dans son dossier de présentation émis aux juges du bureau d’art public de Montréal, Michel de Broin citait l’œuvre Monument à la 3ième internationale de Vladimir Tatline. La maquette de cet artiste russe représentait une tour composée d’une triple spirale désaxée. Cette œuvre de 1920 prit vite le statut de véritable icône de l’avant-garde et son impact sur les expérimentations en architecture se fit longtemps ressentir. Dans son œuvre récente, De Broin s’est approprié l’escalier en colimaçon typiquement montréalais et l’a complètement transformé. En réalisant un noeud avec celui-ci, il déconstruit la symbolique de l’ascension verticale qui lui est normalement associée. En courbant son élément et en le faisant revenir sur lui-même, l’artiste a créé une sorte de circuit fermé qui revient continuellement sur lui-même. C’est donc dire que cet escalier n’a plus aucune réelle destination. Voilà donc l’apparition d’un simulacre pour le spectateur. Comme Tatline, l’artiste crée volontairement une illusion d’architecture connue mais détourne sa fonction habituelle en la courbant et la recroquevillant. Il a donc intégré à son œuvre cet objet usuel pour ensuite le transformer en manège pour l’observateur. Il s’est approprié cette forme et en a simulé une attraction foraine.
J’interprète cette œuvre comme une œuvre sociologique plus qu’architecturale. Je m’y retrouve dans sa dimension humaine et dans sa référence à cette invention calculée par le cerveau humain. Elle me suggère des réflexions sur l’émotivité instable de l’homme et sur les parcours sinueux qu’il aura à traverser tout au long de son existence : la vie, un cycle infini qui ne cesse de se renouveler. Verrons-nous un jour, dans notre environnement, des bâtiments accessibles et d’un style architectural aussi complexe?
Ernest Pignon-Ernest
Bonjour concernant le dernier cours sur l’art de rue..voici un artiste que je trouve intéressant. Son approche mêle à la fois dessin ‘académique » et art de rue. Il travaille généralement sur de grandes affiches qu’il va placarder dans la rue ou à l’endroit qui lui semble pertinent.
voici le lien pour son site http://www.pignon-ernest.com/
Bonne semaine
Josiane Saumure
Pour cette analyse, j’ai choisi l’œuvre Hymne au courant d’air de Guy Nadeau. Composée de bois franc, d’acier et de bronze; elle est exposée dans le hall du pavillon de musique du Cégep Lionel-Groulx depuis décembre 2003. Elle allie à la fois sculpture et architecture puisqu’elle occupe virtuellement tout le volume supérieur du hall. Dans cette optique, comment Hymne au courant d’air arrive-t-elle à se distinguer d’un esthétisme architectural pour être reconnue, d’emblée, en tant qu’œuvre d’art? Voila ce à quoi je vais tenter de répondre, dans le prochain texte, en étudiant trois aspect de l’œuvre soit : la création, la diffusion et la réception.
Premièrement, au point de vue de la création, l’élément qui retient mon attention est le choix des matériaux. L’utilisation de l’acier et du bois ne sont pas pour aider à faire la distinction entre une œuvre d’art et une architecture décorative. Ces matériaux dits traditionnels sont régulièrement utilisés dans la plupart des édifices publiques du Québec en tant qu’éléments architecturaux. Et, puisque le Cégep Lionel-Groulx est, à la base, un bâtiment ecclésiastique, le choix du bois n’en est que plus naturel. Par contre, l’utilisation du bronze vient démontrer une volonté autre, ce matériel étant traditionnellement lié à l’art depuis l’époque classique (Le Penseur de Rodin en est un excellent exemple).
Deuxièmement, en ce qui a trait à la diffusion, l’œuvre est en situation de mise en valeur de son lieu d’exposition, ce qui ramène à la question initiale. Loin de faciliter la distinction entre l’art et le design architectural, les panneaux de bois ainsi que la tablette (voir figure 1) tous placardés aux murs qu’ils sont, donnent un rendu plutôt décoratif à la pièce. Quant à la voute grillagée d’acier, sa façon d’occuper l’espace met de l’avant une certaine volonté architecturale (voir figure 1). Une fois de plus, l’élément révélateur sera contenu dans le bronze, soit la disposition des deux plaques ondulées ainsi que de la myriade de feuilles qui viennent briser l’équilibre de la pièce et lui insuffler un peu de chaos (voir figures 1,2 et3).
Troisièmement, au niveau de la réception, le fait que l’œuvre se trouve dans un hall d’entrée et qu’elle ne confronte pas directement le spectateur (vu sa position élevée), ce dernier se retrouve devant deux situations possibles : la première étant que par dissimulation, il ne la voit pas et la seconde étant l’absence de distinction de la nature de ce qui est perçu. Dans le cas de la deuxième situation, comment le spectateur non-initié pourrait reconnaître qu’il s’agit d’une œuvre d’art? Ce statut se verrait obtenir le salut par la présence de cette fameuse plaque signalétique : preuve finale de l’activité artistique (voir figure 4).
Finalement, cette œuvre illustre bien un problème de définition de l’art. Par quels moyens il est possible de distinguer l’art d’un simple design architectural? Malgré le fait qu’il est difficile de distinguer les traces de l’artiste dans sa création (affranchissement du métier) et malgré le fait qu’elle n’est pas présentée dans une institution artistique (franchissement du musée)[1], il est possible de faire cette distinction grâce à ladite plaque. Qu’adviendrait-il si on la déplaçait dans un musée : son côté décoratif ne provoquerait-il pas, à ce moment, une intrusion plutôt qu’une dissimulation ?
[1] Patrice LOUBIER, Embuscade et raccourcis

Les leçons singulières de Michel Goulet par Maggie Ladouceur
C’est en me promenant au hasard dans le centre-ville, il y a quelques années, que je suis arrivée par hasard sur une série de chaises dont l’une me paraissait assez confortable pour m’inviter à m’y asseoir. En me rapprochant, je m’aperçus que les chaises me semblaient trop étranges pour qu’une personne puisse s’y installer. Je sus, après quelques temps, que cette partie de cet espace public était investie par l’artiste Michel Goulet et que l’oeuvre était la propriété de la Ville de Montréal et de sa collection d’art public. Les leçons singulières (volet 1), a été réalisée en 1990 et elle est exposée présentement à la Place Roy près du parc Lafontaine. Cette installation comprenant huit chaises fabriquées en acier inoxydable, en bronze et en laiton est d’une hauteur de 90 centimètres pour chacune des chaises. Une table-fontaine en laiton vient compléter l’œuvre. Une question s’est alors posée à moi : en quoi Les leçons singulières (volet 1), de Michel Goulet vient brouiller notre perception de ce que peut être une œuvre d’art alors qu’elle est exposée dans un endroit public? J’aborderai donc cette réflexion sous les trois aspects qui sont le brouillage des régimes de valeurs, la dissimulation de l’œuvre dans un endroit public et le code d’éthique des musées qui est mis à l’épreuve dans ce contexte-ci.
À première vue, les chaises de Michel Goulet se confondent avec des chaises fabriquées en industrie à cause des matériaux utilisés qui ne sont pas traditionnellement liés avec la création d’œuvres d’art. En imitant ainsi un produit en série, l’objet simule une fonction utilitaire par la chaise qui, habituellement, est conçue pour se reposer, prendre une position confortable pour y travailler, etc. Pourrais-je parler ici d’objets trickster, ces objets dont on doute de leur signification puisqu’ils semblent appartenir à plusieurs régimes de valeurs? Quand je suis approchée pour observer ce qui se présentait devant moi, j’ai compris que non seulement le coussin de l’une des chaises ne représentait qu’un simulacre puisqu’il était confectionné en acier, mais qu’en me retournant pour regarder les autres chaises, des objets (une spirale, un puzzle, une maison, un entonnoir, une pièce mécanique, un labyrinthe avec des escaliers) étaient ancrés sur les dossiers et réfèraient à des aspects du quotidien. Confondre ces chaises à un objet de design qualifierait cet objet que sous cet angle alors qu’elle appartiendrait davantage au champ artistique.
En continuant de réfléchir sur cette étrangeté qu’est l’installation de cette œuvre d’art dans cet endroit public, je me suis dit qu’en fait, l’absence de codes quant au repérage d’un lieu spécifiquement artistique ajoutait à cette incompréhension que j’ai eue au départ il y a quelques années à mon arrivée à cette place. Il faut s’attarder davantage à l’œuvre et ses détails pour comprendre son intégration dans son environnement et y faire une expérience physique en se promenant entre chaque chaise pour saisir toute sa portée. L’œuvre se démarque par sa grande présence avec plusieurs chaises situées dans un grand espace extérieur, à la fois qu’elle est absente, se dissimulant comme des chaises ordinaires, surtout que ses principaux spectateurs sont les gens du grand public. Cet exemple de l’homme qui a cadenassé sa bicyclette sur une chaise pour aller faire son marché n’était certainement pas un grand amateur d’art…
L’expérience physique de déambulation que chacun peut explorer avec Les leçons singulières (volet 1) interpelle le spectateur à sentir comme une invitation à s’asseoir en groupe qui est finalement impossible étant donné les divers objets soudés sur les chaises. D’ailleurs, oser s’y reposer avec les deux seules chaises fonctionnelles finit par être inconfortable à cause des dossiers en acier. De plus, le malaise créé par le fait que l’on sait finalement que c’est une œuvre d’art et qu’elle porte un statut sacré comparé à des chaises ordinaires se rapporte au code d’éthique du musée qu’il faut protéger les œuvres et s’y tenir à distance pour avoir une meilleure conservation de celles-ci. Il y a alors une confusion quant à savoir si on peut réellement y prendre place ou pas.
Pour conclure, une réflexion critique sur le quotidien s’impose. Quelle place accordons-nous dans la vie aux relations humaines dans le quotidien? Est-ce que ce quotidien est rempli de préoccupations matérielles qui finissent au bout du compte par être superficielles et nous éloignent dans notre rapport avec les autres? Comme j’ai découvert par surprise cette œuvre d’art, doit-on se laisser aller vers le hasard pour explorer d’autres facettes de notre vie? Il y a une autre partie des Leçons singulières (volet 1) que je n’ai pas abordée puisque je ne croyais pas au départ qu’elle était liée à l’œuvre. C’est une carte du monde par laquelle on peut questionner les relations humaines dans le monde, mais à mon avis, il y a une perte de la surprise quant à savoir si elle une œuvre d’art ou pas puisque la carte ne peut se dissimuler autant dans le lieu que les chaises. Si l’on prend les deux éléments ensemble, il est évident que l’on s’interroge davantage sur leur lien et que l’on peut oublier d’en faire l’expérience physiquement en ayant cette innocence de ne pas savoir ce qui se retrouve devant nous.
BIBLIOGRAPHIE :
http://www.montréal.qc.ca/portal
recueil de textes : Embuscades et raccourcis : formes de l’indécidable dans l’art contemporain, de Patrice Loubier
Les objets trickster de l’art actuel, de Jean-Philippe Uzel
JOËLLE MOROLOSI DE CUIVRE ET DE CHIMÈRE par Gabrielle O. Murphy
L’œuvre étudiée dans ce billet s’intitule De cuivre et de chimère (ANNEXE 1) et a été réalisée en 1995 dans le cadre de l’exposition « Terre gravide… émergence », une exposition entièrement féminine soulignant l’ouverture du parc Marie-Victorin situé sur les berges du Saint-Laurent à Longueuil et le 20e anniversaire de l’Année internationale de la Femme. (MARIGOT, 2009) L’œuvre a été réalisée par Joëlle Morolosi en collaboration avec Rofl Morolosi, elle est faite de plusieurs sortes de métal (acier, aluminium, cuivre, inox) et est construite en deux temps. Tout d’abord, il y a trois panneaux métalliques évoquant une proue de bateau qui vont rejoindre un mat d’aluminium. Au bout du mat est installée une tête de dragon articulée par un moteur. L’artiste a une démarche essentiellement axée sur des projets mobiles et mécanisés et doit donc être à l’aise en mécanique. Dans De cuivre et de chimère, il faut déterminer de quelle manière l’artiste arrive à intégrer l’idée de l’émergence qui était le sujet de l’exposition. Pour ce faire, la question sera étudiée sous trois aspects différents : la notion d’appropriation, les matériaux utilisés pour construire l’œuvre et aussi la réception de cette dernière.
Tout d’abord, l’artiste affirme « Traduire l’eau par la matière ». (MARIGOT, 2009) Pour elle, l’eau devient un grand champ lexical. Elle fait le lien entre l’eau et ce qui en émerge, soit le bateau. À l’aide de sa tête de dragon mouvante, elle reproduit le mouvement de l’eau. (MARIGOT, 2009) Elle s’approprie l’idée du bateau Vicking car selon elle, en plus d’émerger de l’eau, celui-ci émerge aussi de l’imaginaire. La représentation du dragon devient alors un symbole puissant permettant de faire le lien entre la mystique perpétrée par le symbole et le double sens de cette représentation. En effet, historiquement, la tête animale sur le Drakkar permettait de conjurer le mauvais sort mais aussi d’accompagner un défunt dans la mort. (MARIGOT, 2009)
Pour représenter le Drakkar, Joëlle Morolosi a utilisé trois bandes de métal symbolisant la proue du bateau faites d’acier qui change avec le temps et par duquel émergent alors une nouvelle matérialité et la notion de vieillissement. Par l’utilisation du métal, elle transmet aussi la force et la puissance qui sont deux notions associées aux Vickings.
De plus, le métal, un matériau solide, sort de la terre qui est un matériau souple ce qui crée un contraste assez affirmé.
Lorsque l’on est en présence de l’œuvre, on est d’abord frappé par le mouvement de la tête du dragon. La cinétique place alors le spectateur en situation presque hypnotique car cette dernière recrée le mouvement de la mer. De plus, comme l’artiste n’a pas représenté le bateau au complet, le spectateur a le sentiment d’être devant un navire qui est en train de sortir des flots, d’où la notion d’émergence. La disposition du rempart de gazon devant l’œuvre, fortuite ou non, renforce l’idée du mouvement d’onde liée à l’eau.
Par le sujet de l’œuvre, le traitement du lieu et des matériaux et la mécanique intégrée à son travail, Joëlle Morolosi intègre fermement la notion d’émergence propre à l’exposition. En effet, le Drakkar émerge des profondeurs historiques pour s’intégrer physiquement au lieu en émergent de la terre. Le mysticisme qui est véhiculé par l’œuvre est bien rendu par le mouvement hypnotique et la symbolique historique de la tête de dragon. Il serait intéressant de réfléchir plus longuement à la disposition de l’œuvre dans l’espace et à l’utilisation des connaissances historiques et mécaniques qui sont nécessaires à l’artiste pour confectionner ses œuvres.
Médiagraphie
– SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU MARIGOT, « De cuivre et de chimère », http://www.marigot.ca , (Page consultée le 10 octobre 2009)
– SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU MARIGOT, « Le parc Marie-Victorin et ses sculptures », http://www.marigot.ca/site/m11.htm,
(Page consultée le 10 octobre 2009)
– UNIVERSITÉ LAVAL, « Joëlle Morolosi à la galerie des arts visuels », http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2000/03.30/arts.html, (Page consultée le 12 octobre 2009)
– VILLE DE MONTRÉAL, « Joëlle Morolosi »,
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_OUT_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROGRAMMATION%20GAO%202009-2010.PDF, (Page consultée le 10 octobre 2009)
Le Retour, Luc Boyer, par Josée Courtemanche
À l’ère actuelle, « la recherche sur la nature biologique du cancer requiert une approche interdisciplinaire et polyvalente »1, tel que le mentionne le Dr. Michel Tremblay sur la page d’accueil du site web du Complexe des sciences de la vie de l’université McGill. C’est pour illustrer cette réalité que l’artiste Luc Boyer a réalisé Le Retour dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
Le Retour est une œuvre interdisciplinaire car elle intègre et fusionne diverses notions appartenant aux domaines de la sculpture, du travail de l’acier, de la médecine ainsi que de plusieurs sciences naturelles. La sculpture monumentale trône devant le nouveau Centre de recherche sur le cancer Morris et Rosalind Goodman de l’institution universitaire mentionnée ci-haut depuis son inauguration officielle le 16 septembre 2008 dernier.
Le présent document déterminera de quelle manière Luc Boyer a su, dans la réalisation de son œuvre user de stratégies efficaces afin d’illustrer la vocation du Centre Goodman. En effet, l’œuvre de l’artiste présente une certaine polysémie relativement aux éléments formels qui y sont intégrés. Aussi, elle démontre une habile appropriation par son créateur du langage de la science et fait également écho à plusieurs enjeux de l’art public.
D’abord, une nette polysémie est observable dans l’œuvre de Boyer. En effet, la pièce analysée s’inscrit dans la démarche du sculpteur qui représente fréquemment des éléments biologiques et organiques dans sa production, ce qui confère à la sculpture une polysémie évidente. Le retour donne à voir des éléments formels s’apparentant aux fibres musculaires et aux ossements humains. Aussi, l’utilisation de tiges transversales rappelle les concepts de maladie, d’entrave ou de blessure. L’artiste a également choisi d’intégrer vers le haut de sa sculpture une série de sphères qui rappellent l’idée de parasites, de corps étrangers. Le traitement de surfaces et les différentes patines utilisées donnent un aspect ancien à la sculpture, ce qui renvoie à l’univers anthropologique, à la fouille, ou encore à la recherche. Puis, les tons de bruns, terreux créent une harmonie entre l’œuvre et le paysage boisé du parc du Mont-Royal qui fait face à l’institution. Ensuite, tel que mentionné ci-dessus lorsqu’il était question des sphères vers le haut de l’œuvre, Luc Boyer a su intégrer dans Le retour des éléments rappelant le modèle de la molécule d’ADN. L’artiste s’approprie ainsi une imagerie et un langage propre à la science et à la médecine. Finalement, la sculpture de l’artiste répond à certains des grands enjeux de l’art public. En effet, l’art étant une grande stratégie de communication, Boyer transmet par son œuvre des notions issues de la biologie moléculaires et de l’anatomie aux spectateurs, ce qui donne à sa pièce une portée éducative.
Les chercheurs du Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman articulent leurs travaux autour de cinq axes principaux dont métabolisme et cancer et altérations et instabilité de l’ADN. Dans cet ordre d’idées, Le retour de l’artiste abitibien Luc Boyer illustre entre autres par la polysémie de ses éléments formels la vocation du bâtiment devant lequel l’œuvre est érigée. Monsieur Boyer est atteint de la poliomyélite, maladie dégénérative communément appelée polio depuis plusieurs années. Il peut être intéressant de se questionner à savoir si un autre système de codes aurait pu être utilisé dans Le retour pour traiter du même sujet.
Révolutions de Michel de Broin par: Marie-Claude Lepiez
 L’oeuvre choisie est celle de Michel De Broin ajoutée à la collection d’art publique de la Ville de Montréal par l’intermédiaire d’un concours en 2003. Révolutions est située dans le Parc Maisonneuve-Cartier à Montréal. Cette oeuvre est composée d’aluminium marin, un alliage possédant une forte résistance à la corrosion et une solidité supérieure aux alliages standards (METRO, 2003). Il s’agit d’un escalier sans fin, recourbé sur lui même formant un noeud de trèfle, soit un nœud avec trois croisements, au bout de 6 poteaux mélangeant art et architecture. L’ensemble fait 8 mètres de haut (METRO, 2003). Dans cette pièce, comment la sculpture de De Broin marque l’identité du paysage montréalais ? J’étudierai l’œuvre de De Broin sous trois aspects différents, soit ceux de la création, de la diffusion et de la réception.
L’oeuvre choisie est celle de Michel De Broin ajoutée à la collection d’art publique de la Ville de Montréal par l’intermédiaire d’un concours en 2003. Révolutions est située dans le Parc Maisonneuve-Cartier à Montréal. Cette oeuvre est composée d’aluminium marin, un alliage possédant une forte résistance à la corrosion et une solidité supérieure aux alliages standards (METRO, 2003). Il s’agit d’un escalier sans fin, recourbé sur lui même formant un noeud de trèfle, soit un nœud avec trois croisements, au bout de 6 poteaux mélangeant art et architecture. L’ensemble fait 8 mètres de haut (METRO, 2003). Dans cette pièce, comment la sculpture de De Broin marque l’identité du paysage montréalais ? J’étudierai l’œuvre de De Broin sous trois aspects différents, soit ceux de la création, de la diffusion et de la réception.
Michel De Broin s’est fait surtout connaître par ses œuvres exposées dans des lieux publics. La sculpture de De Broin émane de l’architecture typiquement montréalaise. L’artiste se devait de connaître la ville de Montréal ainsi que son architecture pour en faire ressortir, dans Révolutions. un portrait ou plutôt une forme de paysage montréalais. Il s’est approprié les escalier courbes de la ville pour faire vivre son projet. La forme de l’œuvre rappelle aussi le pont Jacques-Cartier, les manèges de La Ronde et la boucle absolue des escaliers du métro. Tous ces éléments viennent donc ajouter une profondeur au caractère identitaire de l’œuvre (DEVOIR, 2002).
La diffusion de Révolutions de De Broin se fait par le biais du Parc Maisonneuve-Cartier, derrière la station de métro Papineau à Montréal. La sculpture est donc à l’extérieur, dans un espace naturel montréalais ouvert au public. Ses matériaux résistants nécessitent peu d’entretien permettant ainsi une plus grande longévité et donc une durabilité. Cette œuvre est définitivement fait pour rester à un endroit fixe, dû à ses dimensions, elle est difficilement déplaçable. Bien qu’elle aurait pu être accueillie ailleurs à Montréal que dans ce parc, son appartenance au paysage Montréalais en fait une œuvre In Situ. De plus, le choix des matériaux industriels permet d’entretenir un rapport avec son lieu d’exposition, la ville. Cette œuvre a besoin de son contexte pour vivre, elle fût définitivement créer pour se poser dans la ville de Montréal, ça se voit par son fort caractère identitaire à la ville.
Au niveau de la réception de l’œuvre, l’escalier ramène donc l’idée de cycle, où la répétition est transformée dans son cycle, et où chacun des spectateurs peut se projeter dans cet espace courbe et entrer dans le jeu des révolutions. Comme l’œuvre est dans un parc, c’est au spectateur de la faire vivre et de la définir comme une œuvre d’art plutôt qu’une simple sculpture décorative L’aspect identitaire du paysage montréalais permet plus facilement la relation entre le spectateur et l’œuvre. L’œuvre pourrait être perçue comme une mise en abîme avec son rapport à la ville puisqu’il est possible d’y voir la représentation d’un petit Montréal dans Montréal.
Pour conclure, la sculpture de De Broin marque l’identité du paysage montréalais par l’appropriation des escalier typiquement Montréalais résonnant avec les autres éléments, soit les structures de métal du pont Jacques-Cartier et les tourbillons de La Ronde. Sa référence à Montréal se voit non seulement par son visuel, mais aussi par son lieu d’exposition In Situ, Montréal. Pour aller un peu plus loin, on pourrait parler de pastiche ou d’une certaine forme de citation dans cette œuvre puisque la pièce de De Broin peut ressembler au Monument de la IIIe internationale de Vladimir Tatline (1920) (LE DEVOIR, 2002). De ce fait, on peut se demander si la sculpture pourrait aussi bien vivre dans un autre contexte et s’accrocher à une autre identité que celle de notre métropole (?)
BIBLIOGRAPHIE
LE DEVOIR. Sculpture publique – Un escalier en tourbillon. 2002. www.ledevoir.com. (page consultée le 3 octobre 2009)
LE METRO. Nouvelle œuvre d’art public à proximité du métro : Révolutions à la station Papineau. 2003. (page consultée le 5 octobre 2009)
MICHEL DE BROIN. www.micheldebroin.org. (page consultée le 5 octobre 2009)
Lumière et mouvement dans la couleur par Charles-Antoine Blais Métivier
Grande gagnante de l’appel du un pourcent lancé par Hydro-Québec dans le cadre de l’inauguration de leur nouveau siège social, la proposition de Jean-Paul Mousseau fut retenue pour le lien intrinsèque qu’elle entretenait avec la vocation de l’entreprise d’état.
Sur une longueur de près de vingt-trois mètres, une fresque de résine cache un complexe circuit de 1 280 mètres de néons multicolores qui alternent leurs intensités afin de créer, à chaque fois, une nouvelle combinaison de couleurs. On raconte que le nombre de combinaisons est si grand qu’il faudrait 150 000 ans avant de les épuiser. Vingt ans après son inauguration, le système électrique fait défaut et la murale s’éteint. Il faudra attendre jusqu’en 2002 avant qu’une équipe s’attarde à la remettre en état en remplaçant les circuits électroniques au cœur de l’œuvre.
Structure complexe, l’œuvre nécessite une équipe de techniciens pour veiller au bon fonctionnement de cette sculpture au caractère interdisciplinaire très présent. De ce fait, en abordant l’étape de la création de l’œuvre, de sa diffusion, ainsi que de la sa réception, nous verrons comment l’interdisciplinarité présente dans l’œuvre contribue à brouiller la paternité de Lumière et mouvement dans la couleur de Jean-Paul Mousseau.
Sans aucun doute l’attrait le plus marquant de l’œuvre, les combinaisons de couleurs quasi infinies sont permises par un système complexe de néons qui sont eux-mêmes contrôlés par un ordinateur, lequel répond à un simple algorithme mathématique. Ce système nerveux laborieux, en particulier pour l’époque, dépasse la compréhension et les connaissances d’un seul homme. L’œuvre ne peut donc pas être à l’origine de l’artiste seulement. Par son ambitieux projet et peut-être en toute connaissance de cause, Mousseau venait d’aborder l’épineuse question de la paternité de son œuvre en s’entourant d’une impressionnante équipe de techniciens diversifiés. L’œuvre empreinte de ce travail d’équipe et de différentes disciplines techniques, il ne reste qu’à l’artiste, le concept de cet impressionnant accomplissement.
La diffusion d’une œuvre aussi grandiose ne se fait pas sans contrainte, en particulier lorsque cette dernière est alimentée par l’électricité. Prônant la transcendance de l’être humain par le spectre de ses multiples combinaisons de couleurs, qu’arrive-t-il lors des pannes de courant? L’œuvre est-elle toujours Oeuvre lorsqu’éteinte? À son réveil, la murale récupère-t-elle son algorithme là où elle l’avait laissée ou est-elle contrainte à reprendre le travail depuis le début?
Ces questions anodines lancées à la volée, suffisent à ébranler les fondements de l’œuvre ainsi que son dessein. Par l’intégration de la lumière dans son œuvre, Mousseau relègue ainsi la transcendance de sa pièce à une entité impalpable.
Si Lumière et mouvement dans la couleur avait ébloui ses spectateurs lors de son inauguration en 1962, on ne peut en dire de même aujourd’hui. Certes, l’œuvre a gardé ses lettres de noblesses et présente toujours la ferveur et l’avant-gardisme de son créateur. Or, avec l’évolution des médiums publicitaires qui se ne cessent de se réinventer, le facteur obnubilant de la murale ne parvient plus à captiver ses spectateurs avec autant d’efficacité. Cette faute qui n’est pas attribuable à l’œuvre, découle de sa multidisciplinarité qui attribue à la pièce un caractère décoratif anodin, ainsi,l’œuvre pourrait passer inaperçue aux yeux d’un spectateur mal informé.
Si on peut douter que les questions évoquées ci-dessus étaient au cœur des préoccupations de l’artiste lors de la création de son œuvre, on ne peut nier que le facteur multidisciplinaire de Lumière et mouvement dans la couleur en brouille sa paternité. Par la multidisciplinarité de son œuvre, Jean-Paul Mousseau alimente un discours vieux de plusieurs siècles.
Reste à savoir si l’œuvre pourra compléter l’énorme algorithme qu’elle a entamé et si une mort éventuelle pourrait concorder avec le discours original de l’artiste.
Le Cycle Humain, par Véronique Proulx


 C’est à la bibliothèque municipale Saul-Bellow, Lachine, que nous pouvons admirer l’oeuvre permanente d’André Becot, Le cycle humain. ( figure 1a et b) La sculpture est une immense demie roue à pales, cinq pales plus précisément. À chacune des pales est intégrée une silhouette soit de face, soit de dos. L’artiste a choisi le ciment fondu pour réaliser cette pièce. Le choix de cette oeuvre repose sur son interdisciplinarité, l’artiste amène un coté très industriel et architectural à une pièce qui demeure profondément rattachée à des valeurs artistiques académiciennes. Comment le choix des matériaux et la représentation dans le cycle humain vient interféré, jusqu’à se contredire, dans la lecture de l’oeuvre d’André Becot? Nous tenterons de répondre à cette question en nous basant sur l’aspect la création et sur deux notions différentes, soit la simulation et l’indécidabilité.
C’est à la bibliothèque municipale Saul-Bellow, Lachine, que nous pouvons admirer l’oeuvre permanente d’André Becot, Le cycle humain. ( figure 1a et b) La sculpture est une immense demie roue à pales, cinq pales plus précisément. À chacune des pales est intégrée une silhouette soit de face, soit de dos. L’artiste a choisi le ciment fondu pour réaliser cette pièce. Le choix de cette oeuvre repose sur son interdisciplinarité, l’artiste amène un coté très industriel et architectural à une pièce qui demeure profondément rattachée à des valeurs artistiques académiciennes. Comment le choix des matériaux et la représentation dans le cycle humain vient interféré, jusqu’à se contredire, dans la lecture de l’oeuvre d’André Becot? Nous tenterons de répondre à cette question en nous basant sur l’aspect la création et sur deux notions différentes, soit la simulation et l’indécidabilité.
Le choix du ciment fondu pour cette réalisation amène une ambiguïté dans la lecture de par les différents rendus du ciment. D’une part, les pales ont une texture brute, souvent apparentée au béton de construction, utilisé en architecture. D’autre part les silhouettes vont chercher un fini beaucoup plus délicat et susceptible de nous rappeler l’utilisation des ciments fondus dans l’Art, autant pour les grandes statues de la Renaissance que pour les bustes plus contemporains. La notion de temps est très présente dans l’oeuvre d’André Becot, il est incontournable de faire part du temps relatif à la réalisation de ce type de projet avec ce matériau. Le ciment fondu étant lui-même très long à travailler.
Cette notion de temps vient aussi se manifester dans la forme dominante de la roue. En fait , c’est plus une simulation de la roue, une simulation de mouvement, ces cinq pales y font immédiatement référence. Avec les représentations très idéalisées des silhouettes humaines mises sur les faces de ces pales, nous faisons face à cette notion du temps qui passe. Le cycle humain montre cinq silhouettes: les trois premières plus référence à l’être humain qui se développe, l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte,( figures 2,3,4) elles donnent l’impression d’émerger du ciment pour aller de l’avant, toujours en lien avec le mouvement suggéré de la roue. Les deux autres pales nous offrent plutôt des personnes de dos, enfoncées dans le béton. Si nous suivons toujours le mouvement de la roue, elles nous amènent plus vers la décrépitude et la déchéance du corps, soi le vieillissement et la mort, le retour à la terre.( figures 5 et 6)
L’emplacement de l’oeuvre le cycle humain est extérieur pour une raison très évidente, elle perdrait énormément de sa valeur iconographique si le soleil ne pouvait pas la percuter pour donner une ombre portée qui nous représente la roue sous une forme complète. Le lien entre la réalisation matérielle et le titre en est que plus fort. Les pales sont en béton coulé d’une manière très impersonnelle et qui se rapproche plus du chantier de construction que de l’expression artistique. Les silhouettes par contre nous donnes à penser un milieu de l’art très exigent et ancestrale. Les personnages sont très idéalisées et tous identiques entre eux.
Pour conclure, nous dirons que la lecture de l’oeuvre est influencée par la subtilité du travail des matériaux et sa mise en place dans l’espace. Le lien entre le titre et la réalisation est suffisamment explicite pour comprendre la subjectivité de l’artiste.
Est-ce que dans l’art contemporain le titre doit absolument donner un lien suggestif ou peut-il pousser à réfléchir sur un autre degré de l’oeuvre?
Bibliographie
Le portrait officiel de la ville de Montréal, http://ville.montreal.qc.ca , visite le 13 octobre 2009

»40 ans 40 chaises » de Karine Galarneau, Patsy Van Roost et Judith Portier , par Amélie Audet
Jusqu’au 30 Octobre , à La place Pasteur , l’installation 40 ans 40 chaises , faite de chaises récupérées et tissées de rubans rouges en polypropylène, occupera l’espace afin de souligner le 40e anniversaire de notre chère Université. Réalisé par trois étudiantes ; Karine Galarneau, Patsy Van Roost et Judith Portier , ce travail est fait dans le cadre d’un stage de fin d’études au DESS en design d’environnement à l’UQÀM. Évènement, œuvre et hommage, ce projet fait appel à plusieurs compétences étant donné la complexité de l’intervention in situ dans un endroit public. En portant attention à l’appropriation du lieu, la notion d’atelier et à la diffusion de ce projet. On pourrait se demander; de quelle manière l’œuvre est influencée par son lieu d’exposition ?
Le monument de Louis Pasteur trônant comme un roi dans l’allée avec à ses côtés, deux chaises semblant faites pour ses loyaux sujets, démontre l’appropriation du lieu qui se fait dans le respect et la continuité de l’environnement tout en invitant les gens à s’unir ,<< (…)enseignants, employés, étudiants et passants afin de créer des lien entre savoir et société.>>[1]. Différents groupements de chaises créent des dynamiques propices aux rencontres ou à la découverte de la Place pasteur sous un nouveau jour. La configuration des chaises est faite de sorte que certaines sont attachées ensemble ou directement tissées de manière à être fixées au lieu . Tout est pensé en fonction de l’accès public de cet endroit. Par exemple, afin d’éviter les vols , le tissage a été complexifié et pour plus de confort des modifications ont aussi été faites pour encourager les passants à s’assoir! La notion d’atelier est vue de plusieurs façons dans la conception de ce projet. Dans un premier temps, de multiples essais en atelier classique afin de perfectionner la méthode de tissage. Par la suite, vient la nécessité du travail directement sur la place pasteur, car le tissage se fait à même la place au travers des arbres , du monument et du pavillon de l’université. Le blog diffusant les informations complémentaires à l’œuvre; plans, matériaux et commentaires des artistes, permet de suivre le développement de cette installation inspirée de la vocation première de la place, c’est-à-dire, aire de repos et site hommage.
Pour terminer, cette installation ramène l’attention sur un site et un hommage datant de plusieurs années en faisant cohabiter 40 ans 40 chaises à la Place Pasteur. Le lieu ayant déjà une histoire, les artistes travaillent cette connotation historique, les contraintes physiques du lieu ainsi que la variété du public qui aura accès à l’oeuvre . Ce qui permet de présenter à leur public une nouvelle interaction avec la place. Considérant l’intégration du monument à la mémoire de Louis Pasteur, on pourrait aussi se demander de quelle manière cette installation temporaire réactualise cet hommage à Pasteur ?
Bibliographie :
Karine Galarneau, Patsy Van Roost et Judith Portier, Occuper la place Pasteur , http://blogue.uqam.ca/pasteur/, visité en octobre 2009.
[1] Karine Galarneau, Patsy Van Roost et Judith Portier, plaque de présentation de l’œuvre 40 ans 40 chaises , à la Place Pasteur, octobre 2009.
« Temps d’arrêt » de Jean-Pierre Morin par Myriam Moreau
C’est dans le parc Molson de l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie que Jean-Pierre Morin nous propose sa sculpture d’aluminium et d’acier Corten, « Temps d’arrêt ». Tout en étant une proposition fondamentalement sculpturale, elle offre une expérience concrète et physique au spectateur en s’infiltrant dans l’espace public. Comment une œuvre paraissant strictement sculpturale tel que « Temps d’arrêt » de Jean-Pierre Morin peut malgré tout afficher un caractère interdisciplinaire? Nous éluciderons cette question en s’attardant aux aspects de la création, de la diffusion et de la réception de l’œuvre.
Tout d’abord, l’œuvre de Jean-Pierre Morin se distingue par l’intégration de matériaux industriels. L’aluminium et l’acier Corten sont souvent privilégiés dans le domaine manufacturier et dans celui de la construction pour leur résistance aux intempéries. Dans le cas de « Temps d’arrêt », nous constatons un détournement de la fonction usuelle des matériaux. Ces métaux sont habituellement choisis pour produire des objets utilitaires. Ce n’est toutefois pas le cas de la sculpture de Jean-Pierre Morin. Par son processus de création qui requiert des matériaux de construction résistants et durables ainsi que des techniques de travail spécialisées liés à ces matériaux tel que la soudure, nous pouvons dénoter un affranchissement du métier. [1]
Dans le même ordre d’idées, la diffusion de la sculpture de Jean-Pierre Morin s’affranchit du musée. Cette combinaison provoque une indécidabilité dans l’œuvre comme nous l’explique Patrice Loubier.[2] « Temps d’arrêt » se situe à la rencontre des nombreux sentiers qui sillonne le parc. Elle fait office de point de repère et de point de rassemblement. D’une part, « Temps d’arrêt » s’intègre dans le lieu par les formes organiques de l’aluminium qui rappelle les branches et la verticalité de la base qui rappelle les troncs d’arbres. D’autres parts, l’œuvre fait irruption dans le lieu en opposant ces matériaux industriels au côté naturel du parc.
En outre, la lecture que nous faisons de l’œuvre est influencée par l’espace public dans lequel elle se situe. La sculpture s’expérimente, se vit, se côtoie. Elle n’est donc plus mise au rang d’œuvre d’art intouchable. Elle devient accessible. Elle interpelle notre corps par notre interaction avec elle et sa dimension imposante. Nous pouvons également sentir que la sculpture est confinée ou entourée par le parc comme le parc l’est par la ville.
En somme, il est intéressant d’expérimenter une œuvre d’art public. « Temps d’arrêt » nous invite véritablement à prendre une pause en s’imposant au milieu du chemin. Elle nous amène à lever les yeux pour l’observer et par le fait même porter attention au paysage qui nous entoure. Ces branches d’aluminium tronquées et confinées proposent une belle réflexion sur le parc lui-même; sur la façon dont il contribue à l’interdisciplinarité de la sculpture. Il serait étonnant de voir la lecture que nous ferions de cette œuvre si elle se situait dans un lieu différent et la façon dont s’établirait le dialogue avec les matériaux.
[1] Patrice Loubier, « Embuscade et raccourcis » dans L’indécidable, écarts et déplacements de l’art actuel, sous la direction de Thérèse St-Gelais, Montréal, Éditions Esses, 2008, p.53-65.
[2] Ibid.
Bibliographie
Livre :
Loubier, Patrice, « Embuscade et raccourcis » dans L’indécidable, écarts et déplacements de l’art actuel,
sous la direction de Thérèse St-Gelais, Montréal, Éditions Esses, 2008, p.53-65.
Site Internet :
Ville de Montréal, Depliant_temps_arret.pdf http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_ros_fr/media/documents
/Depliant_temps_arret.pdf visité le 12 octobre 2009
Vile de Montréal, Ville de Montréal- Art public – Inauguration d’une œuvre d’art
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,3897227&_dad=portal&_schema=PORTAL
visité le 12 octobre 2009
« Musée du quotidien » d’Anne Ramsden, par Laurence Gagnon
Figure 1 : Anne Ramsden, Musée du Quotidien, 2005-2009, Montréal
Figure 2 : Anne Ramsden, Musée du Quotidien, 2005-2009, Montréal
C’est en déambulant dans les rues de Montréal qu’il est possible de découvrir une parcelle intéressante du travail d’Anne Ramsden. Son Musée du quotidien, projet en élaboration depuis 2005, consiste en un impressionnant assortiment d’affiches dispersées et placardées sur des murs de la ville. Dans le cadre du Mois de la photo, Ramsden donne à voir aux passants différentes collections d’un musée fictif, telles que Planche à découper, Prendre un bain (Figure 1) et Pause collation (Figure 2).
En s’intéressant de la sorte aux procédures d’archivage des institutions muséales et aux stratégies promotionnelles et publicitaires, Anne Ramsden propose une œuvre où les disciplines s’entremêlent pour former une proposition où on retrouve les notions inter et transdisciplinaires. Les affiches de l’artiste pour le Musée du Quotidien « tablent principalement sur la photographie […] pour mettre en perspective différentes facettes propres aux deux sphères où l’objet occupe une place prépondérante »[1]. Ainsi, Ramsden, en empruntant ces codes, en vient à déguiser son rôle d’artiste derrière ses affiches.
Il serait donc intéressant de se questionner quant à la manière dont la présence de l’artiste Anne Ramsden est dissimulée dans le Musée du quotidien. Cette problématique sera analysée sous trois aspects, soit l’appropriation de clichés amateurs issus d’Internet, la simulation d’un musée fictif et, enfin, le camouflage dans la ville des affiches.
Tel que le souligne Myriam Ross, du Musée régional de Rimouski, les affiches de Ramsden ont été conçues « à partir d’images généralement puisées sur des sites de partage accessibles par le Web »[2]. Les images qui composent les séries d’affiches ne proviennent alors pas, en réalité, de l’artiste et ne sont donc pas porteuses de sa trace artistique. Anne Ramsden s’absente ici pour témoigner du travail anonyme de l’Autre. Elle s’approprie et intègre directement des clichés sans mentionner leurs provenances ni leurs droits d’auteurs. Les images s’en trouvent ainsi doublement inconnues, car ni attachées à Ramsden ni associables à qui que ce soit.
Ses affiches font, dans un autre ordre d’idées, référence à un musée et une collection. Il s’agit là de la simulation d’une publicité urbaine annonçant des expositions fictives et inexistantes. En créant un faux musée, l’artiste se cache derrière une institution factice. En effet, elle « imite les procédures muséales de classification et d’inventaire »[3] et « tend à remettre en question le rôle muséal »[4]. Elle transfère l’attention, puis la réflexion spontanée que suscite l’œuvre sur le spectateur à une tierce partie, soit l’existence plausible d’une institution. La présence de l’artiste est ainsi oubliée au profit d’un questionnement concernant le potentiel musée, ses éventuelles localisations et programmations.
La mise en espace de l’œuvre de Ramsden ainsi que ses choix diffusionnels renforcent encore davantage l’aspect dissimulatif entourant le projet du Musée du quotidien. Les affiches Ramsdeniennes se fondent dans le panorama propre aux murs et palissades urbaines. La dissimulation provient donc du choix de placarder parmi les autres affiches plutôt que d’avoir recours à un espace exclusif, qui aurait éloigné ses œuvres de leur première lecture, soit la banalité et la généralité de leur support papier. Il va de soi qu’en introduisant avec autant de discrétion ses affiches sur le mobilier urbain, l’œuvre de Ramsden acquiert un caractère indéfini. L’artiste passe en effet incognito, mais ses affiches, dès lors qu’elles se font remarquer, piquent la curiosité.
En somme, l’artiste qui cherche à voiler sa présence doit souvent avoir recours à diverses stratégies. Dans le cas présent, Anne Ramsden fait notamment appel à l’appropriation, à la simulation ainsi qu’à la dissimulation pour renforcer le propos de son œuvre. L’artiste, par les stratégies précédemment énoncées, renforce son intention en anonymisant son passage dans l’espace public, tout comme la vaste majorité des éléments composant le paysage urbain deviennent rapidement invisibles. C’est lorsque l’affiche – l’œuvre – est repérée que son contenu cherche à transformer la barrière entre l’objet commun et l’objet artistique. Ainsi, il serait tout indiqué de se demander comment, dans les affiches du Musée du quotidien d’Anne Ramsden, le média publicitaire comme outil banal sert-il à affirmer la valeur culturelle des objets usuels?
Bibliographie
Anne Ramsden, http://www.ccca.ca/artists/artist_info.html?languagePref=fr&link_id=722&artist=Anne+Ramsden, [visité le 14 octobre 2009]
Myriam Ross, Musée régional de Rimouski, Anne Ramsden – La collection et le quotidien, http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=5518, [visité le 14 octobre 2009]
Optica – Sur l’expérience de la ville, http://www.er.uqam.ca/nobel/k31320/rams01.htm, [visité le 14 octobre 2009]
Patina – Anne Ramsden, http://www.museerimouski.qc.ca/guides/pdf/patina.pdf, [visité le 14 octobre 2009]
[1] Voir les sphères muséales et publicitaires dans le travail de l’artiste dans Anne Ramsden – La collection et le quotidien de Myriam Ross
[2] Information provenant du texte Anne Ramsden – La collection et le quotidien de Myriam Ross pour le Musée régional de Rimouski
[3] Voir le communiqué de presse de la 11e édition du Mois de la Photo, à Montréal
[4] Voir le communiqué de presse de la 11e édition du Mois de la Photo, à Montréal
L’attente de Guillaume Lachapelle par Élise Provencher
L’oeuvre d’art public choisie occupe une partie du défunt parc Belmont, ancienne attraction majeure,maintenant presque mythique, qui fit rayonner la ville de Montréal des années 1922 à 1982. Intitulée L’attente, elle fut réalisée par le jeune artiste montréalais Guillaume Lachapelle en 2008, l’année du 25e anniversaire de la mort du parc d’attraction. Elle fut proposée dans le cadre d’un concours lancé par le SDCQMVDE (Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle) pour commémorer le parc Belmont mais aussi pour souligner le 100e anniversaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Les matériaux sont tous assez traditionnels dans l’art en sculpture et correspondent aussi très fidèlement à la réalité matérielle des objets qu’on retrouve dans les parcs d’attraction. Le bronze, l’aluminium, le métal et le béton sont des matériaux froids, durs et résistants, idéaux pour une sculpture destinée à une certaine pérennité dans un lieu extérieur. La froideur des matériaux est aussi doublement ressentie puisqu’ils représentent un objet (le manège) qui devrait normalement être en mouvement, éclairé, occupé, sonore; presque vivant. Alors que L’attente nous rappelle davantage une carcasse métalique immobile et silencieuse, une photo antique en trois dimensions, et en noir et blanc aussi. La sensibilité visuelle et tactile sont interpelées. L’oeuvre à la forme essentielle d’un grand prisme rectangulaire. Au centre de la base carrée se trouve une voiturette d’auto tamponneuse, ou un wagon qui serait assez grand pour contenir quelqu’un mais dont le fond n’est pas creux, ce qui nous bloque l’accès. Aux arrêtes du sommet se dressent des structures de montagnes russes sur lesquelles glissent des petits bâtiments à logement en bronze. L’attente a comme support un petit espace vert d’environ trois kilomètres carrés, au bord de la Rivière des Prairies puis du pont Lachapelle, et entourés par de nouveaux condos modernes; l’ancien lieu exact où se déployait le Parc Belmont pendant une grande partie du XXe siècle à Montréal. Comment L’attente rend hommage à l’ancien parc Belmont?
Les langages présents dans l’oeuvre sont ceux de l’architecture, des structures construites pour l’homme; de la miniature en sculpture (les immeubles en bronze) et du jeu comme espace restreint dans un espace naturel destiné à poser des actions relevant de l’imaginaire, et non de l’utilitaire. Comme on peut occuper la sculpture sans y ‘‘faire’’ quoi que ce soit, elle est comme le concentré d’une aire de jeu qui n’existe plus, comme une trace inutile qui prend la forme d’une structure invitante mais restreinte au niveau du vrai jeu physique. On pourrait dire que cette représentation de l’aire de jeu dans l’espace même où l’idée de l’aire de jeu est évoquée au premier plan par une volonté de souvenir collectif agit comme une mise en abîme. L’espace vert appelé parc Belmont demeure une aire de jeu, un espace récréatif, et la sculpture illustre métaphoriquement le parc récréatif tel qu’il était dans le passé.
La sculpture, reproduisant dans son imagerie des objets et figures du parc d’attraction et pouvant contenir quelques visiteurs à la fois est aussi une simulation. Elle simule l’auto tamponneuse et l’aire de jeu d’une fête foraine. Toutefois, l’artiste a joué sur l’échelle des objets, rendant la scène un peu plus abstraite. Les rails de montagnes russes sont évoquées en miniature, ainsi que le bâtiments qui y glissent. L’auto, presque grandeur nature, est emprisonnée dans un espace simulant l’aire de jeu mais sa taille est réduite.
Beaucoup d’ambiguité peut se dégager lorsqu’on regarde cette oeuvre. Notamment l’aspect ‘‘cage’’ de la structure entière qui nous enferme. Le wagon ainsi représenté provoque la tristesse, ce qui convient au côté nostalgique de l’oeuvre, mais contredit les émotions normalement associées à une journée au parc d’attraction. On dirait que la mise en scène du wagon, avec les bâtiments en bronze qui tournent en rond comme aliénés, apportent à l’oeuvre un côté critique: c’est dommage d’avoir dû emprisonner ce souvenir pour le remplacer par des intérêts commerciaux immobiliers, municipaux, lucratifs et qui ne profiteront qu’à un petit groupe de privilégiés. L’oeuvre est somme toute aussi triste que le lieu où elle se trouve, et malheureusement ne participera probablement pas à augmenter son dynamisme… Cependant, rendre hommage est important et sa simple présence réussit cette mission.Le côté nostalgique et triste de l’oeuvre répond bien au déclin de Cartierville, autrefois quartier prospère, maintenant l’un des plus pauvres de Montréal. Sûrement est-ce lié justement à la disparition du parc Belmont.
Après avoir posé ces hypothèses avec l’exemple de L’attente, est-ce qu’on peut penser qu’une oeuvre d’art public porte en elle même l’histoire du lieu où elle se trouve de façon automatique? Autrement dit, est-ce que toute oeuvre d’art public est un travail in-situ?
Bibliographie
–Site de la ville de Montréal: http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,48895590&_dad=portal&_schema=PORTAL
visité le 8 octobre
–Loubier, Patrice : Embuscades et raccourcis. Formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain, L’indécidable – écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, 2008.
-Site de Yves Gaudreau sur le parc Belmont: http://pages.infinit.net/gautreau/belmont.html
visité le 8 octobre
Être ou ne pas être-Elise R.Guilbault
La publicité prend de plus en plus de place dans la vie de chacun de nous. Le regard étant sans cesse sollicité, il devient difficile de discerner publicité, œuvre et imagerie sans prétention artistique. Pour ce travail, j’ai choisi une édification que je considère comme œuvre, mais qui n’avait probablement aucune intention artistique lors de sa création. J’affirme ce fait de par son aspect usuel et de par l’anonymat de ses réalisateurs. En appliquant le questionnement à l’œuvre analysée, la problématique suivante se soulève : en quelles mesures un travail interdisciplinaire aussi complexe qu’un bâtiment urbain peut-il être considéré comme une œuvre d’art? J’aborderai l’analyse dans le même sens que Patrice Loubier dans son texte Embuscades et raccourcis[1].
La piste cyclable entre Longueuil et St-Hubert, construite parallèlement à la voie principale, devient une construction circulaire. Constituée principalement de métal et de béton, cette route cyclable et piétonnière croise un réseau ferroviaire et une autoroute.
En la regardant en contre-plongée, tout comme en étant à son plus haut point, la tour est extrêmement impressionnante. Cette impression concorde avec les avancées de Lupien[2], elle déverrouille des sens de l’individu qui se trouve In Praensentia de l’édification. Visuellement, la réalisation se compare à la tour de Babel, car elle semble s’élever pour se rendre jusqu’au ciel. Ce sentiment s’accentue par l’effort que le spectateur doit investir pour gravir la pièce; il faut pratiquement monter le monument en un jet. La couleur jaunâtre de son éclairage nocturne donne une prestance à l’édification, un aspect mythique s’en dégage. La forme circulaire de la pièce rappelle une arène de jeu. Même si le bâtiment ne semblait être édifié qu’à des fins pratiques et que le détenteur du projet n’avait probablement aucune intention artistique, l’œuvre d’art réside dans la subjectivité du regard. On ne peut tirer une ligne entre les considérations vraies ou fausses de cette pièce.
En art public comme ailleurs, seul le regardeur décide ce qu’il considère être un œuvre. Le souci d’esthétisme et le design intégré aux bâtiments urbains ne peuvent que rendre les activités quotidiennes plus agréables. Si l’on considère les constructions comme étant des œuvres d’art, croyez-vous que les gens qui forgent ces dernières doivent être à leur tour considérées comme des artistes? Où se trace donc la limite de l’artiste?
Bibliographie
- LOUBIER, Patrice, Embuscades et raccourcis, formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain,12 pages.
- LUPIEN, Jocelyne, « L’intelligibilité du monde par l’art » in Espaces perçus, territoires imagés en art, Caliandro, Stefania (dir.), Paris : Harmattan, Pages 15 à 35.
- LAFFONT, Robert, Dictionnaire des symboles (mythes, rêves, gestes, formes, figures, couleurs, nombres.), Paris, Éditions Jupiter, 1986.
Lien Internet
- Panoramio, http://www.panoramio.com/photo/11154229, visité le 12 octobre 2009.
- La route verte, http://www.routeverte.com/rv/index.php?page=partenaires, visité le 12 octobre 2009.
Numéro pour joindre le ministère du transport du Québec
- (450) 677-8974
[1] LOUBIER, Patrice, Embuscades et raccourcis, formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain,
12 pages.
[2] LUPIEN, Jocelyne, « L’intelligibilité du monde par l’art » in Espaces perçus, territoires imagés en art, Caliandro, Stefania (dir.), Paris : Harmattan, Pages 15 à 35.
ATELIER IN SITU : «MILIEU HUMIDE», par Steve Berthiaume

Atelier in situ, Milieu humide, 2009, installation publique, Ile-des-Sœurs (Photographie par Steve Berthiaume )
L’art est sujet de litige depuis quelques temps déjà dans la bucolique Île-des-Sœurs. En effet, l’œuvre d’architecture publique Milieu humide, conçue en 2007 par l’Atelier in situ et en cours de réalisation depuis l’été 2008 par Vlan Paysage, a immédiatement soulevée la controverse parmi les résidents du quartier (Vigneault, 2009). L’œuvre, située au centre d’un carrefour giratoire à l’entrée de l’Île-des-Sœurs et formée d’une multitude de tiges vertes et translucides, doit offrir aux spectateurs une expérience multisensorielle pouvant être constamment en mutation par son environnement immédiat (Atelier in situ, 2007). Malgré le fait que celle-ci fût sélectionnée parmi onze soumissionnaires à un concours organisé par la Ville de Montréal, certains détracteurs maintiennent que l’œuvre primée ne réflètent pas les 450 000$ de budget à sa confection (Vigneault, 2009) et surtout, que son esthétisme contraste avec l’aspect naturel du paysage et l’essence vitale du quartier. Partant de ces réprobations, je démontrerai comment les différents dispositifs interdisciplinaires déployés par l’Atelier in situ dans l’œuvre Milieu humide contribuent à faire de celle-ci une œuvre en parfaite concordance avec l’Île-des-Sœurs. Je répondrai à la problématique inhérente à l’oeuvre par deux aspects distincts, soit la simulation et la polysensorialité découlant de celle-ci, et le caractère indécidable de l’expérience de l’oeuvre dans son milieu.
L’œuvre Milieu humide, tel que son nom l’indique, se veut une simulation hi-tech d’un environnement, la reconstruction d’un écosystème inspiré des différents roseaux et autres plantations qu’on peut observer sur les rives de l’Île-des-Sœurs. Située principalement au centre du carrefour giratoire (rappelant la nature insulaire du lieu) et débordant quelque peu en périphérie, l’œuvre est constituée de deux parties. La première est constituée de matières naturelles dont des graminées et un pavage d’ardoise noire concassée ; différents stades de floraison permettront à la végétation de se déployer au gré des saisons (Vigneault, 2008). La seconde, plus substantielle, est surprenante avec sa portion artificielle, allignant de longues tiges vertes de 2 à 5 mètres rappelant les roseaux, mais qui reprennent beaucoup plus que leur simple aspect formel (Rudel-Tessier, 2009). L’impressionnant dispositif polysensoriel in praesentia permet aux spectateurs une réelle reconstruction du milieu naturel et joue simultanément sur tous les sens. En effet, les tiges translucides et photo-luminescantes pourront se mouvoir et réagir au vent, à l’eau, à l’humidité et à la lumière, de même qu’au gré du jour, de la nuit et des saisons. Pour se faire, les tiges contiennent des luminaires solaires, des pellicules réfléchissantes et phosporescentes qui, grâce à des récepteurs à ses extrémités, permettent d’utiliser l’énergie environnante à son bon fonctionnement. Une bruine se dégage de l’extrémité des tiges afin de compléter la parfaite simulation de l’atmosphère aqueux des marais (Atelier in situ, 2007). La simulation et la polysensorialité du dispositif montrent l’audace des concepteurs qui vont aller jusqu’à créer, en quelque sorte, un système vivant.
Cette notion de création d’un monde réel en utilisant des matériaux synthétiques ajoute au caractère d’indécidabilité de l’œuvre. Il est certain qu’une grande part du malaise provoqué chez le spectateur relève de cette notion. C’est le choc du paysage urbain construit en opposition avec le paysage naturel environnant. Le spectateur peut même s’y méprendre et confondre l’œuvre avec les codes de la signalisation routière. Plusieurs opposants ont également soulevés le fait qu’il devenait difficile d’avoir une bonne visibilité en voiture aux abords du carrefour (Loubier, 2008). Ce qui est intéressant malgré tout avec Milieu humide, c’est que même s’il semble y avoir un large fossé formel et esthétique entre l’emploi du plastique vert et la végétation plus authentique qu’elle cotoit, les barrières entre le monde fictionnel et celui de la réalité s’affranchissent et se brouillent lorqu’il est question du fonctionnement de l’ensemble, c’est-à-dire que la juxtaposition de deux systèmes vivants est en osmose avec son milieu.
Milieu humide pousse très loin l’idée de l’intégration d’une œuvre d’art public à son environnement, virtuellement à l’apanage de son milieu. Cet effet de simulation utilisant de la haute technologie a un coût, tant monétaire que logistique car depuis le début des travaux à l’été 2008, l’œuvre n’a pas réussi à être achevée car de nombreux bris et problèmes techniques se sont produits. Les citoyens n’auront donc jamais vu l’œuvre dans sa version définitive et optimale, lorsque la végétation naturelle s’intégrera parfaitement aux installations artificielles et cela, seul ses créateurs peuvent en être responsables. Le maire de l’arrondissement Claude Trudel, exaspéré par le projet et prenant parti des récriminations de certains citoyens en pleine campagne électorale, a annoncé le démantèlement définitf de l’œuvre lors du conseil municipal du 1er septembre 2009 (Vigneault, 2009) pour des raison d’esthétisme questionnable et de sécurité routière (Rudel-Tessier, 2009). Est-ce que Milieu humide connaîtra le même sort que Tilted Arc, de Richard Serra et qui fût sabordée en 1989 suite à différentes oppositions à la gigantesque œuvre public? Conséquemment, est-ce qu’une œuvre d’art public doit obligatoirement plaire au plus grand nombre et être accueilli unanimement avant d’avoir l’aval des autorités? Une chose est certaine, c’est que je crois qu’elle était en réel concordance avec son milieu naturel qu’est l’Île-des-Sœurs et qui sait, il est peut-être à se demander si les résidants ne devraient pas prendrent plus conscience de leur milieu environnant.

Atelier in situ, Milieu humide, 2009, installation publique, Ile-des-Sœurs (Photographie par Steve Berthiaume )
_____________________
Bibliographie
Atelier in situ : Projet Milieu humide, Référence Internet : http://www.atelierinsitu.com/2006/projets.php?id=92&PHPSESSID=17432ed1eb1fd070a69df94369277138, 2007 et consulté le 11 octobre 2009.
Loubier, Patrice : Embuscades et raccourcis. Formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain, L’indécidable – écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, 2008.
Rudel-Tessier, Mélanie : Controverse à l’Île-des-Sœurs, Référence Internet : http://www.creativitemontreal.com/articles/news/archive/2009/09/22/article-32395.aspx, article écrit le 21 septembre 2009 et consulté le 11 octobre 2009.
Vigneault, Pierre : Le projet «Milieu humide» sera abandonné, Référence Internet : http://www.lemagazineiledessoeurs.com/article-375621-Le-projet-Milieu-humide-sera-abandonne.html, article écrit le 10 septembre 2009 et consulté le 11 octobre 2009.
Vigneault, Pierre : Un «Milieu humide» qui ne fait pas l’unanimité, Référence Internet : http://www.lemagazineiledessoeurs.com/article-i277062-Un-Milieu-humide-qui-ne-fait-pas-lunanimite.html, article écrit le 30 novembre 2008 et consulté le 11 octobre 2009.
Révolutions, de Michel de Broin, par Gabrielle Lacroix Rioux
Lorsque vous approchez la station de métro Papineau, vous pouvez apercevoir Révolutions, de Michel de Broin, une sculpture en aluminium (500cm x 500cm x 850cm) créée en 2003 pour la ville de Montréal. L’œuvre se trouve à l’extrémité du Parc Maisonneuve-Cartier. De quelle manière l’œuvre Révolutions évoque-t-elle le paysage montréalais? J’analyserai l’œuvre sous trois aspects différents, soit l’interdisciplinarité, la diffusion et la réception.
D’abord, cette œuvre tridimensionnelle a été créée dans un processus et un esprit interdisciplinaires. L’artiste Michel de Broin joue d’abord le rôle d’anthropologue et d’historien puisque pour faire cette œuvre il a dû étudier le milieu où elle serait exposée afin de l’y intégrer et de le refléter. On voit tout de suite dans Révolutions les escaliers courbés caractéristiques de Montréal, cependant cet escalier est courbé à un tel point qu’il n’a ni début ni fin, rappelant le signe de l’infini. De notre position de spectateur, on se sent devant l’œuvre comme devant un manège qui s’apprête à partir, l’évocation du mouvement et la forme de l’objet sculptural faisant référence aux manèges grandioses de La Ronde. De Broin s’est donc inspiré de ces structures dans son processus créatif en étudiant le cartier. Il a dû ensuite aller chercher des spécialistes pour la réalisation de l’œuvre, soit des architectes et des gens qui travaillent le métal afin de construire cette structure symétrique d’aluminium.
Dans un deuxième temps vient la diffusion de l’œuvre. La sculpture de huit mètres de haut est installée en permanence au Parc Maisonneuve-Cartier, en face du métro Papineau. Je crois que l’œuvre s’intègre bien au milieu vu la couleur naturelle du matériau qui s’agence bien aux édifices et à la sobriété de l’entrée du métro et des arrêts d’autobus avoisinants, ainsi qu’aux pancartes et panneaux de signalisation. C’est un milieu public fréquenté et accessible puisque c’est un terminus d’autobus ainsi que l’entrée du métro, et c’est également situé à côté d’une épicerie. Révolutions sera certainement en place pour plusieurs années puisque l’artiste a utilisé un matériau de qualité, soit « [l’] aluminium marin, un alliage possédant une forte résistance à la corrosion et une solidité supérieure aux alliages standards. »
Dans un troisième et dernier temps vient la réception de l’œuvre. Je crois que cette œuvre est polysensorielle par sa ressemblance aux structures des manèges de La Ronde. Au premier coup d’œil, on est tenté de comprendre comment on pourrait grimper dans cet escalier impossible, puis quelque chose déclanche notre mémoire et on se souvient des battements de notre cœur, du bruit, des odeurs et de l’excitation qui accompagnent l’expérience des manèges. Il n’y a pas de doute sur l’identité de l’objet : c’est bien une œuvre d’art public. Le spectateur ne joue pas un rôle actif dans l’œuvre, c’est une expérience physique bien sûr puisqu’elle fait quand même 8 mètres de haut, cependant elle est inaccessible contrairement aux escaliers et aux manèges auxquels elle s’apparente.
L’œuvre de Michel de Broin évoque donc le paysage montréalais dans sa référence aux escaliers courbés et aux manèges de La Ronde, deux types de structures qui déplacent ou permettent le déplacement, à côté de la station de métro Papineau et du pont Jacques-Cartier. La polysensorialité sollicitée dans Révolutions ainsi que sa durabilité et son emplacement en font une œuvre d’art publique complexe. Si l’artiste avait fait en sorte que la structure soit en mouvement comme sa forme l’évoque, y aurait-elle gagné ou aurait-elle perdu tout son sens ?
Bibliographie
Métro de Montréal, http://www.metrodemontreal.com/art/debroin/revolutions-f.html, visité le 11 octobre 2009, document .pdf disponible en bas de page de la page 9 de l’édition du 12-14 septembre 2003
Le Devoir, http://www.ledevoir.com/2002/12/31/17378.html, visité le 11 octobre 2009
Michel de Broin, http://www.micheldebroin.org/projects/rev/4.html, visité le 11 octobre 2009

Michel de Broin, Révolutions, 2003, aluminium, Parc Maisonneuve-Cartier, Montréal (photographie tirée du site web de l’artiste comme indiqué dans la bibliographie)
· LE DÉJEUNER SUR L’HERBE DE DOMINIQUE ROLLAND, par Sandrine Côté
Réalisée dans le cadre du 2e Salon International de la Sculpture d’Extérieure de Montréal, exposée, tout d’abord, au Vieux-Port en 1994, puis déménagée et installée définitivement à Lachine, dans le Parc René-Lévesque, l’installation de Dominique Rolland s’inscrit dans une série de citations (Monet (1885), Cézanne (1870), Picasso (1961), Alain Jacquet (1964-1989), Gilbert Shelton (1972), Malcom Mac Laren (1980), Anthony Caro (1989), Jean-Claude Belegou (2001-2004) Pepe Smith (2003), Wifipicning Project (2003))[1] de la célèbre scène d’Édouard Manet Le Déjeuner sur l’herbe, peinte en 1862. En plus de l’importante réflexion historique que cette installation sculpturale suscite, Rolland mêle, à travers celle-ci, par l’exploration des formats des éléments de granit, de pierre et de bronze qui composent l’œuvre, les langages architecturaux et théâtraux. De quelles manières (stratégies) Dominique Rolland détourne-t-il, dans son installation Le Déjeuner sur l’herbe, le rapport frontal du spectateur de l’œuvre citée? Cette analyse sera dévellopée autour des notions de transmédiation et de théâtralité[2].
À prime abord, à travers cette installation sculpturale, Dominique Rolland cite l’œuvre de Manet, en se réappropriant le titre intégral du tableau, ainsi qu’en reconstituant l’univers de Le Déjeuner sur l’herbe par la juxtaposition d’éléments sculpturaux propres à un repas champêtre (une serviette à carreaux, un morceau de fromage, une baguette de pain, une assiette, une bouteille de vin entamée et son bouchon, un chien, une balle et un soulier abandonné). Rolland transpose ce thème pictural propre aux œuvres impressionnistes du XIXe siècle à un espace tridimentionnel. Il crée, à travers cette « adaptation transmédiatique »[3] de l’œuvre de Manet, un nouveau dialogue quant à la réception de l’œuvre puisque le spectateur devient, à travers celle-ci, véritable convive au repas qui lui est présenté plutôt que simple observateur.
En second lieu, contrairement au Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, Rolland, dans son installation, dirige davantage l’attention sur les composantes du repas , telles qu’énoncées précédemment, plutôt que sur les convives. Par à cette énumération d’objets inanimés, l’œuvre se présente sous la forme des natures mortes. Néanmoins, l’intégration de l’œuvre à l’espace public du parc permet d’interpréter les composantes sculpturales en tant que divers objets abandonnés lors d’un pique-nique plutôt qu’un exercice axé uniquement sur l’importance de la composition et de la représentation, ce qui allouant à l’œuvre, par le fait même, un caractère vivant et authentique[4].
Le Déjeuner sur l’herbe de Rolland se distingue aussi par l’exploration et la variation des formats des composantes sculpturales du repas. Chacun des éléments a été reproduit à plus grande échelle que leurs dimensions réelles, de sorte que les proportions des uns sont sans correspondance avec celles des autres. Ce jeu sur l’augmentation des dimensions confère à l’installation une théatralité, où l’identité de chaque composante, par son format parfois surdimentionné (entre autres, la bouteille de vin de plus de trois mètres de hauteur) s’efface pour laisser place à différentes formes qui entrent en relation les unes avec les autres et qui viennent structurer l’espace à travers lequel le spectateur se déplace. Celui-ci peut alors être considéré comme un acteur mouvant à travers le décor d’une scène théâtrale4.
En somme, l’adaptation transmédiatique de l’œuvre Le Déjeuner sur l’herbe de Manet par Dominique Rolland, la théâtralité provoquée par le jeu d’échelle et l’intégration à un lieu public qui contrecarre l’inertie des composantes de l’installation détournent la réception contemplative de l’œuvre citée puisqu’elle modifie le rôle d’observateur passif originel du spectateur face à l’œuvre de Manet, en lui attribuant , à travers l’installation de Rolland , la fonction beaucoup plus active d’acteur de la scène. Bien que l’œuvre sculpturale de Rolland fut amorcée en 1994, un projet vise à recréer un rapport de frontalité à celle-ci en intégrant un cadre qui redonnerait au visiteur qui se positionnerait en face de celui-ci, le rôle d’observateur[5]. L’intégration de ce nouvel élément serait-il néanmoins pertinent au propos de l’œuvre?
[1] RESTANY, Pierre. Alain Jacquet le déjeuner sur l’herbe : 1964-1989 : 25e anniversaire. Paris : La Différence, 1989, 45 p.
[2] L’art public à Montréal : la collection municipale. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154687&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=243 (visité le 13 octobre 2009)
[3] DUBÉ, Sandra et BROUSSEAU, Simon. Adaptation transmédiatique : une esthétique de la reprise. http://www.labo-nt2.uqam.ca/recherches/dossier/adaptation-transmédiatique ( visité le 11 ocotbre 2009)
[4] L’art public à Montréal : la collection municipale. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154687&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=243 (visité le 13 octobre 2009)
[5] L’art public à Montréal : la collection municipale. http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154687&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=243 (visité le 13 octobre 2009)
Melvin Charney Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseaux…une construction, par Julie Dumas
Au parc Émilie-Gamelin, l’art s’est fait une place dans le paysage urbain. Depuis 19921, une oeuvre de Melvin Charney trône au centre-ville. Aussi étrange que cela puisse paraître, il m’a fallu un travail scolaire pour réellement m’attarder à cette grande structure. Voilà bien la preuve que l’art sait parfois se perdre dans son environnement. Du haut de ses trois tours de 17 mètres de haut et de ses caniveaux de 8 à 32 mètres, la sculpture ne passe pourtant pas inaperçue. Sa massive structure d’acier et de béton rappelle d’ailleurs assez bien au spectateur la froideur des constructions urbaines. Pourtant, l’intention de l’artistesemble être plus que de l’aménagement paysager . Les canaux,symbole même de l’eau, sont présents justement pour faire le lien entre l’urbanité et le rural. C’est d’ailleurs autour de la question de cette frontière entre la dualité et le rapprochement que sera articulée cette analyse. Nous nous attarderons à déterminer en quoi le caractère interdisciplinaire de la conception nous amène à considérer l’oeuvre au-delà de sa forme sculpturale. Nous examinerons donc cela sous trois angles différents; soit la création, la diffusion et la réception.Maintenant, il est temps de rendre à Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseau..une construction ses lettres de noblesse.
En premier lieu, mentionnons que l’oeuvre de Charney se voulait une commande pour la ville de Montréal et qu’en cela, l’artiste a habilement réussi à se détourner des contraintes propres aux lieux publics en amenant le spectateur à percevoir l’oeuvre comme autre chose qu’une simple décoration. Le projet fut créé pour un emplacement fort particulier, celui du centre-ville, un point très représentatif de l’effervescence de l’activité humaine. Les matériaux choisis sont ceux du domaine de la construction donc n’appellent pas la poésie au premier abord, mais leur usage est transformé par l’agencement de la création. Il est intéressant de constater que plutôt que de se fondre dans le lieu et d’un peu nier sa propre existence, l’oeuvre assume totalement sa masse, encourage même la pente du terrain par la présence de ses digues. La construction d’acier illustre sans équivoque les nombreux édifices environnants, avec ses lignes nettes, ses innombrables fenêtres. Il y a interdisciplinarité, puisque l’aspect architectural est palpable. Le thème de la nature y est également présent dans la base de la structure. En ce sens, l’écologie y a sa place, par l’évocation du Mont-Royal.
En deuxième lieu, la notion de la diffusion ici est un concept si méditatif qu’il ne peut qu’être une démonstration du métissage disciplinaire. C’est-à-dire que les clés de compréhension de l’oeuvre ne nous sont pas toutes données, il faut s’attarder à cette pièce, comme on le ferait devant tout paysage.
Cela demande au spectateur une attention particulière.
Comme l’écrivait Patrice Loubier dans Embuscades et raccourcis,en s’attardant aux oeuvres interdisciplinaires: ».Dans tous ces projets,on le constate, l’objet prend place sans médiation ni signalétique artistique, mais il tend aussi à se fondre dans son milieu comme pour atténuer son intrusion. »2 Cette théorie est intéressante, puisqu’elle souligne que l’interdisciplinarité n’est pas qu’un amas éclatant de différents artifices artistiques. Et qu’une oeuvre de cet acabit joue de génie lorsqu’elle réussit à s’insérer dans un milieu sans toutefois s’y fondre totalement.
Cela nous mène donc au troisième point, celui de la réception de l’oeuvre. Comme mentionné précédemment, l’observateur conçoit à l’oeuvre une forte portée urbaniste. Il réalise que ces matériaux de fabrication réfèrent à l’aspect tactile de la ville, alors que la pente et les évocations plus naturelles des formes nous mènent à une facette plus environnementale. Dans les deux cas, le paysage est la trame, et on peut y comprendre la dualité entre l’industrialisation et la nature, au sens où l’homme conquérant tente continuellement de se prouver son contrôle sur l’environnement. Tel que mentionné par Sylvie Parent, critique d’art, la notion de transformation prime véritablement dans cette installation de Charney.3
C’est un peu le jeu du chasseur et de la proie, à savoir qui sera vainqueur et dominera le terrain. Il y a donc confrontation, mais également fusion entre les différents éléments. D’ailleurs, il est impossible de séparer les différentes composantes de l’oeuvre. Cela en fait donc une pièce vibrante d’unicité interdisciplinaire.
En conclusion, il va de soi qu’une installation telle que Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseau..une construction figure dans un environnement particulièrement favorable à son appréciation. Si elle comporte de nombreux repères paysagers ( le concept de la cascade, du ruissellement, des montagnes) ses assises sont ancrées dans une conception nouvelle de l’espace urbain. Melvin Charney nous indique avec cette création une façon différente de concevoir nos rapports avec la nature. Le titre dit beaucoup à ce sujet. » Une construction ».. Cela est fort révélateur de nos façons de concevoir le monde, de bâtir, mais peut être également perçu comme une ouverture sur la construction propre à chaque individu, sur les bâtiments que sont nos propres vies au sein des structures dans lesquelles nous évoluons. Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseau..une construction à l’image de l’humain?
Bibliographie
1Ville de Montréal,L’art public à Montréal, la collection municipale,http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154690&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=348, consulté le 5 octobre 2009
2Loubier Patrice,Embuscades et raccourcis, formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain.2008
3Parent, Sylvie, Centre international d’art contemporain de MontréalPROMENADES · L’ART DANS LA VILLE , Les Arts du Maurier Melvin Charney,http://www.ciac.ca/en/expos-prom-charney.html, consulté le 5 octobre 2009
Melvin Charney
Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseaux…une construction
Acier inoxydable; béton; béton préfabriqué; granit noir «Atlantic black» de la région de Mégantic
17 m de hauteur,8 à 32 mètres de longueur.
1992
Photographie de Julie Dumas
Regard sur le fleuve de Lisette Lemieux par: Françoise Ségard
Regard sur le fleuve, 1992, LEMIEUX Lisette, acier, 312 cm (H)
Pour cette analyse d’une œuvre d’art publique, j’ai choisi la pièce de Lisette Lemieux, Regard sur le fleuve. Elle a été réalisée en 1992 et se situe dans le parc Stoney point, au bord du fleuve Saint-Laurent, boulevard Saint-Joseph à Lachine. Elle appartient à la collection d’œuvres d’art publiques de Montréal et fait partie d’un des plus grands parcs de sculptures au Canada, le Musée en plein air de Lachine. C’est une œuvre en acier, de grande dimension. Regard sur le fleuve est une œuvre interdisciplinaire qui fait appel à la sculpture, au dessin, à la photo, à l’écriture, au jeu optique et au panneau touristique ou publicitaire. Dans le travail de Lisette Lemieux, on retrouve souvent les notions de transparence et d’opacité.
J’explorerai la problématique suivante : Comment l’artiste en signalant la présence du fleuve avec son œuvre Regard sur le fleuve nous invite à comprendre le paysage autrement?
Cette étude se concentrera sur trois aspects : la création, la diffusion et la réception.
L’œuvre de Lisette Lemieux est un grand panneau d’acier planté sur la rive du Saint-Laurent, dans un parc linéaire qui est fréquenté par des promeneurs ou des cyclistes. L’endroit est bucolique avec une accessibilité au fleuve aisée.
L’œuvre se présente aux spectateurs comme s’il s’agissait d’un panneau publicitaire ou touristique ou bien d’un immense tableau.
Le mot « fleuve » et sa réflexion ont été découpés dans l’acier. Le mot est écrit en majuscule et on peut le lire de très loin. Le mot réfléchi est traité comme si l’eau était agitée d’une petite brise et éclairée par un soleil levant ou couchant. On voit mal à travers ce panneau qui cache la vue sur le fleuve. Mais les lettres évidées et les incisions dans l’acier donnent l’impression de voir le fleuve. C’est perceptuellement faux puisque la pièce de Lisette Lemieux est un grand panneau qui obstrue la perspective sur le fleuve. Seules les interventions de l’artiste sur le panneau font ressentir cette vue. Chez le regardeur, ses autres sens vivent physiquement l’expérience d’une rive : brise, sons particuliers aux grands espaces, clapotis ou son du ressac des vagues, odeurs d’herbe.
Création
On observe plusieurs mises en abyme : d’abord le lieu où se trouve l’œuvre, puis le fait de citer par écrit ce qu’on voit puis de l’écrire à l’envers, ensuite, le format de l’œuvre rappelle un panneau touristique vantant le fleuve. Enfin, le titre fait redondance avec le paysage et on peut constater l’interpénétration du paysage urbain situé face au panneau. Cette œuvre joue des forces visuelles du paysage et est ouverte à plusieurs synesthésies.
Diffusion
La pièce est facilement accessible, dans un parc public, même si celui-ci se nomme Musée en plein air, cette accessibilité démocratique est accentuée par l’aspect formel de l’œuvre, un panneau réclame ou touristique. La plaque donnant des indications sur l’œuvre est située à quelques mètres, on peut facilement passer à côté sans la voir. Cependant, on remarque qu’il y a plusieurs pièces d’art contemporain dispersées dans ce parc. On devine qu’on se trouve dans un lieu d’exposition extérieure mais cette perception reste diffuse car les pièces sont éloignées les unes des autres et bien intégrées dans le parc.
Ce grand panneau d’acier fait écran au paysage qui, lui, est très dégagé. Habituellement, une œuvre d’art rendant hommage au fleuve n’en bloquerait pas la perspective. Le choix de l’opacité surprend le regardeur. Ce panneau tableau ne possède pas d’images à contempler.
Réception
Dans cette œuvre, il existe plusieurs formes d’indécidabilité.
L’œuvre est polysémique et engage la réflexion du regardeur dans diverses pistes car la représentation et la réalité du fleuve se juxtaposent. Tout d’abord, le lieu d’exposition de l’œuvre s’associe avec l’aspect historique des rivières au Québec. Puis l’utilisation de la langue française pour écrire le mot « fleuve » apporte à la pièce une donnée sociale et politique. L’art et la ville se rencontrent et Regard sur le fleuve devient un point de jonction dans la vie urbaine. Cette œuvre appartient à l’histoire de l’art contemporain avec un genre et à une époque spécifiques.
Interprétation
L’œuvre Regard sur le fleuve est en relation étroite avec le lieu. Le paysage participe à son sens et ne pourrait pas exister sans lui. En signalant la présence du fleuve par un très grand panneau où sont inscrits le mot fleuve et sa réflexion, où sont gravées les rides de l’eau, l’artiste nous invite à considérer le paysage autrement. Trop d’évidences font naître des questionnements.
Le lieu d’exposition de l’œuvre, à Lachine, rappelle l’aspect historique des rivières. En effet, le Musée historique de Lachine et le canal Lachine rappellent aux générations nouvelles l’importance du commerce de la fourrure au 19è siècle qui se faisait par voie d’eau. Ainsi Regard sur le fleuve porte un regard historique et ethnographique sur le paysage.
La langue française utilisée reflète une donnée politique et sociale. Les lettres n’amplifient pas seulement l’existence du fleuve mais aussi la spécificité culturelle et linguistique du Québec, en Amérique du nord. Localement, la population parle davantage anglais que français et ce mot tient lieu alors d’oriflamme.
Cette œuvre appartient au Musée en plein air de Lachine où ne sont exposées que des sculptures contemporaines. De plus, Regard sur le fleuve se situe dans un espace jalonné d’œuvres réalisées par des femmes, affirmant ainsi la présence des femmes en art contemporain. Cette œuvre fait donc partie d’une époque, celle de l’histoire de l’art contemporain.
Regard sur le fleuve est un point de jonction entre dans la vie urbaine qui intègre de nombreux éléments policés, et un élément de la nature, plus organique, plus rebelle, le fleuve.
Le médium utilisé, bien que très solide peut quand même se rouiller et à la longue l’œuvre peut s’user. Cela lui donne une composante organique qui n’est pas sans rappeler l’érosion dûe à un climat marin. La longévité de l’œuvre ne semble pas poser de problèmes avant longtemps de par sa matière et de par sa base, deux pieds ancrés solidement dans le sol.
L’œuvre de Lisette Lemieux signale la présence du fleuve Saint-Laurent et nous engage à en découvrir d’autres caractéristiques qui nous enrichissent sur la compréhension de ce paysage. La redondance des données visuelles et le titre de l’œuvre s’alignent vers le même objet : le fleuve. Cette œuvre d’art publique, tout en participant à un mouvement d’esthétisation du lieu, interroge le passant sur une situation aux multiples facettes telles que spatiale, temporelle, réflexive, politique et artistique. L’œuvre est traitée en acier et on peut y voir une analogie entre cette matière et la langue française. On en vient à se demander si la langue française requiert une force et une solidité comparable à l’acier pour s’imposer sur un continent déterminé à être anglophone.
Bibliographie
L’art public à Montréal
Christian Ruby, « L’art public dans la ville. »
http://espacestemps.net/document282.html
Google livre
http://books.google.ca/books?id
L’art français et francophone depuis 1980, Michael Bishop,Christopher Elson
Sherlock La bande d’information municipale
http://www11.ville.montreal.qc.ca/sherlock2/servlet/template/sherlock
Tango de Montréal, Les Industries Perdues. Par Frédérique Ménard-Aubin
 En 2000, les Industries Perdues, formées de Richard Purdy et François Hébert, ont inauguré l’œuvre Tango de Montréal. Cette œuvre d’art publique, située à l’extérieur de la station du métro Mont-Royal, a été conçue dans le cadre d’un concours de la Ville de Montréal visant à perpétuer la mémoire du poète Gérald Godin (1938-1994), dont le nom a été attribué à la place publique qui l’entoure. Cette œuvre d’art publique (7,23m x 7,23m) reprend l’un des poèmes de Godin qui est intégrée dans le mur nord de la maison au 4437, rue Rivard. Elle a été réalisée en argile cuite et en briques avec l’aide de Denis Marcotte, briquetier. L’œuvre d’art finale, Tango de Montréal, s’enrichit donc d’une diversité disciplinaire qui confère au poème de Godin une toute nouvelle perspective sculpturale. Nous reconnaissons bien que le poème est de l’art, mais qu’en est-il pour l’œuvre des Industries Perdues? En effet, comment pouvons-nous alors saisir que Tango de Montréal, des Industries Perdues, apparaît comme entité artistique englobant le poème de Godin? Nous éclisseront ce point en se penchant sur le concept de la citation en art visuel ainsi que de sur la stratégie du détournement et de la transmédiation.
En 2000, les Industries Perdues, formées de Richard Purdy et François Hébert, ont inauguré l’œuvre Tango de Montréal. Cette œuvre d’art publique, située à l’extérieur de la station du métro Mont-Royal, a été conçue dans le cadre d’un concours de la Ville de Montréal visant à perpétuer la mémoire du poète Gérald Godin (1938-1994), dont le nom a été attribué à la place publique qui l’entoure. Cette œuvre d’art publique (7,23m x 7,23m) reprend l’un des poèmes de Godin qui est intégrée dans le mur nord de la maison au 4437, rue Rivard. Elle a été réalisée en argile cuite et en briques avec l’aide de Denis Marcotte, briquetier. L’œuvre d’art finale, Tango de Montréal, s’enrichit donc d’une diversité disciplinaire qui confère au poème de Godin une toute nouvelle perspective sculpturale. Nous reconnaissons bien que le poème est de l’art, mais qu’en est-il pour l’œuvre des Industries Perdues? En effet, comment pouvons-nous alors saisir que Tango de Montréal, des Industries Perdues, apparaît comme entité artistique englobant le poème de Godin? Nous éclisseront ce point en se penchant sur le concept de la citation en art visuel ainsi que de sur la stratégie du détournement et de la transmédiation.
D’abord, Tango de Montréal présente, sur un mur adjacent à la station de métro Mont-Royal, un poème de Godin. Ce choix a été fait par Richard Purdy et François Hébert pour plusieurs raisons dont la longueur et le thème. Ensuite, il y a eu l’approbation officielle par un comité, dont faisait partie la veuve du poète, Pauline Julien. Cette citation retrouvée dans Tango de Montréal, réinvestit et réfléchit l’œuvre de Godin en faisait directement référence au métro, au commerce (l’av. Mont-Royal), aux résidents du quartier, et à la religion (le monastère avoisinant).
D’une autre part, les artistes des Industries Perdues ont usé d’une stratégie de détournement. Ils ont pris le mur de la rue Rivard pour la page d’un livre. Comme dans plusieurs autres œuvres, le détournement ajoute un nouveau sens et vient enrichir l’objet d’origine par une interprétation sensible. En effet, Tango de Montréal se présente comme un livre toujours ouvert, comme une œuvre qui se fusionne avec le peuple et le rythme urbain.
Ensuite, la transmédiation du poème de Godin s’effectue dans l’adaptation de l’art poétique à l’art sculptural. Un dialogue s’installe entre l’écriture (les pensées poétiques) et la marque, la trace dans l’argile et la brique. L’inscription des mots sur la façade du mur connote le poème sur les thèmes du passé et de la mémoire. La lecture de l’œuvre se fait donc à deux niveaux ; celle de l’œuvre originale et celle de la réécriture faite par les Industries Perdues.
En bref, les Industries Perdues détournent le mur du bloc appartement en une page de livre en plus d’y proposer une relecture du poème de Godin sous un format sculptural. Certes, cette fine stratégie de réalisation d’une œuvre d’art publique commémorative, utilisant la citation, laisse probablement certains montréalais dans l’ignorance, ne réalisant pas que ce mur est une œuvre d’art à part entière. Mais quelle est l’importance de réaliser que Tango de Montréal des Industries Perdues est une œuvre d’art, si sont rôle, déjà bien rempli, est de commémorer l’œuvre de Gérald Godin?
Médiagraphie
- La société des transports de Montréal (STM), www.stm.info/ info/ infostm/ 2004/041013.pdf, visité le 13 octobre 2009.
- Le métro de Montréal, www.metrodemontreal.com/art/industries-perdues/tango-f.html, visité le 13 octobre 2009.
- Société Radio-Canada, www.archives.radio-canada.ca/arts_culture/poesie/dossiers/83/, visité le 13 octobre 2009.
- L’art public à Montréal, www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154690&_ dad=portal&_schema=PORTAL&id=513, visité le 13 octobre 2009.
Mihalcean : une pratique interdisciplinaire? Par Jocelyne Thibault
Mon analyse porte sur une œuvre publique de l’artiste québécois Gilles Mihalcean intitulée Monument à la Pointe et réalisée en 2001. Situé à l’extrémité ouest du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, aux angles des rues Centre et Atwater, le monument fait 14 m de haut par 4 m de large. Il se sépare horizontalement en trois sections majeures, constituées elles-mêmes de trois éléments. La base présente trois piliers de béton. Le corps du monument est de forme triangulaire, lui-même séparé en trois étages de matériaux différents : le 1er tiers inférieur est un assemblage de dormants de chemin de fer; les murs du segment central sont en briques rouges qui rappellent l’architecture des maisons et commerces du quartier; le tiers supérieur évoque les parois d’un navire et son bastingage par l’assemblage de panneaux d’aluminium blancs boulonnés. Enfin, le monument est coiffé de trois cheminées blanches. L’architecture singulière du monument, les matériaux qui le composent ou encore sa localisation révèlent une pratique artistique interdisciplinaire. En raison de l’éloquence de son titre, je tenterai d’identifier comment les composantes du Monument à la Pointe de Gilles Mihalcean participent à son appropriation par les résidents de ce quartier. J’aborderai la question à partir des notions d’interdisciplinarité, d’intégration et d’indécidabilité.
La notion d’interdisciplinarité participe à l’œuvre de Mihalcean. En effet, outre l’apport créatif et les notions de moulage requises – entre autres pour les pilotis –, l’artiste met en application des connaissances de construction de bâtiment (excavation, maçonnerie). Par une stratégie d’intégration de matériaux identifiables, l’artiste ne cherche pas à évoquer autre chose, mais insiste sur le sens intrinsèque des matières, des formes et des couleurs utilisés. C’est précisément leur combinaison inattendue qui participe, en un sens, à l’indécidabilité de l’œuvre en faisant appel à des notions socio-historiques. Comme le dit si bien Jean-Philippe Uzel, « le jeu sur les formes et les couleurs est aussi ici un jeu sur la fonction sociale et culturelle des artefacts » (Uzel, 2008, p. 44). Ici, les dormants de chemin de fer rappellent la proximité de la voie ferrée qui borde le quartier, les briques rouges font écho aux habitations et manufactures d’hier et d’aujourd’hui, et la présence d’indices maritimes connotent le lien viscéral entre l’histoire du développement de Pointe-Saint-Charles et celui du canal Lachine. Le même monument aurait un écho différent s’il était érigé, par exemple, au sommet du Mont-Royal!
Je dirais que le sens global de l’œuvre arrive par la juxtaposition des matériaux, chacun évoquant un aspect socio-historique du quartier. Il est intéressant de considérer l’indice iconique du vert comme étant la couleur des Irlandais. Vers 1850, une vague d’immigration déferla sur Pointe-Saint-Charles. Cette nouvelle main-d’œuvre contribua entre autres à la construction du canal Lachine et à l’érection du Pont Victoria, deux structures incontournables du développement commercial et industriel de l’époque. La position du vert à la base renvoie à l’idée de ces immigrants irlandais comme étant les piliers du développement.
Le monument marque l’espace au centre d’un simple carrefour giratoire. Il siège comme un phare. Bien qu’il s’agisse d’un monument commémoratif d’un passé récent, son éloquence architecturale et iconique sera-t-elle suffisante pour assurer sa compréhension chez une clientèle nouvelle, considérant que ce quartier en mutation gagne en popularité?
BIBLIOGRAPHIE
UZEL, Jean-Philippe. 2008. « Les objets trickster de l’art actuel ». In St-Gelais, Thérèse et Fraser, Marie. L’indécidable : écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal : Éditions Esse, 278 pages.
After Babel/a public suqare par Jennifer poitras
Photo de After Babel / a public square:
Jonh McEwen et Marlene Hilton-Moore, After Babel / a public square, 1993, installation d’acier et bronze, place Albert Duquesne (coin Maisonneuve et St-Urbain)
Photo par : http://www.ferneyhoughgallery.com/images/MHM%201993%…
After Babel, a public square (Oeuvre d’art publique)
Par : John McEwen et Marlene Hilton-More. (Cette œuvre fut créée pour le 350ième anniversaire de Montréal.)
Située sur la place Albert-Duquesne. (Coin Maisonneuve et St-Urbain)
L’œuvre d’art publique After Babel, a public square de John Mcewen, en collaboration avec Marlene Hilton-More, est une installation de quatre sculptures, dont deux placées sur des colonnes de style dorique. On retrouve, sur une colonne la silhouette d’un loup, un autre loup semblable se retrouve au sol le regard levé vers la deuxième colonne où se juche un masque à visage humain. La quatrième sculpture représente deux mains qui démontrent le signe de l’amitié en langage sourd et muet. Les mains sont de bronze et les autres sculptures sont faites d’acier. L’interdisciplinarité jaillit dans les signes compris à travers l’œuvre, soit : le théâtre, le langage des sourds et muets, l’utilisation de figure mythique comme le loup et d’éléments architecturaux historiques. Le caractère hétéroclite de l’œuvre m’amène à m’interroger sur la manière dont la mise en relation des objets de l’installation propose différentes narrations ou trames narratives. J’étudierai la question à l’aide des notions de simulation, d’indécidabilité et de réception.
Premièrement, la notion qui prédomine, selon moi, dans cette œuvre est la simulation. On reconnait les représentations réalistes, mais schématiques dans la silhouette des deux loups, dans le masque représentant le visage humain, dans les deux mains ainsi que dans la reprise des colonnes doriques. De plus, on simule aussi une interaction entre les personnages soit les loups et le masque. Deuxièmement, la notion d’indécidabilité surgit, selon moi, dans l’incongruité du lieu où se trouve l’œuvre. Au coin de deux rues achalandées, on se retrouve projeté dans un monde imaginaire. Le monde réel de la ville se trouve à côtoyer un monde parallèle où loup et masque communiquent et où des mains indépendantes d’un corps nous font un signe. L’auteur Jocelyne Lupien démontre que le spectateur peut en présence de ce type d’œuvre se sentir projeter dans un monde qui semble parallèle et de ce fait se pousser à se questionner. Elle utilise l’artiste Gwenaël Bélanger pour expliquer sa théorie. D’une autre part, l’indécidabilité transparait aussi dans l’utilisation de multiples icônes appartenant à des sphères différentes. Par exemple la figure mythologique du loup peut être vue comme une créature sanguinaire ou encore, comme une figure maternelle protectrice, ce qui est le cas dans la légende des fondateurs de Rome, avec Remus et Romulus. Ensuite, on retrouve la sphère du théâtre qui est représentée dans le masque, qui peut nous renvoyer à l’hypocrisie, jouer un rôle ou encore, au drame. Les mains représentent le signe de l’amitié dans le langage des sourds et muets. Les colonnes doriques, quant à elles, vont donner un aspect d’importance aux deux figures surélevées. En terminant, la notion de réception m’a inspiré pour ma problématique vu la complexité et la différence des sphères représentées, il est possible que l’observateur y voit une signification ou une narration différente de celle de son voisin. D’ailleurs, en prenant l’exemple du loup, qui tout dépendamment de la culture de l’observateur, peut influencer sa perception de l’œuvre. Ou encore, pour une personne qui ne connait pas le langage des signes, celle-ci peut y voir autre chose, comme l’entraide.
Finalement, l’œuvre démontre une sensibilité narrative que chacun peu s’approprier à sa façon. Personnellement, la communication entre le masque et le loup prédomine dans la narration que j’entrevois dans cette œuvre. J’y vois aussi une répartition des pouvoirs dans l’utilisation des colonnes et un jugement envers la figure du loup qui se retrouve seul au sol. Le masque agirait comme le juge de celui qui se doit d’être impartial, mais l’utilisation d’un visage humain démontrerait cette impossibilité chez l’homme. Les mains agiraient comme traductrices ou comme avocates. En bref, j’interprète cette scène comme un tribunal dans un monde parallèle ou imaginaire. Le fait de création de cette œuvre pour le 350ième anniversaire de Montréal joue-t-il un rôle dans la narration de l’œuvre?
Bibliographie:
-Ville de Montréal, l’art public à Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154690&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=353
visité le 9 octobre 2009
– CIAC, promenade l’art dans la ville
http://www.ciac.ca/en/expos-prom-mcewen.html
visité le 9 octobre 2009
Analyse de l’oeuvre publique L’attente, 2009,de Guillaume Lachapelle, par: Carine Morin
 |
L’œuvre analysée ici s’intitule «L’attente», 2009, de Guillaume Lachapelle. Il s’agit d’une sculpture composée de matériaux tels l’aluminium, le béton, le bronze ainsi que de divers autres métaux.
La sculpture est l’agencement d’une seule voiturette au milieu d’une petite cour dans laquelle elle ne peut réellement circuler. Cette dernière est située dans l’arrondissement de Cartierville où jadis fut implanté le parc Belmont. L’interdisciplinarité se ramifie dans le langage technique de la sculpture et celui de l’histoire des lieux et de ses références. Voici une image pour appuyer ces dires.
 photographe anonyme, ouverture du parc Belmont en 1923, source internet. photographe anonyme, ouverture du parc Belmont en 1923, source internet. |
Ma problématique se pose donc comme suit : en quoi l’emploi d’éléments identifiables, telle la voiturette de l’œuvre de Guillaume Lachapelle, «L’attente», 2009, renforce-t-il le caractère historique du site de cette œuvre? Pour traiter cette question, nous analyserons la notion de l’intégration, puis celle de [l’indécidabilité ( la version de Patrice Loubier)] puis nous terminerons avec la notion de la simulation.
La notion d’intégration :
Il est clair qu’il y a intégration par la mise en espace d’un objet usuel comme «l’auto tamponneuse» et que cet élément est altéré par le matériau qui le compose, à l’occurrence du métal très lourd (certainement truffée de béton), et est ancré au sol. La relation entre la reproduction et sa composition matérielle est primordiale et surtout symbolique. J’interprète la légèreté du jeu, son amovibilité, son insouciance à l’oppression du métal qui permet de le confiner, de par sa durabilité, aux rigueurs du temps qui passe. C’est le prix à payer pour qu’un parc, qu’une époque puisse s’inscrire dans l’histoire, même si cela semble ironique quant à l’origine de l’idée ici traduite.
Par cette opposition forte, mais révélatrice et facilement repérable, le spectateur est confronté à l’insertion de signes dans l’espace public. On dissimule la fonction première épicurienne du wagonnet dans une cour froide, trop petite, et inexploitable pour ce dernier. L’œuvre apparaît comme une anomalie pour la mémoire de cet emplacement parce qu’elle n’est pas utilitaire, ni même amusante, elle est simplement commémorative et à la limite ennuyante.
Commentaire :
Il faut savoir que le parc Belmont était la référence en matière de divertissement de 1923 à 1983, comme aujourd’hui l’est la Ronde. C’est d’ailleurs cette dernière qui a sonné l’heure de la retraite de cet ancien lieu de récréation.
La notion de simulation
La sculpture simule le jeu, les visiteurs peuvent entrer dans la scène, s’asseoir dans le manège, l’expérimenter, mais rien ne bouge. Tout est statique. Il y a une part de vrai parce qu’il est amusant d’être confronté à devoir s’asseoir sur le petit chariot pour l’expérimenter, de réaliser que notre corps d’adulte ne peut accéder au siège, faute de proportion. La représentation nous renvoie à nos souvenirs, de bons pour la plupart d’entre nous, mais il y a aussi une part de faux. Il ne s’agit que de souvenirs, que d’un monument commémoratif d’où la fonction, de par sa mise en forme, n’est point de rester dans l’atmosphère des belles années du parc Belmont, mais de démontrer en quelque sorte, la brutalité du temps qui passe. Il y a aussi la manière dont on a décidé de fermer le parc! Le développement de la banlieue a pris le dessus.
L’artiste a hautement misé sur des symboles reconnaissables par tous pour passer un message à tous ceux qui ont vécu ou simplement ouï-dire comme moi de cette époque alliée à ce site festif qui est désormais occupé par une série de condominiums.
Le parc Belmont est un espace vert près de la rivière des Prairies. Les lieux sont paisibles, voire vides, à peine meublés d’une sculpture un peu en retrait, et de très peu de visiteurs. La nostalgie est omniprésente. Il me semble que la génération qui a fêté cet endroit y réside aujourd’hui dans un tout autre état d’esprit semble-t-il? Nous sommes tous à l’assaut du temps et parfois il présente qu’il est nécessaire de figer celui-ci dans un assemblage un peu insolite. Le parc Belmont est aujourd’hui un lieu empreint de solitude, mais est-ce vraiment le reflet d’une génération précise qui y a vécu et qui vieillit?
Bibliographie :
Art public de Montréal, http://ville.montreal.qc.ca, visité le 7 octobre 2009.
Les leçons singulières (volet II) de Michel Goulet par Stéphanie De Couto Costa
L’œuvre les leçons singulières (volet II) à été la première œuvre d’art public réalisée dans le cadre du Plan d’action en art public de la Ville de Montréal. Cette œuvre réalisée en 1991 par l’artiste sculpteur Michel Goulet, fabriquée d’acier inoxydable et de bronze occupe le belvédère du parc Lafontaine. Ainsi, l’espace soulève des enjeux publics qui montrent le caractère interdisciplinaire de cette installation. De quelle manière le corps social se distingue-t-il de la collectivité à l’intérieur de la sphère publique dans l’œuvre les leçons singulières (volet II) de Michel Goulet. Nous étudierons la question à l’aide des notions d’intégration, de détournement et d’indécidabilité.
La notion d’intégration est montrée par l’appropriation d’objets du quotidien tel que la chaise, la table, ainsi que les objets diversifiés placés en dessous de chaque chaise (journaux, espadrilles, livre, sac froissé, ballon de foot, jumelles.). Ces objets usuels sont transformés comme objet d’art par le simple constat de l’artiste. Nous pensons alors au ready-made de Duchamp. La répétition des chaises transmet la sensation de singularité, voir d’individualité. Ainsi, nous mettons l’accent sur le rendu formel de chaque élément et nous construisons un système d’identification individuelle. Ceci provoque un détournement par rapport à la fonction de l’objet. D’une part, son utilité est contrée par son statut d’œuvre d’art. Nous sommes portés à les contempler plutôt que de s’y installer. D’autre part, l’emplacement dans l’espace détourne leur fonction symbolique. Une table qui sert habituellement à unir est en contraste avec les chaises qui cherche à se différencier les unes des autres.
Ce détournement brouille le régime de valeur des objets. Justement, la disposition des objets coupe la possibilité de discussion; brime « la valeur d’usage de l’objet fonctionnel, la valeur d’échange de la marchandise, [et] la valeur conviviale de l’objet relationnel.»1 La polysémie de l’objet rend la réception de l’œuvre indécidable. D’ailleurs l’indécidabilité est perceptible par l’esthétisation de la sphère publique. Les objets placés sous les chaises sont coulés en bronze, donc perdent leurs valeurs d’usage et rendent les objets «à la fois saisissable[s] et insaisissable[s].»2 Ces éléments sont des outils relatifs aux activités pratiquées dans un parc (lecture, observation, sports…). Plus particulièrement, l’artiste questionne la relation qu’entretiennent les montréalais avec cet espace car les journaux illustrés sont le Devoir, la Presse et la Gazette, puis la carte sculptée sur la table est une représentation du parc Lafontaine. Donc, l’installation met en jeu le corps du passant et ainsi se questionne sur la politique des relations sociales dans un espace précis.3
Enfin, le public est dépeint à travers la personnification de chaque chaise, jusqu’à croire qu’elles sont formellement descriptive des objets placés en dessous. L’artiste illustre un ensemble collectif, allégorique des usagers du parc, mais structure l’environnement afin de préciser leur individualité. Le parc est représenté comme un espace civique, dont la transformation physique et psychologique est possible par la volonté de tous. Justement, la carte sculptée repose sur quatre formes géométriques qui représentent l’espace comme une fabrication de l’homme sans cesse interchangeable. Or, chaque personne lui trouve son compte, glorifiant même la banalité du quotidien en moulant des objets d’activité récréative en bronze. Je me questionne sur l’effet de l’art public sur la collectivité. L’art public contemporain doit-il rendre hommage à l’identité locale, ou devrions nous promouvoir un art d’agitation en forme d’intervention public/politique?
Bibliographie
[1] Uzel, Jean-Philippe, « Les objets trickster de l’art actuel », L’indécidable – écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, 2008.
[2] Uzel, Jean-Philippe, « Les objets trickster de l’art actuel », L’indécidable – écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, 2008.
[3]Ruby, Christian, « Susciter des archipels », L’art public, un art de vivre la ville, Bruxelles, la lettre volée, 2001.
Goulet, Michel, Œuvres publiques, http://www.michelgoulet.ca/fr/oeuvrespub/index.htm, visité le 12 octobre 2009.
Loubier, Patrice, « Embuscades et raccourcis. Formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain », L’indécidable – écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, 2008.
Ville de Montréal, Art public à Montréal, http://montrealmetropoleculturelle.org/portal/page?_pageid=678,1154690&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=343, visité le 12 octobre 2009.
« Legoisme », de Roadsworth, par Emilie Fortier
L’artiste canadien Peter Gibson, mieux connu sous le pseudonyme Roadsworth, reçu en 2006 une commande de la ville de Montréal dans le but de réaliser une première oeuvre légale dans sa ville d’adoption, deux ans après que celle-ci l’ait accusé de vandalisme. En résulte l’oeuvre Legoisme, immense fresque réalisée à l’aide de peinture et de pochoirs et couvrant une grande partie du pavé situé à l’entrée nord-est du Palais des congrès, laquelle relie aussi la station de métro Place-d’armes. Utilisant la taille des dalles de béton pour y représenter des pièces de Lego surdimensionnées, l’artiste fait une incursion dans le monde du jeu, en plus de s’approprier une partie de l’espace public dont la prise en charge esthétique relève habituellement de l’architecture ou encore de l’urbanisme. De plus, celui-ci a choisi un traitement formel associé à « l’art de rue » – terme englobant à mon sens tant les graffitis que la signalisation routière peinte au sol – ce qui en fait une oeuvre résolument interdisciplinaire. De ce fait, je tenterai de démontrer comment l’utilisation d’une technique associée au vandalisme (le graffiti) participe à créer une incertitude concernant le statut artistique de l’œuvre Legoisme. Pour ce faire, je me pencherai sur les notions de création, de diffusion et de réception.
Au niveau de la création, on peut parler d’« affranchissement du métier » (tel que vu par Loubier)[1] puisque l’artiste utilise un procédé qui ne requiert aucun savoir-faire artistique à proprement parler ; ayant comme seuls outils quelques pochoirs aux formes géométriques simples et de la peinture en aérosol, l’artiste aurait très bien pu être remplacé par quelqu’un n’ayant jamais peint de sa vie. De plus, le mariage entre le médium utilisé (la peinture en aérosol) et la surface envahie (le pavé d’un lieu public très fréquenté) est nécessairement associé aux réalisations de certains graffiteurs, taggeurs et muralistes dont le statut d’artiste est généralement nié au profit de celui de « vandale ». Par ailleurs, l’intégration harmonieuse du tracé avec la surface d’origine ainsi que le choix chromatique d’un joli camaïeu de bleu peut faire croire à une revitalisation plutôt originale de celle-ci et ayant donc un but purement décoratif. Ainsi, l’artiste ne s’affiche qu’à travers un style qui lui est propre, mais qui ne correspond pas aux critères normalement connus du grand public, lequel est davantage initié à l’esthétique institutionalisée de l’art et qui correspond peut-être plus à celle issue des Beaux-arts.
Du point de vue de la diffusion, force est de constater qu’ils n’existe aucun indice reliant Legoisme à une quelconque institution artistique. Inaugurant un nouveau programme de financement de l’art public dans l’arrondissement Ville-Marie, « Vill’Art-Marie », cette commande n’a eu que peu de publicité et n’a pas été inscrite dans le parcours artistique d’un musée, galerie ou centre d’artiste d’envergure. Donc, en plus de prendre place à l’extérieur du cadre muséal, cette oeuvre n’est pas reliée au monde de l’art par le biais d’une institution ou d’un événement reconnu et ne comporte pas de fiche signalétique : seule la présence des lettres « RW » (pour Roadsworth) apposées au sein de la fresque font office de signature. Ainsi, même un regard averti peut être sceptique face à l’apport artistique d’une telle occupation de l’espace public, à moins d’être déjà familier avec la pratique singulière – et illégale à l’origine – de l’artiste.
Face à ces deux aspects de l’œuvre, on peut parler d’indécidabilité au niveau de la réception, tel que développé par Patrice Loubier, dans le sens où l’œuvre analysée « comporte une qualité mimétique : l’objet s’immisce dans un contexte non préalablement cadré comme artistique, et ce, à la faveur d’un camouflage qui lui permet de s’intégrer à son milieu. » [2] Ainsi, les blocs Lego appropriés par Roadsworth sont insérés dans l’espace public par le biais d’une technique dont le caractère intrinsèquement furtif est contrecarré par la monumentalité de la fresque, créant ainsi un effet de surprise de la part du spectateur. De ce fait, la réception de l’œuvre est manifestement ambiguë puisque le spectateur est confronté à une esthétique qui lui est connue et qu’il n’associe pas à l’art et qui se retrouve habituellement dans de tels lieux, mais dont l’ampleur et la rigueur de la composition semblent sous-entendre l’instauration d’un cadre préalable. De plus, le spectateur est forcément contraint de piétiner l’œuvre, et donc de l’altérer. Cette expérience est donc résolument antagoniste de celle vécue avec les œuvres d’art conventionnelles.
En conclusion, en jouant sur le caractère ambivalent des graffitis, Legoisme brouille les codes de reconnaissance artistique de par sa surprenante intégration au lieu, tout en provoquant à la fois sceptiscime et émerveillement face à l’utilisation ludique et poétique d’un procédé honni par la société. De ce fait, elle suscite une réflexion autour d’un certain hermétisme des conventions artistiques malgré un décloisement récent, en plus de questionner le rapport existant entre spectateur, œuvre publique et urbanité. Étant donné le caractère éphémère de l’œuvre, celle-ci n’existe plus aujourd’hui. Cependant, on pourrait se demander si l’impact serait aussi fort aujourd’hui face à une œuvre semblable réalisée dans un cadre différent, étant donnée la notoriété actuelle de l’artiste dont les œuvres sont d’emblée acclamées et donc dépossédées de leur caractère subversif. Ou encore : est-ce qu’un procédé perd de son impact lorsque celui-ci est banalisé?
[1] LOUBIER, Patrice, « Embuscades et raccourcis : Formes de l’indécidable dans l’art contemporain », L’indécidable : écarts et déplacements de l’art actuel, Canada, Les éditions esse, 2008.
[2] LOUBIER, Patrice, « Embuscades et raccourcis : Formes de l’indécidable dans l’art contemporain », L’indécidable : écarts et déplacements de l’art actuel, Canada, Les éditions esse, 2008.
Pic et Pelle de Germain Bergeron par Janie Julien-Fort

Bergeron, Germain, Pic et Pelle, 1978, métal, Passerelle de la station de métro Monk (Photographie de Janie Julien-Fort)
Dans la station de métro Monk, nous pouvons voir deux sculptures monumentales représentant deux personnages affairés à la tâche. Les sculptures sont des structures de métal orangé faites d’anciens luminaires de rue recyclés mesurant chacune 6,2 mètres. Cette œuvre se nomme Pic et Pelle et a été réalisée par Germain Bergeron en 1978. Comme ces œuvres sont intégrées à l’architecture du métro de Montréal, nous pouvons considérer qu’elles sont interdisciplinaires puisque l’artiste s’est approprié plusieurs langages. Dans ce texte, je tenterai de résoudre la problématique : comment la représentation des personnages dans l’oeuvre Pic et Pelle de Germain Bergeron contribue à rendre hommage aux ouvriers ayant participé à la construction du métro? J’étudierai cette question en observant les aspects de création, de diffusion et de réception du modèle d’analyse. En premier lieu, je me pencherai sur les stratégies utilisées par l’artiste telles que l’appropriation, l’intégration et la transmédiation pour représenter les personnages. Par la suite, je parlerai de la mise en abîme présente dans le choix du lieu de diffusion. Ensuite, je me pencherai sur l’effet produit par la dimension de l’œuvre et sa disposition sur la réception de celle-ci.
Cette oeuvre a été commandée à Germain Bergeron par l’architecte de la station lors de la construction du métro. On demandait à l’artiste de réaliser une œuvre commémorative pour les ouvriers morts lors de la construction du métro. L’artiste a plutôt décidé de réaliser une œuvre représentant tous les artisans et travailleurs du métro: « Finalement, j’en suis venu à la conclusion que pour réaliser un métro, il faut travailler au pic et à la pelle, selon l’expression québécoise qui signifie travailler de façon très ardue et très laborieuse. C’est ainsi que j’ai proposé au BTM de réaliser ces deux sculptures qui représentent tous les ouvriers qui ont participé à la réalisation du métro. « (1)
L’appropriation d’une expression typiquement québécoise et sa transmédiation en sculpture fait référence à la culture populaire. Il y a également appropriation d’un fait historique dans cette œuvre puisqu’elle s’inspire directement de la construction du métro de Montréal. Des matériaux peu traditionnels sont intégrés tels que les lampadaires. De plus, nous pouvons constater une intégration de véritables outils de construction magnifiés puisque la pelle et le pic dans les mains des personnages sont très réalistes. Bien que l’œuvre soit réalisée à partir de métal et mesure plus de deux étages, une finesse se dégage des personnages par leur forme élancée évoquant le dessin d’observation d’un personnage en action. Elle rappelle les traits dessinés à la sanguine pour représenter les lignes principales du corps. Cette stratégie visuelle met l’accent sur la position des personnages en action et contribue à l’anonymat de ceux-ci. Le pic et la pelle utilisés par ces personnages sont quant à eux très réalistes, ce qui met en évidence les outils. La station de métro Monk est située dans le sud-ouest de la ville en pleins cœurs des quartiers ouvrier. Nous assistons donc ici à une mise en abîme à plusieurs niveaux puisque les ouvriers sont représentés dans un quartier ouvrier. Les sculptures représentent des travailleurs du métro dans le métro que des ouvriers doivent utiliser quotidiennement pour aller travailler. Cette œuvre intégrée dans la passerelle du métro Monk nous oblige à passer entre les deux personnages comme si nous traversions leur chantier. Nous avons soudainement la sensation d’être très petits et vulnérables à leur côté puisqu’il mesure plus de deux étages.
Nous pouvons conclure que, par l’utilisation de différentes stratégies visuelles Germain Bergeron a réussi à rendre un véritable hommage aux travailleurs ayant participé à la construction du métro. L’appropriation d’une expression québécoise dans le titre et la représentation de l’œuvre vient souligner l’ampleur du travail des ouvriers. Le choix de matières recyclées sans noblesse nous ramène à la culture populaire, au métier d’ouvrier et à sa classe sociale. La transmédiation du dessin d’observation vers la sculpture et la représentation de véritables outils met en évidence l’action effectuée par les personnages. La mise en abîme présente dans le choix du lieu de diffusion et la dimension de ces œuvres vient glorifier les actions de ces deux hommes à l’ouvrage. Germain Bergeron a réussi à magnifier le simple ouvrier ce qui constitue un grand hommage dans une ville et un quartier où se reflète encore un passé ouvrier pas si lointain. Au fait, pouvons-nous encore considérer le sud-ouest de l’île comme un quartier ouvrier?
(1) STM, « Les artistes du métro de Montréal : Germain Bergeron » Metro, mardi 28 octobre 2003, Canada, 2003, p.9
Bibliographie :
- Info STM, « Les artistes du métro de Montréal : Germain Bergeron » Metro, mardi 28 octobre 2003, Canada, 2003, p.9
- Dubé, Sandra. Brousseau, Simon, Adaptation transmédiatique : Dialogue transmédiatique : une esthétique de la reprise, http://www.labo-nt2.uqam.ca/recherches/dossier/adaptation_transm%C3%A9diatique, visité le 12 octobre 2009
- McLauchlin, Matt, Germain Bergeron, http://www.metrodemontreal.com/art/bergeron/index-f.html, consulté le 11 octobre 2009
- STM, L’art dans le métro, http://www.stm.info/metro/art/index.htm, consulté le 11 octobre 2009
- Direction des bibliothèques, Université de Montréal, Station de métro Monk, Montréal, 1978, http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/_diame&CISOPTR=3422&CISOBOX=1&REC=2, consulté le 11 oct 2009
- Guimond, Marc, STM, Montréal en Métro, Canada, Guide de voyage Ulysse, 2007
Annexe :

Figure 1: Bergeron, Germain, Pic et Pelle, 1978, métal, Passerelle de la station de métro Monk (Photographie de Janie Julien-Fort)

Figure 2: Bergeron, Germain, Pic et Pelle, 1978, métal, Passerelle de la station de métro Monk (Photographie de Janie Julien-Fort)
L’Homo Urbanus de Éric Lamontagne par Priscilla Leclaire
Éric Lamontagne est un artiste d’installation, photographe et peintre. En 2005, il est choisi parmi plusieurs artistes émergents du Québec pour réaliser une œuvre dans le cadre de la politique de l’intégration des arts à l’architecture du gouvernement du Québec. Elle fût acquise dans le cadre du programme 1 % pour l’art du gouvernement du Québec lors de l’aménagement du nouveau terminus d’autobus. L’artiste présente l’Homo Urbanus, une œuvre proposant de la photographie installé de façon inusité. Il est possible de contempler cette œuvre à la station de métro Côte-Vertu, dans l’aile nord de l’édicule Côte-Vertu Nord. Il serait intéressant d’analyser de quelle façon la notion d’anonymat est traité dans l’œuvre de Lamontagne et ce en considérant la question sous trois aspects différents, tout d’abord par l’appropriation d’une certaine technique de présentation, ensuite par la mise en abîme du concept de l’installation et puis, finalement, par la diffusion de l’œuvre en dehors du musée.
Tout d’abord, il faut souligner qu’avec l’Homo Urbanus, Éric Lamontagne propose au spectateur et donc, du même coup, au simple voyageur du métro, une œuvre mettant en scène cent quatre-vingt-cinq personnages photographiés d’en moyenne quinze centimètres de hauteur. L’artiste traite chaque petite personne comme le ferait un collectionneur de papillons, c’est-à-dire que les photographies sont soigneusement placées sur un fond. Lamontagne utilise ici un miroir, et il emprunte le geste minutieux du collectionneur qui épingle au thorax ces bestioles. Si chacune de ses bestioles» sont positionnés de face et très près du miroir, elles ont cependant les yeux fermés. De plus, il est intéressant d’observer que l’artiste ajoute à son œuvre une plaque explicative où il est possible de permettre au spectateur de lire et de comprendre devant quoi il se trouve. Il y inscrit : Pour montrer son désintéressement à toute agression, l’Homo Urbanus présente le dos à tout prédateur potentiel. Seul en transport en commun, l’Homo Urbanus pratique le mimétisme urbain qui reflète sur le devant de son corps son environnement immédiat pour se fondre dans l’anonymat de la foule. [1]» Avec cette plaque, Lamontagne s’approprie l’effet d’une visite zoologique, où les visiteurs sont habituellement amenés à lire les informations sur les animaux dans les enclos. Il est évident que l’artiste tente de transporter le spectateur vers une problématique comportementale de l’individualisme humain dans le milieu urbain en lui rappelant ce même phénomène chez les animaux.
Ensuite, il est important de mettre en évidence que Lamontagne présente une œuvre d’art public qui met en scène ce même genre de public c’est-à-dire que l’artiste positionne chaque spectateur dans le même groupe de ce qu’il est en train d’observer. Le spectateur est placé devant son propre spectacle de mimétisme urbain lorsqu’il se place devant le miroir. L’observateur est amené à participer à l’œuvre en se mélangeant à cette foule d’individus inconnus. Il devient alors un autre de ses figurines anonymes et par le fait même un Homo Urbanus.
Puis, il est intéressant de mentionner l’importance du lieu de l’exposition de l’œuvre. Cette installation est intégrée à l’architecture de la station de métro et peut être totalement invisible pour certain des utilisateurs du transport en commun. Même si la pièce met en scène une foule de personnages, le voyageur n’est pas toujours spectateur. Ces cent quatre-vingt-cinq individus restent dans l’anonymat et réussissent à se camoufler grâce à l’intégration architecturale urbaine de l’œuvre.
Bref, en mettant l’accent sur le concept même de son œuvre, Éric Lamontagne réussi avec brio à présenter le phénomène de l’individualiste urbain du 20e siècle en attirant le spectateur vers son propre comportement mimétique. Il sera intéressant de se questionner sur l’impact de cette œuvre si elle était placée à l’intérieur des lieux institutionnels d’exposition d’art.
1 http://www.metrodemontreal.com/art/lamontagne/metro-f.html
Figures ci-dessus : Éric Lamontagne, L’Homo urbanus, 2005. Miroir, photographies. Hauteur 128cm × largeur 195cm.
Emplacement: Station Côte-Vertu, aile nord de l’édicule Côte-Vertu Nord. (http://www.metrodemontreal.com/art/lamontagne/metro-f.html)
Révolution de Michel de Broin par: Julien de Bellefeuille
L’œuvre Révolution de Michel de Broin est une sculpture monumentale présentant des escaliers en aluminium dont le parcours forme une spirale sur elle-même. L’œuvre est présentée à l’extérieur dans un parc dans la ville de Montréal. Cette caractéristique est importante à noter, car le fait que l’œuvre soit présentée à l’extérieur, dans un environnement public, signifie que l’artiste doit nécessairement tenir compte dans sa démarche du lieu de diffusion, afin d’assurer une cohérence dans le discours que l’oeuvre propose. Cette caractéristique est spécifique à l’art public, car elle implique que l’oeuvre opère dans un espace complexe qui comprend des éléments dont la signification lui est propre et la définit. Révolution porte donc une problématique intéressante sur le dialogue que partage l’œuvre avec son lieu d’exposition. Cette problématique sera donc abordée à travers les trois phases d’analyse de l’œuvre soit : la création, la diffusion et la réception.
En observant l’oeuvre Révolution, on constate immédiatement que le principal élément mis en place, par l’artiste, est l’élément architectural des escaliers. L’intégration de cet élément réfère directement aux escaliers en spiral que l’on retrouve partout dans la ville avec les appartements. L’oeuvre exerce ainsi un rapport urbain/nature avec le parc où elle se situe, ce qui peut être perçu comme une mise en abyme avec le rapport qu’occupe ce même parc avec la ville. L’utilisation de tels matériaux industriels est de plus en plus fréquente dans l’art contemporain, ici, son utilisation est d’autant plus naturelle puisqu’elle sert à entretenir un rapport avec son lieu d’exposition. On comprend également qu’un tel projet a nécessité la collaboration de plusieurs personnes de différents milieux pour la conception et l’installation d’une telle structure, afin d’assurer une bonne résistance aux intempéries et une sécurité pour les passants. Mais cette caractéristique est nécessaire pour toutes les oeuvres diffusées dans un espace public. L’entretien qui nécessite des techniciens est aussi normal que les méthodes de conservation ou de restauration qu’exercent les spécialistes engagés par un musée pour assurer la conservation d’une œuvre. On ne peut donc pas attribuer le titre de pluridisciplinaire ou interdisciplinaire à une œuvre qui nécessite ce genre de modalité pour assurer sa préservation.
En s’attardant plus attentivement sur le lieu de présentation de l’œuvre Révolution, on remarque que les liens crées par les escaliers sont indirecte. Lorsque l’on observe l’œuvre dans le parc, on ne remarque pas de lien formel entre les deux objets, le parc ne contient pas d’escalier et ses arbres dissimulent en grande partie les immeubles environnants. Bien que le lieu exposition interagisse sur l’œuvre, celle-ci n’est pas pensée comme œuvre in-situe. L’œuvre pourrait très bien se trouver dans un autre parc de la ville sans pour autant changer sa nature.
Cette relation entre l’œuvre et son environnement semble bien comprise du public, les œuvres diffusées à l’extérieur ne sont plus rares aujourd’hui. Le système du 1% a beaucoup contribué dans l’initiation du public par leurs nombreuses diffusions à l’extérieur d’œuvres d’art. On constate que les gens ne sont pas surpris de voir de telles œuvres dans les espaces de leur quotidien, celles-ci se fondent à leur environnement.
En conclusion, on peut se questionner sur la notion d’interdisciplinarité qui est associée généralement aux œuvres diffusées dans les espaces publics. Les espaces extérieurs ne sont plus des espaces marginaux de la diffusion de l’art, la sélection d’un artiste au programme de 1% ou toutes autres commandes pour la diffusion d’une œuvre à l’extérieur est toujours un point prestigieux pour la carrière d’un artiste. Bien que ces espaces impliquent certaines contraintes dans le processus de conception de l’œuvre, celles-ci devraient avoir les mêmes considérations comme lieu de diffusion de l’art comme les musées et galeries d’art.
« Neuf couleurs au vent » de Daniel Buren par Lupita Diaz
L’artiste contemporain Daniel Buren (1938- ) est un remarquable représentant de l’art actuel. Buren est originaire de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, France. Cet artiste a touché plusieurs domaines: la sculpture, la peinture, la vidéo, les films, et le son. En plus, l’écriture occupe une place centrale dans sa vie car il est un théoricien de son propre travail. Buren accompagne toujours ses installations de notes explicatives.
La diffusion de l’œuvre : Neuf couleurs au vent a été réalisée en mai 1984. C’est une œuvre in situ.
«Le travail in situ est le seul qui puisse permettre de contourner, et de s’adapter à la fois, et intelligemment aux contraintes inhérentes à chaque lieu. Le travail in situ peut dialoguer directement avec le passé, la mémoire, l’histoire du lieu, puisque l’on sait que l’œuvre projetée en question y prendra place.»1
Cette œuvre interdisciplinaire a été commandée par le Centre International d’Art Contemporain de Montréal (CIAC) Pour célébrer le 450e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier au Québec. Cette œuvre est commémorative, mais sans indication. Cette sculpture appartient à la collection d’art public de Montréal. La sculpture Neuf couleurs au vent a été installée en 1996 à la Place Urbain-Baudreau-Graveline, Rue Sherbrooke Est à Montréal avec la collaboration d’un architecte du paysage.
La création de l’œuvre : La sculpture a une base de pôles en aluminium, et neuf bannières en nylon. L’installation a été complétée avec l’excavation, la fondation et finalement l’ancrage. Chaque bannière est de forme rectangulaire et présente des bandes verticales d’une couleur soit le noir, le bleu, la verte, le rouge, et le jaune. Ces bandes verticales colorées alternées de 8.7cm de largeur alternent avec des bandes blanches de façon répétitive. Pour Buren la rayure représente l’anonymat, ces rayures sont devenues la signature de Buren, on les retrouve dans plusieurs de ses œuvres. La matière utilisée pour les bannières, le nylon est une matière non courante pour une sculpture commémorative. Dans le même sens la base de cette œuvre ne ressemble pas aux monuments commémoratifs conventionnels. Buren n’utilise pas de matériaux traditionnels à la sculpture commémorative parce qu’il refuse les canons établis or les institutions de l’art comme le musée, et la galerie. Buren a une vision subversive de l’art. Il pense que le musée paralyse l’œuvre dans un espace-temps et la rend silencieuse par le rassemblement. Buren pense aussi que le musée annule la vérité et la vérité de l’œuvre. De plus, le musée donne à ce qui est exposé un statut d’art, crédulité et une valeur marchande. Le musée assure la diffusion et la consommation de ce qui est exposé.
Neuf couleurs au vent est diffusé dans l’espace public sur la rue Sherbrooke et sur l’Internet. Cette œuvre est accessible à tous. Selon moi la sculpture est bien intégrée à la Place Urbain-Baudreau-Graveline parce qu’on regarde l’œuvre en marchant sur la rue Sherbrooke et que les couleurs s’harmonisent avec le parc. Buren réalise un art éphémère. Par contre, la sculpture Neuf couleurs au vent restera à Montréal en bon état parce que le service de la collection d’art public aux techniciens en font l’entretien pour sa conservation.
La réception de l’œuvre : Cette sculpture donne l’idée de la diversité culturelle parce qu’elle montre différentes couleurs. En plus, les rayures sont une partie de l’emblème et de la signature de Buren. Le fait de mettre ces bannières hors du musée donne à cette œuvre une dimension vivante. Elles jouent avec le mouvement du vent.
Le mouvement dans la sculpture de Buren est dynamique grâce au mouvement des bannières. Elles représentent pour moi, les citoyens en mouvement comme ceux que l’on on voit dans la rue.
La sculpture Neuf couleurs au vent pourrait, pour les non inities a l’art s’apparenter à une publicité ou à un objet qu’ils ne pouvaient pas identifier.
Je pense que l’œuvre de Buren est une œuvre d’art qui est polysémique parce que Neuf couleurs au vent a plusieurs sens. Cette œuvre m’amène à réfléchir sur la fragilité humaine car la bannière, pour moi, est fragile comme notre existence. Daniel Buren est un artiste très célèbre et je pense qu’il a son style comme artiste. Mais est-ce que les gens que ne connaissent l’art peuvent l’identifier comme nous le faisons, nous les artistes ou les étudiants en l’art?
1Buren Daniel, À force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y montrer,
France, Sens et Tonka, 2004, page. 81
Bibliographie
Buren Daniel, À force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y montrer,
France, Sens et Tonka, 2004
Ricard Matthieu, Plaidoyer pour le bonheur, France, NiL éditions, 2003
Sites Internet
Tous droits résérves Ville de Montréal, 2009, Septembre, «l’art public à Montréal» .En ligne
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Burenhttp://www.danielburen.com/>
Consulté le 5 octobre 2009.
Wikipedia, 2009, Octobre, «Daniel Buren». En ligne
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Buren>
Consulté le 5 octobre 2009.
Copyrigtht 2004 Daniel Buren, 2009, Janvier, «Daniel Buren». En ligne
<http://www.danielburen.com/>
Consulté le 6 octobre 2009.
Echec et mat Place Emilie-Gambelin
Peter Gibson allias Roadsworth,« Échiquiers sur dalles »,
Place Emilie-Gamblin, 2007
Conçu par l’artiste Roadsworth et inaugurés en juin 2007, L’œuvre représente six échiquiers géant composés de 64 dalles, 32 noires et 32 grises.
Ce projet est une initiative de la Ville de Montréal par le biais du groupe Dada Diffusion Art actuel. C’est une œuvre participative qui a donné, donne et donnera lieu à un réseau d’autres activités. Par exemple durant l’été une série de concerts et de performances sonores ont eu lieu sur la place dans le cadre des « Jeudis d’Émilie ».
Le projet est donc composé de plusieurs éléments appartenant à différents médiums ainsi qu’en différentes phases. Par une description méthodique de ces différentes phases, on tentera de tisser des liens qui nous éclairons sur le caractère interdisciplinaire de cette œuvre et de savoir sur quel plan elle se révèle le plus efficace.
La première phase et le moment de la création de l’œuvre qui comprend
En premier lieu une partie peinte réalisée par Roadsworth . Il y a les échiquiers qui reprennent le dallage préexistant de la place qui fait référence à l’architecture, délaissée, de cette place.
C’est sur ce même damier que des pièces d’échec géantes sont peintes l’aide de pochoirs et de canettes de peinture. Cette pratique s’apparente au « Sreet art » par son mode opératoire et son lieu de diffusion. On peut également l’apparenter à une forme de ‘ «(post) pop art » par l’utilisation du symbole et la simplification, ou schématisation de la forme.
En deuxième lieu on a les pièces. On pourrait les apparenter à de la sculpture (par leurs formats imposants ?), mais on aurait tendance à attribuer ce genre de réalisation à un artisan : il s’agit d’un modèle industriel en plastique thermo coulé … Une référence aux ready-mades de M.Duchamp ?
En tout cas tout est en place pour la deuxième phase. La notion de jeu entre en compte.Une notion chère aux artistes et c’est également ce qui permet du lien social un des objectifs de cette pièce.
En troisième lieu, on aurait donc des personnes de tout milieu social se rencontrent pour jouer aux échecs. Des touristes, des montréalais, étudiants de l’UQAM, qui est juste à côté, les clochards et toxicomanes pour qui la place et un QG la journée. C’est également là qu’est servie la soupe populaire tous les soirs.
On y rencontre des « Cas soc. » comme on dit, ex dépendant aux drogues ou encore au jeu tout aussi bien qu’une famille de passage. Voir une fillette de 9 ans de bonne famille en découdre aux échecs avec un clochard mal rasé de 50 ans buvant « discrètement » sa bouteille de bière.
Viennent ensuite « Les jeudis d’Emilie » ainsi que d’autres événements ponctuels. Ce sont des événements réguliers dans le but d’accentuer et de renforcer les rencontre et de consolider le rôle social de l’œuvre.Un animateur a été engagé pour gérer les parties d’échec assurant ainsi la mixité des rencontres.
C’est donc le tout qui crée l’œuvre, une oeuvre jouable, une œuvre vivante.
À l’été 2009, vu que la peinture avait décollé, on a repeint les dalles, en noir et gris. On a encadré les damiers, chacun avec une couleur particulière. Un extrait de poème est inscrit dans la bordure lui donnant l’ aspect d’ activités manuelles effectuées par les enfants d’une école. On pourrait s’intéroger sur les arrangement de conservation de l’œuvre.
Mais en fait? Est-il encore pertinent de parler en termes d’art contemporain ici ? Il s’agit d’un projet social ça c’est sûr…Mais…
J’ai choisi cette œuvre car au début je voulais travailler sur une autre sculpture de la place, celle de Melvin Charney : « Gratte-ciel », cascades d’eau/rues, ruisseaux… ,1992Une œuvre commandée par la Ville de Montréal. L’installation est faite d’acier inoxydable, de béton, de granit noirs «Atlantic black» de la région de Mégantic.Elle est très grande ,17m, et je ne l’ai jamais vue en marche, à part une fois où j’ai vu quelqu’un uriner dedans, ce qui en rajoute à son état de délabrement. Elle me faisait l’impression d’une œuvre morte que personne ne voyait plus.Puis sur la page place Emilie-Gamelin de Wikipédia j’ai vu que les échiquiers de la place, où je jouais tous les jours, étaient également une commande dans cadre d’un projet d’art public. Un lien m’a guidé directement sur la page du collectif Dada diffusion.
On peut dire qu’il s’agit d’un projet « d’art populaire ». Les échecs ne font pas forcément référence à M.Duchamp et l’on ne théorise pas vraiment comme pour un Rirkrit Tiravanija. Pourtant les liens sont possibles.
Ce manque de référence et de questionnement intellectuel nuisent-ils à la qualité de cette œuvre ? Le projet ne figure pas sur le site de l’art public à Montréal est-ce parce qu’il n’est pas quotté dans le milieu « chic » de l’art art? En a-t-il quelque chose à faire d’être reconnu par ce milieu?
Ma question serait donc la suivante : Est ce qu’une œuvre d’art contemporaine « plus classique » pourrait avoir la même efficacité auprès du public ?
Hadrien Rossier
—————————————————————————————————
Références :
L’arc de Michel De Broin par Sarah Booth
L’œuvre d’art publique de Michel De Broin se situe sur l’île Notre-Dame au Parc Jean-Drapeau, plus précisément dans les jardins Floralies. Créée en 2009, la sculpture intitulée L’arc est une commande publique de la ville de Montréal avec l’appui financier de l’Association des Chiliens du Québec. La sculpture est une simulation d’un arbre retournant à la terre, rappelant la forme d’un arche. La compagnie spécialiste de béton, Design M3béton inc., a construit cette œuvre à partir de béton ultra-haute performance et d’acier inoxidable. La combinaison des collaborateurs, des matériaux et des techniques mixtes, propose une oeuvre interdisciplinaire aussi en proposant un langage commun et un but commun; la commémoration d’une personnalité politique par le biais de l’art. L’analyse questionnera le lien œuvre/spectateur : comment la sculpture propose une sensation d’affiliation avec l’être humain. J’étudierai la question à l’aide de la notion de la simulation et de la pluridiciplinarité. Le tout sera appuyé par quelques notions de Jocelyne Lupien sur les théories de l’intelligibilité du monde par l’art.
À prime abord, la pluridisciplinarité est présente dans l’œuvre de De Brouin. Il est le créateur de l’œuvre mais des spécialistes du milieu du béton ultra-haute performance y ont contribuée grandement pour la confection. C’est donc grâce à cette pluridiscplinarité que la simulation proposée devient une réussite. Simuler un objet de notre savoir collectif stimule un affect, des souvenirs de cet objet même, donc un retour à sa propre existance et/ou à celle des autres. La texture, la forme, le format et la couleur offrent à voir un arbre qui semble réel. Le choix du format moyen, offre un paradigme d’affiliation par cette distance sociale entre l’œuvre et le spectateur. D’apres Lupien, les « styles perceptifs (tactil, postural, visuel etc.), par lesquels les œuvres sont modalisées, témoignent de la sensibilité non seulement d’un seul individu créateur mais de celle d’une société et d’une culture à une époque donnée ».(p.18) La posture de l’arbre inhabituellement recourbée, retournant à la terre telle une autruche, rend le spectateur conscient de sa propre posture et de sa propre réalité.
La nature polysensorielle de l’œuvre est plus forte grâce à sa caractéristique d’œuvre publique. Étant donné que L’arc est exposé dans un jardin, l’observateur se permet de toucher, de marcher à travers, de la sentir. D’après Charles Henri Piéron, psychologue, « les sensations thermiques et posturales posséderaient un potentiel affectifs de plaisir/déplaisir nettement plus intense que la vue et l’audition »(Lupien, 2004 :22). Le béton, matière conductible de chaleur, offre une caractéristique thermique et tactile chère à un potentiel affectif. « Lorsque l’art nous contraint de toucher, de palper et donc de nous investir tactilement, alors même que nous croyons toucher ce qui nous est étranger, c’est encore de nous-mêmes qu’il est question, sur notre propre présence au monde que nous sommes invités à réfléchir. »(Lupien, 2004 :28) La plaque informative décrit L’arc en tant que monument en mémoire d’un président Chilien et combattant des idées communistes, Salvador Allande.. Le lieu de l’exposition marque deux point de vue très important soit avec le point de vu du jardin (A), soit par le point de vu du casino(B), construction humaine, grandiose, politique, offrant la vue sur les drapeaux, qui fait lien avec l’ambiguité de l’œuvre d’art versus la politique. Est-ce une œuvre d’art actuelle ou un monument commémoratif dans un jardin? D’une manière ou d’une autre, on reconnaît que l’œuvre propose des symboles humanitaires grâce à l’implication de la communauté Chilienne de Montréal et de la représentation d’une idée de paix, par l’arche retournant à cette terre promise et par la représentation des paroles d’Allande sur la plaque informative : « l’histoire nous appartient et ce sont les peuples qui la font ».
En somme, l’œuvre offre un sentiment d’affiliation par ses nombreuses qualités spatiales, plastiques et iconographiques, le caractère multidisciplinaire, interdisciplinaire, les symboles utilisés et finalement par les informations offertes au lieu d’exposition. Cette sémiotique proposant un caractère humanitaire affirme plus fortement
cette affiliation à une certaine communauté, une société ou tout simplement à l’être humain. Peut-être même que la position de cet arbre nous met face à notre propre position de cette époque contemporaine face à la nature disparaissante; la tête dans le sable tel un autruche?
Bibliographie
– LUPIEN, Jocelyne. « L’intelligibilité du monde par l’art ». in Espaces perçus, territoires imagés en art. Caliandro, Stefania (dir.). Paris : Harmattan. 2004.
« Cycle humain » d’André Bécot par Valérie Côté
André Bécot est un artiste visuel né à Arthabaska, qui vit et travaille au Québec depuis 1972. Durant sa carrière, il a pris part à plusieurs événements artistiques, notamment au symposium de sculpture «Lachine, carrefour de l’art et de l’industrie», en 1985. Son œuvre, « Le cycle humain » (1985) est une représentation du type historique. Cependant, l’utilisation du ciment comme médium le confond au contexte urbain contemporain. C’est pourquoi elle fut exposée à l’entrée de la Bibliothèque municipale Saul-Bellow à Lachine. Cette œuvre d’André Bécot est interdisciplinaire, car elle est une illustration d’un mélange d’éléments et de références historiques et modernes qui nous mène à s’interroger sur sa représentation. De quelle manière le matériau et la notion historique dans « Le cycle humain » d’André Bécot rappellent la notion du temps? Nous étudierons et analyserons cette problématique à l’aide de notions de transversalité, d’appropriation et d’intégration, ainsi que de l’effet d’indécidabilité de l’oeuvre.
Le discours dans « Le cycle humain » à première vue est contradictoire. La transversalité se fait à travers la compréhension du contexte historique illustré par la représentation d’un énorme cadran solaire de l’époque Maya, face au matériau utilisé pour la création de l’œuvre. Au premier regard, la forme du cadran n’est pas évidente, car nous avons plus l’impression qu’il s’agit seulement de panneaux de ciment, devant supporter les bas reliefs représentant un jeune homme. La compréhension du mouvement du jeune homme à travers plusieurs étapes rapporte alors la notion du temps. Elles illustrent la naissance, l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse. Cette illustration du passage à travers le temps mène à l’hypothèse chez le spectateur qu’il s’agit d’un cadran solaire battant le temps dans la vie d’un être vivant. L’appropriation et l’intégration de cet objet mythique et historique est une grande référence au temps qui s’écoule. Chaque panneau indique un passage, une époque, une période de sa vie, dans le but de faire comprendre aux observateurs que cela se produit en boucle à travers les âges, même après leur passage sur cette terre. L’endroit choisi pour l’exposé au public amplifie l’éloignement de la pensée du spectateur sur la représentation du cadran solaire, car les bâtiments entourant l’œuvre sont tous fabriqués avec la même matière. Donc, le rappel du ciment comme matériel courant dans la construction moderne nous fait oublier la notion du temps durable. Cependant, qu’il s’agisse d’un terrain où se situe une bibliothèque apporte un nouvel aspect temporel, et engendre une prise de conscience: les écrits restent, mais les écrivains partent.
Bref, par l’usage de notions historiques, d’un mode de pensée contemporain et d’un matériel moderne, «Le cycle humain» (1985) d’André Bécot peut être qualifié d’œuvre interdisciplinaire, car les sources utilisées pour produire cette œuvre se répondent l’une envers l’autre a fin de créer un tout. L’art est utilisé comme stratégie de communication pour transmettre la notion du temps. Le discours contradictoire de l’œuvre face au lieu d’exposition amplifie et justifie l’utilisation du cadran solaire, pour que la compréhension première de l’œuvre soit visible.
Bibliographie:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page_pageid=678,1154687&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=284
http://lachine.ville.montreal.qc.ca/bibliotheque/quisommesnous.htm#cyclehumain
L’oiseau, Jardin Botanique – Jardins des arbustes, Par Karèle Bellavance
Désireux d’agrémenter la devanture du restaurant « Chez Vito », son propriétaire souhaite y aménager une sculpture de feuilles d’acier. Réalisée par Paul Borduas fils en 1961, cette œuvre s’inspire principalement des dessins de Vittorio, connu pour ses personnages du Festival Juste pour Rire. En 1965, monsieur Vito Vosilla, propriétaire, en fait don au Jardin botanique de Montréal.¹ Mêlée au paysage de verdure, l’œuvre L’Oiseau se retrouve dans le jardin des arbustes. L’interdisciplinarité de la sculpture suppose un dialogue entre le dessin publicitaire, voire caricatural et le métier de sculpteur de grand format, le tout dans son intégration à un jardin national. L’œuvre fait donc appel à plusieurs disciplines qui s’entremêlent pour ainsi créer une homogénéité. Par ses formes stylisées et soudures apparentes, en quoi l’œuvre de Paul Borduas L’Oiseau s’intègre davantage à son nouveau milieu naturel comparativement à sa localisation de départ, soit un commerce offrant des services alimentaires? C’est donc par le biais des notions de la création, de la diffusion et de la réception que je tenterai de répondre à la question.
Maintenant relocalisée dans l’un des plus grands jardins botaniques au monde, l’œuvre L’Oiseau est installée au milieu d’une grande surface de verdure entourée de spécimens de plantes arbustives. Derrière cette œuvre, l’artiste s’efface par l’absence de signature. Aucune plaque indiquant le médium ou l’année de création n’est d’autant plus visible et la facture utilisée n’est pas nécessairement propre à Paul Borduas. L’acier est le métal le plus facile à souder, mais il requiert tout de même un certain savoir-faire par une technique que l’on pourrait définir de général, soit l’utilisation d’un fil à souder pour relier deux extrémités de pièces d’acier. Dans le cas de l’œuvre L’Oiseau, l’artiste a utilisé un fil d’acier de gros calibre pour ainsi révéler des soudures apparentes, non soignées qui inspirent la texture. Paul Borduas s’inspire à la base d’un dessin caricaturale emprunté à Vittorio, il y a donc une transmédiation du dessin et de la technique de soudure vers la sculpture tridimensionnelle qui a pour effet de rendre un certain langage commun. L’installation extérieure emprunte alors plusieurs notions, soit celle du paysage urbain, la sculpture de grand format, le métier de soudeur, voir l’architecture fonctionnaliste où l’on y révèle la structure. L’artiste s’inspire alors d’une diversité disciplinaire et maîtrise alors plusieurs notions.
Lors de l’arrivée dans le Jardin des arbustes, il est difficile de ne pas remarquer cet oiseau de grandeur exagérée au regard curieux et prévenant. Pourtant, son grand format et ses matériaux lourds ne font pas tache au paysage. L’accessibilité y est alors différente. Située dans un parc national public, l’œuvre évoque l’aspect animal dans la nature. Il y a donc intégration du sujet dans son environnement respectif. Les feuilles d’acier soudées de façon apparente et peintes en noir se veulent textures. Ce matériau, de type industriel, fait contraste avec la floraison et le coloris des branches des rocailles et des clématites. En effet, ce contraste image bien la position de l’homme face à la nature, soit détruire pour construire. Les animaux ont aussi besoin d’un environnement qui leur est propre mais l’homme les supprime les uns après les autres pour élever des structures d’acier qui deviendront des commerces, des immeubles, des gratte-ciel, etc. La faune se retrouve alors « à la rue ».
La polysémie s’impose. Le sujet est donné et amplifié. En effet, l’oiseau est représenté de manière stylisée et son format y est exagéré pour ainsi rendre compte de la présence animale dans les parcs naturels. Si l’homme ne change pas son comportement, des parcs comme le Jardin Botanique, il y en aura plus. Il y aura donc de grosses conséquences dues au non-respect de la nature, car de prime abord c’est l’herbe qui nous fait respirer. Cette figure d’oiseau géant est présente pour rendre compte aux gens de l’importance de la conservation et du respect de la nature.
De prime abord, l’œuvre était considérée comme décoration ou ornement à la devanture d’un restaurant italien. Il est alors difficile de faire un lien entre l’animal volant et son lieu d’insertion initial. La figure du rat aurait sans doute été plus adéquate. Je m’explique, à travers les stéréotypes des cuisines mal entretenues, celles-ci ont souvent la visite de ces petits rongeurs. Le commerce aurait sans doute perdu ses clients, mais ceci est une problématique à discuter autre qu’ici. Il est donc évident que cette œuvre s’intègre davantage à son milieu actuel. L’oiseau butine les fleurs et chante dans les arbres. L’oiseau est méfiant et curieux. Petit être de nature maintenant représenté en grand format sur une étendue d’herbe infinie, profitant pleinement de son nouveau milieu. L’Oiseau de Paul Borduas est la nouvelle poésie du jardin des arbustes. Il apporte la présence animale que nous ne remarquons pas nécessairement en temps réel lors de nos promenades dans les parcs. Son accessibilité y est différente. Les visiteurs tournent autour, l’enfourchent et prennent des photographies, tandis que devant le restaurant, l’oeuvre devait plutôt être considérée comme statuette. Le Jardin botanique est donc un lieu d’insertion adéquat pour cette œuvre de feuilles d’acier. Je me demande maintenant si une girafe aurait eu le même effet…
Michel Goulet : Les leçons singulières (volet II) Par Dave Plourde
 Michel Goulet, Les leçons singulières (volet II) (détail avec observateur) 1991, acier inoxydable, bronze et laiton, Parc Lafontaine, Ville de Montréal (Photo : Dave Plourde)
Michel Goulet, Les leçons singulières (volet II) (détail avec observateur) 1991, acier inoxydable, bronze et laiton, Parc Lafontaine, Ville de Montréal (Photo : Dave Plourde)
Il y a, au parc Lafontaine, tout juste au bout de la rue Roi, une construction de pierres en forme de demi-lune qui fait office de belvédère. En plus d’offrir un joli point de vue sur le lac et les flâneurs, elle sert de socle pour une oeuvre de l’artiste Michel Goulet.
L’installation Les leçons singulières (volet II) réalisée en 1991, est composée de 6 chaises en acier inoxydable, disposée sur une courbe parallèle a la rampe du belvédère. Évidemment, celui ou celle qui s’y assoit fait face au parc. Chacune des chaises arbore le style simulé d’une chaise commune en bois, rencontrée dans les cuisines québécoises de l’ère industrielle. Sous chacune d’elles se trouve un objet différent, soit un journal, des souliers de course, un livre, un sac de papier, un ballon et une jumelle. Ces six représentations d’objets sont coulées en bronze dans des proportions réalistes. Derrière les chaises, on retrouve un élément en forme de table basse. Les quatre pieds sont formés de volumes géométriques en acier inoxydable. Le dessus de la table propose un bas relief représentant la topologie du parc et son périmètre. Cette carte tridimensionnelle est également coulée, mais cette fois-ci, en laiton.
Par cette proposition, Michel Goulet joue le rôle, à la fois, de l’urbaniste, de l’historien, du sociologue, voire même de l’anthropologue. L’oeuvre invite à ce qu’on la touche, qu’on s’y assoit et du coup, qu’on lui tourne le dos. De quelle manière ce contact physique avec l’œuvre, la possibilité de s’asseoir sur un de ses éléments, influence t-il l’interprétation qu’on fait d’elle? C’est par le biais des notions de la mise en abîme, de la simulation, et de l’indécidabilité que je tenterai de répondre à la question.
D’un premier abord, l’œuvre se présente à l’observateur tel un élément purement descriptif. Cette table, ce relief, nous présente le parc d’un point de vue strictement scientifique. On y aperçoit tous les détails physiques, même le belvédère, qui nous entraîne dans un sentiment de mise en abîme infini. Jusque-là : rien d’incohérent. Il est courant de retrouver, à un belvédère, une représentation de ce qu’on peut voir à l’horizon. Aussi, quoi de plus normal que de trouver des chaises pour s’asseoir et regarder le paysage. C’est par cette grande simulation du belvédère que Michel Goulet intègre son œuvre, sans déranger les acquis du passant. Le récepteur entre en contact avec l’œuvre en ayant l’impression d’être dans une zone fonctionnelle, informative. Après avoir pris connaissance de la carte en relief, le récepteur se déplace vers l’avant du belvédère afin de prendre un réel contact avec le paysage. Peut-être s’assoit-il sur une des six chaises, il fait contact avec la matière, il repère les objets sous les chaises, puis tout bascule. Il prend soudainement conscience du travail de l’artiste. Il se demande si la table fait partie de la proposition artistique, ou si elle appartient à la fonctionnalité du belvédère. Il est happé par un sentiment d’indécidabilité.[1] Les chaises aussi participent à l’indécidable. Par leur fonction usuelle, elles sont intégrées à l’œuvre tel un aménagement urbain. Leur représentation renvoie toutefois à un tout autre système de valeur. Car la chaise, telle que représentée, fait davantage référence à la cuisine, lieu de rencontre et d’échange. L’indécidable provoque un mécanisme d’échange entre l’œuvre et son environnement, entre art et non-art. Les objets sous les chaises sont en lien avec le parc. Ils sont tous des articles qu’on pourrait amener au parc. L’observateur, maintenant sur une des chaises, prend conscience qu’il fait entièrement partie de l’œuvre, tout comme le parc en fait partie. Ce passage, du relief à l’observateur, et de l’observateur au parc, accentue le sentiment de mise en abîme présent dans la proposition.
De toute évidence, le lieu est au centre de l’œuvre de Goulet. Ce lieu,présenté comme volume environnemental, mais aussi comme espace de vie et de rencontre. Les matériaux choisis pour cette production résisteront au passage du temps certes, mais ils garderont la trace du passage des individus qui s’y seront arrêtés. En intégrant l’observateur à son œuvre, Michel Goulet l’invite à prendre conscience de son rapport au lieu. De la place qu’il occupe, de son appartenance et du rôle qu’il tient dans sa communauté. Il semble que l’oeuvre exprime son sens entièrement et uniquement pour le marcheur qui s’y installe. L’observateur, maintenant assis confortablement sur une des chaises, tourne le dos à la table et son relief. L’artiste souhaite-t-il ainsi nous détourner de la représentation du lieu pour qu’enfin, notre concentration se porte, ultimement, vers le lieu en question?
[1] Uzel, Jean-Philippe, «Les objets trickter de l’art actuel», p.40-50 Tiré de : M. Fraser, J-P. Uzel, P. Loubier, J. Lupien, J. Lalonde, T. St-Gelais, V. Lavoie, sous la direction de T. ST-Gelais L’indécidable – The Undecidable Canada, Les éditions esse, 2008
Michel Goulet, Les leçons singulières. Par Ivan Mateus
Les leçons singulières est une œuvre fait par l’artiste Michel Goulet en 1990. Cette œuvre est composée de deux parties, leçons singulières I et II, qui se trouvent respectivement à la place Roy et sur le belvédère du Parc Lafontaine à Montréal. Elles se composent de sept chaises faites en bronze, en laiton et en béton, détournées à la place Roy et de six autres chaises avec les mêmes matériaux, mais accompagnées chacune d’un objet familier sur le belvédère du Parc Lafontaine. Elles évoquent directement la vie de quartier et l’environnement immédiat, générant ainsi un sentiment de présence ou d’absence de quelqu’un qui était là et a laissé une trace de son quotidien. Alors, à travers cette analyse d’œuvre, on va voir de quelle manière « Les leçons singulières » est capable de réfléchir sur les relations humaines qui se produisent dans les espaces communs, et cela, au point d’immortaliser les expériences en combinant la sculpture et son espace de diffusion, et en transmettant des notions comme l’identité, la pensée et la richesse du moment immédiat.
Premièrement, Il faut mentionner que Michel Goulet, un artiste conceptuel, prend les éléments les plus essentiels capables de définir une situation dans un lieu qui porte lui-même son contexte historique. Donc, les notions les plus influentes pour la création de «Les leçons singulières» sont en grande partie le résultat d’une étude sociale, où le principal collaborateur pour la réalisation de l’œuvre est le public qui, au quotidien, se déplace dans ses secteurs; le public devient clairement une source d’inspiration. Ainsi même, après avoir fait l’expérience de l’installation de chaises, ce même public devient aussi le déclencheur d’un dialogue entre l’œuvre et le récepteur. Le rôle de Michel Goulet est de percevoir l’essence de l’instant et de le traduire en une sculpture qui joue avec son espace de diffusion, pour obtenir ainsi un travail qui montre différents enjeux de l’originalité de l’œuvre qui sont questionnés par l’appropriation des situations, des espaces, des objets usuels qui sont intégrés, et un détournement se remarque dans les chaises de la place Roy, dont la recherche d’un but proprement conceptuel prime sur la fonctionnalité. Puis, avec l’appropriation d’un élément comme la chaise qui devient un motif de répétition dans cette œuvre, il faut percevoir le sens particulier que l’artiste veut montrer : On pourrait dire que chaque chaise peut correspondre à la réflexion d’une expérience unique qui encadre la vie à cet endroit-là. Mais, comme le lieu de diffusion est public, et que l’œuvre es concerne toutes les personnes, cela génère différentes lectures et cause ainsi différentes réactions et sensations; en un mot, « Les leçons singulières » est une œuvre Polysensorielle (référence de Joselyne Lupien). Par ailleurs, Michel Goulet présente son travail par la voie de la sculpture, où il met en valeur la mise en scène, mais, ce qu’il faut exalter, c’est le rôle des personnes devant un ouvrage comme celui-ci, devant un groupe de chaises qui ne sont pas faites pour s’asseoir tel que ceux qui se trouvent à la Place Roy, et, comprendre qu’à ce moment-là, quand il y a une approche inhabituel, le récepteur devient une part essentielle dans l’œuvre, provoquant ainsi que ces chaises soient plus qu’une simple sculpture en évoquant, d’une certain façon, la notion de «Ready Made». Comme mentionne Marie-Claude Lespérance dans son livre (L’art public à Montréal, P. 156) « les œuvres de Michel Goulet invitent le spectateur à pénétrer dans des lieux qui portent à la réflexion en regard d’un espace social. Il use de procédé du «rebus poétique», où se joue l’idée de la poésie du quotidien […] ». En effet, il y a un mélange de plusieurs disciplines derrière la sculpture, tels que le ready made, l’installation, et certainement la «performance quotidienne»; ce qui laisse voir l’interdisciplinarité de «Les leçons singulières» et son but de refléter et exalter la richesse de la vie habituelle. Tout cela s’obtient grâce à un processus de création basée sur l’affranchissement du métier, reflété dans la manière de travailler avec les chaises. Il faut mentionner le franchissement du musée dans la diffusion de l’œuvre, proprement basé dans le choix de l’espace pour placer la sculpture. Alors, voila pourquoi l’indécidabilité de ces chaises insérées dans l’espace public, clairement détournées et modifies de leur valeurs basiques, avec l’unique but de les mettre dans un autre contexte capable de montrer des notions plus abstraites et plus profondes tels que la richesse du moment immédiat.
Bibliographie :
- Jasmin, Stéphanie, «Portraits d’artistes, Michel Goulet, sculpteur», Éditions Varia, 2007.
- Déry, Louise, «Rêver le nouveau monde, Michel Goulet», Canada, 2008.
- Lespérance, Marie-Claude, «L’art public à Montréal», Éditions Logiques, Outremont, 2000
Michel Goulet, Les leçons singulières (volet II). Par Marie-Pier Paquette
Michel Goulet est un artiste reconnu pour ses œuvres publiques. Son œuvre Les leçons singulières (volet II), créée en 1990, se retrouve dans le Parc Lafontaine, en face de la rue Roy. Elle est réalisée à partir de laiton, de bronze et d’acier inoxydable. Cette œuvre fait partie de la collection de la Ville de Montréal. Le spectateur doit, pour comprendre l’œuvre in situ, faire partie intégrante de sa structure et de son environnement. Cela évoque l’idée d’interdisciplinarité dans l’œuvre, et par ce fait même, entraîne une réflexion sur cette dernière. De quelle manière Michel Goulet crée une mise en abîme du lieu dans lequel elle se trouve par les différents points de vue et objets que l’on retrouve dans l’œuvre Les leçons singulières (volet II)? L’analyse de la question se fera par l’explication d’un aspect et de deux notions importants dans l’œuvre : la simulation, la répétition et l’indécidable selon la théorie de Jean-Phillipe Uzel.
D’abord, la mise en abîme du lieu se fait, enter autres, par la notion de simulation. Cette dernière est créée par les objets que l’on retrouve sous les six chaises qui font parties de l’œuvre. Journaux, souliers, ballon de soccer, livre, sac en papier et jumelle sont des créations qui donnent l’illusion d’être réelles. Ces illusions, faites à partir de moulages coulés en bronze, ont un lien direct avec le lieu où l’œuvre est située. La représentation du parc, à travers les objets qui y sont associés, démontre la mise en abîme de ce lieu.
De plus, la mise en abîme se fait par la notion de la répétition. La répétition des ix chaises donne six points de vue différents. Ces chaises forment un demi-cercle. Au centre de cet espace se situe une autre mise en abîme du lieu. Surélevé par des formes cubiques et cylindriques, une sculpture évoque une vue aérienne du parc. La répétition des chaise et des points de vues crée une mise en abîme de la représentation du parc, sous forme de plan aérien.
La mise en abîme du lieu se fait également par l’aspect de l’indécidable tel que théorisé par Phillipe Uzel. La simulation des objets sous les chaises est en opposition avec l’impossibilité réelle de ces derniers, car ils sont fait de bronze. Cela amène l’ambiguïté dans l’œuvre. La vision du lieu es insaisissable puisqu’il y a de nombreux points de vue du parc lorsque l’on prend place sur les chaises. L’indécidable met l’emphase sur le lieu dans cette œuvre in situ. Par ce fait, l’indécidable met en abîme ce lieu.
Pour conclure, l’œuvre met en évidence l’interprétation du lieu. Les points de vue et objets différents mettent l’accent sur la vision personnelle du parc par la répétition. La simulation des objets met l’emphase sur ce que le spectateur aurait pu amener au parc. Ceci démontre l’idée des différences chez les spectateurs. L’indécidable amène l’impossibilité de n’avoir qu’un point de vue du lieu. De par cette œuvre, chacun peut faire sa propre vision de cet espace. Cette œuvre in situ met en abîme le lieu, mais pourrait-elle mettre en abîme le spectateur par la représentation de l’endroit où il se situe et par les objets qui lui évoque son quotidien?
Michel Goulet «Nulle-Part / Ailleurs» par Marie-Pierre Bernier
Photographie de Marie-Pierre Bernier
La promenade du Lac-des-Nations est un sentier de plaisance où citoyens et touristes, piétons et cyclistes sont conviés à profiter de la nature et de la culture au cœur de la ville de Sherbrooke. Des travaux d’aménagement et de prolongement du sentier ont été réalisés entre l’an 2000 et 2005, incluant un important aménagement paysager ainsi que l’installation de deux œuvres d’art publiques. L’une d’entre elles, Nulle-part / Ailleurs du sculpteur Michel Goulet, créée en collaboration avec l’auteur Luc LaRochelle, a d’abord été présentée au Musée des beaux-arts de Sherbrooke en 2002 avant d’être réinstallée aux abords du Lac-des-Nations. L’œuvre consiste en vingt chaises des plus uniques faites d’acier galvanisé peint en gris et dont les phrases poétiques de Luc LaRochelle sont découpées dans chaque siège. L’œuvre interdisciplinaire met donc en relation la sculpture, la littérature, l’environnement et la fonction usuelle. J’étudierai dans cette analyse, à travers les notions d’intégration, de répétition et d’indécidabilité, de quelle manière l’ « affranchissement du musée » joue un rôle sur la signification de l’œuvre Nulle-Part / Ailleurs de Michel Goulet.
L’intégration de chaises à une œuvre publique a son côté pratique. « Les promeneurs peuvent l’admirer, s’y reposer, faire un brin de lecture ou de causette .» Il y a d’ailleurs davantage de places disponibles que sur un banc de parc. Pourtant, un détournement est causé par la simple raison que les gens soient conscients qu’il s’agit là d’une œuvre d’art. Il manque un dossier à certaines chaises et des textes perforent les sièges. Ces éléments font en sorte d’altérer la perception des passants face aux chaises. Quoi qu’il en soit, Nulle-Part / Ailleurs n’a étonnamment jamais été l’objet de vandalisme, et cela est peut-être dû au fait que les jeunes, eux, reconnaissent avant tout son côté utilitaire.
La répétition de l’objet utilisé pour constituer l’œuvre crée un effet de rassemblement. Puisqu’on ne peut voir l’ensemble des chaises d’un seul coup d’œil, les visiteurs sont appelés à se déplacer entre elles, à lire les phrases inscrites dessus et à choisir le siège qu’ils désirent pour s’y asseoir et expérimenter l’oeuvre. L’image des chaises regroupées au même endroit, habitées par des gens qui regardent dans la même direction, vers le mont Orford, crée une mise en abîme. À travers les chaises, on devine une communauté, on y voit une salle de spectacle, une salle d’attente, une foule, quoi! Et chaque personne faisant partie de cette foule, chaque chaise a son individualité.
L’expérience de l’indécidabilité de Nulle-Part / Ailleurs s’explique par le fait qu’il y a « franchissement du musée » et par la perception de réalités contradictoires. D’abord, l’insertion de chaises dans un espace public gêne les gens et les rendent perplexes. Ils n’osent pas s’approprier l’oeuvre et préfèrent utiliser les bancs de la ville, alignés au bord du sentier, plutôt que les chaises de Michel Goulet, regroupées sur l’herbe, dos aux passants. Des chaises non utilisées représentent une anomalie dans un parc. Pourtant, le soir venu, des prostituées utilisent l’œuvre comme lieu de rencontre, qui se trouve tout près du centre-ville. Étrange qu’un lieu créé pour la détente devienne le milieu de travail de certains.
Bien que Nulle-Part / Ailleurs de Michel Goulet ait été installée au bord du Lac-des-Nations avec les meilleures intentions, il n’en demeure pas moins que son public modifie inconsciemment sa vocation. Même sans l’avoir anticipée, l’œuvre questionne la place des objets usuels dans les œuvres d’art publiques. Mais est-ce que les objets usuels exposés dans des institutions muséales, là où on ne peut absolument pas faire l’expérimentation de l’œuvre, ne remettent pas davantage en question leur rôle?
Le déjeuner sur l’herbe de Dominique Rolland par Patricia Asselin
L’artiste Dominique Rolland a créé une sculpture intitulée Le déjeuner sur l’herbe. Cette œuvre est fabriquée avec différents matériaux comme le granit, la pierre et le bronze et elle est exposée au Parc René-Lévesque à Lachine. Cette sculpture est à caractère interdisciplinaire car elle tisse des liens entre l’histoire de l’art, la sculpture, le land art et le théâtre.En regard de cette interdisciplinarité, l’œuvre peut suggérer la problématique suivante : comment l’œuvre Le déjeuner sur l’herbe, de Dominique Rolland propose-t-elle d’intégrer des gens ordinaires dans une œuvre célèbre? La question sera étudiée à l’aide des notions de citation, de transmédiatisation et de la diffusion de l’œuvre.
Premièrement, pour qu’il y ait l’intégration d’individus dans une œuvre célèbre, on doit en faire la citation. Pour ce faire, Dominique Rolland reprend un thème connu de l’histoire de l’art, dont l’artiste Édouard Manet en a peint un tableau célèbre en 1862. Par contre, Dominique Rolland met en valeur les composantes du repas au lieu des convives représentés dans l’œuvre de Manet. Les spectateurs prennent le rôle des personnages qui défilent à travers l’œuvre et qui deviennent par la même occasion partie intégrante du déjeuner sur l’herbe. Cette sculpture offre un contraste avec l’œuvre de Manet où l’artiste Dominique Rolland nous propose sa propre version du thème en instituant des ruptures esthétiques.
Deuxièmement, la transmédiatisation est présente dans l’œuvre car Dominique Rolland a transformé la peinture Le déjeuner sur l’herbe en sculpture. Il y a donc une adaptation d’une œuvre provenant d’un média à un autre média.[1] L’adaptation s’inspire plus librement de la thématique car seulement les éléments du repas apparaissent dans l’œuvre. Ces aspects permettent aux spectateurs de se promener à travers l’œuvre et d’en faire parti. De même, grâce à la sculpture, les spectateurs peuvent devenir les acteurs de ce repas champêtre, contrairement à une peinture qui ne permet pas d’intégrer de vrais individus au sein d’une œuvre.
Troisièmement, la diffusion de l’œuvre a permis le franchissement du musée. La sculpture de Dominique Rolland est exposée dans un parc, contrairement à la peinture Le déjeuner sur l’herbe d’Édouard Manet, qui est exposée dans un musée. En exposant la sculpture dans un lieu public, l’artiste permet aux passants de s’intégrer à l’œuvre. De même, en disposant les éléments de la sculpture dans un parc, Dominique Rolland exploite le lieu lui-même comme partie intégrante de l’œuvre. En effet, un musée n’aurait pas permis cette mise en scène, puisque «Le déjeuner sur l’herbe» est une scène qui se déroule à l’extérieur, où n’importe quel individu sans discrimination peut s’intégrer à une sculpture inspirée d’une œuvre célèbre.
Pour conclure, Dominique Rolland a voulu faire connaître au public «Le déjeuner sur l’herbe» en leur permettant de s’intégrer à l’œuvre, comme s’il s’agissait d’un jeu dans un parc. Par la même occasion, l’artiste a voulu faire redécouvrir le parc aux visiteurs, en le présentant comme partie intégrante de l’œuvre. Cette démarche nous permet de s’interroger sur la possibilité future de transformer des lieux publics en œuvre d’art.
[1] Référence : Sandra Dubé et Simon Brousseau, «Adaptation transmédiatique», NT2, le laboratoire de recherche sur les œuvres hypermédiatiques, 2008, nt2.uqam.ca, visité le12 octobre 2009.
Les leçons singulières (volet 1) par Guylaine Audette
«Le déjeuner sur l’herbe» de Dominique Rolland par Audrey Lahaie
Tenter de repousser les limites de l’art a toujours été au cœur des préoccupations d’une abondance de pratiques. Par contre, l’histoire de l’art compte plusieurs œuvres dont le contenu est repris d’artistes connus. Notamment, le sujet d’un repas champêtre qui figure dans les multiples Déjeuner sur l’herbe en sont une preuve significative. L’œuvre la plus connue est assurément celle d’Édouard Manet[1] qui suscita la controverse lors de son exposition au Salon des refusés, en 1863. S’ensuit une série d’artistes tels que Claude Monet, Tissot, Paul Cézanne, Picasso, Alain Jacquet, Anthony Caro et plusieurs autres[2] qui ont emprunté certains éléments du Déjeuner sur l’herbe de Claude Manet. Dominique Rolland, une artiste actuelle, traite également ce sujet à l’aide d’une œuvre sculpturale faite de granit, de pierre et de bronze exposée au Parc René-Lévesque à Montréal. Chacun des artistes mentionnés investissent le thème du déjeuner sur l’herbe avec leur propre interprétation. De quelle manière la reprise du sujet du déjeuner sur l’herbe déjà étudié par de multiples artistes influence la signification de l’œuvre de Dominique Rolland ? La question sera d’abord abordée du point de vue de la citation et de la transmédiation. Par la suite, l’idée du simulacre et d’appropriation de l’icône du pique-nique sera débattue pour finalement conclure avec la notion d’incidabilité participe de l’expérience de l’œuvre de Dominique Rolland.
A priori, la sculpture de Dominique Rolland est une citation de l’œuvre de Claude Manet ayant également pour titre Le déjeuner sur l’herbe. Dominique Rolland traite le thème de repas en plein air sans toutefois réinvestir la composition de l’œuvre initiale. En effet, le sujet du déjeuner figure dans l’œuvre avec plusieurs items de références au pique-nique, mais en excluant les personnages fondamentaux de la peinture de Manet. Dominique Rolland transfère l’espace pictural à un espace tridimensionnel ; cette transmédiation occasionne un changement de signification. L’emphase n’est pas mise «sur les convives, mais sur les composantes du repas […] à la manière des tableaux de natures mortes.»[3] Ainsi, l’oeuvre conserve l’atmosphère de détente initiale tout en laissant libre cours à diverses interprétations.
A posteriori, Le déjeuner sur l’herbe de Dominique Rolland implique la notion d’appropriation grâce aux objets iconiques du petit goûter champêtre. L’œuvre de Dominique Rolland est constituée des composantes du déjeuner extérieur typique tels qu’une assiette, un fromage, un pain, une serviette de table à carreaux, une bouteille de vin et son bouchon, auxquels s’ajoutent un soulier féminin, une balle et un chien. De plus, l’œuvre est un simulacre ludique de l’idée du pique-nique car les éléments de l’œuvre pris individuellement sont près de la réalité par leur texture et leur forme. Par contre, la matière utilisée n’est toutefois pas vraisemblable, d’autant plus que les éléments sont reproduits à des échelles toutes différentes, sans accord les uns aux autres.
Par ailleurs, l’œuvre de Dominique Rolland s’expérimente dans un lieu public, ce qui dote Le déjeuner sur l’herbe d’une expérience d’indécidabilité. Effectivement, le franchissement du cadre muséal pour que «l’objet s’immisce dans un contexte non préalablement cadré comme artistique»[4] a un impact sur la réception de l’œuvre. Dans le contexte du déjeuner sur l’herbe, il y a une rupture esthétique avec l’histoire de l’art du dix-neuvième siècle et un brouillage ludique de différents systèmes de valeur. Le prestige de la peinture, lorsque exposée dans une institution, est ici désamorcé par l’emplacement de l’œuvre. Dominique Rolland transporte le grand art dans un parc, ce qui la rend accessible à des spectateurs non avertis. Bien que le parc René-Lévesque soit un endroit où résident plusieurs œuvres publiques, bien peu de gens portent attention aux installations sculpturales. En effet, ce lieu est particulièrement fréquenté par des gens qui viennent s’y divertir qui ne portent guère plus attentions aux œuvres qu’aux autres composantes de l’environnement. Ainsi, le concept de repas dans un milieu naturel, aussi présent dans pratiquement toutes les œuvres le déjeuner sur l’herbe, est conservé, mais en lui investissant aussi un côté plus anonyme et accessible[5] : «L’œuvre in situ est donc volontairement faite sur mesure pour une situation précise qui intègre le rôle et la circulation du public, car c’est à ce dernier qu’il revient d’éprouver en fait de l’insituabilité de l’œuvre.»[6] En outre, le déjeuner sur l’herbe au départ provocateur est devenue plutôt ludique grâce aux différentes proportions des éléments constituants l’œuvre lui attribuant ainsi une notion de jeu.
Somme toute, le déjeuner sur l’herbe est un sujet qui ne cesse de croître et se disséminer[7]. À mon sens, Dominique Rolland remet en question la notoriété d’une œuvre renommée en lui soustrayant des éléments essentiels de la composition, ainsi qu’en lui octroyant un lieu de diffusion moins conventionnel. Diffuser une œuvre dans un lieu public amoindrit-il nécessairement sa valeur?
[1] Voir figure 3
[2] Voir figure 4 à 10
[3] ville de montréal, L’art public à Montréal
[4] LOUBIER, Patrice, « Embuscades et raccourcis. Formes de l’indécidable dans l’art d’intervention contemporain »
[5] Voir figure 2
[6] RODRIGUEZ, Véronique, «L’atelier et l’exposition, deux espaces en tension entre l’origine et la diffusion de l’œuvre»
[7] Voir figure 11-12
Simon Bouchard et Justin Lortie : Titre inconnu, par Sachiko Sumi
Le collectif d’artistes, formé de Simon Bouchard et de Justin Lortie, Vient à présenter, lors d’une tournée des Laurentides et de l’île de Montréal, un projet d’installation architecturale composé d’un trampoline de calibre olympique emboîté par un volume polygonal fait de silicone et de polyuréthane. Cette pièce, dont le titre n’est pas encore annoncé, réfléchit sur l’ironie qui entoure la sculpture du parc lorsque son rôle est détourné vers le dispositif urbaniste. Nous verrons comment l’ironie du détournement se présente au niveau du contexte de diffusion, de la matérialité et de la médiation du projet.
Tout d’abord, leur projet met l’accent sur les relations interdisciplinaires comprises dans la relation la sculpture avec son environnement. Leur dispositif recherche des caractéristiques architecturales précises: des voies de passage dont le flux est détourné par un muret, une clôture ou une dénivellation quelconque. Pour pallier à ces irritants, les gens sont invités à bondir sur la sculpture, les propulsant rapidement au-delà de leur blocage, si toutefois leur capacité physique le permet. Ce système donne lieu à quelques ratés que nous pourrions interpréter comme une revanche de la sculpture de parc utilisant l’interaction l’ayant elle-même contrainte à un formalisme évacuant tout détail susceptible de ne pas résister aux intempéries ou encore aux assauts d’enfants téméraires.
À première vue, rien ne laisse supposer une telle interaction; la sculpture semble avoir été taillée dans un seul bloc, son volume polygonal imite plusieurs sculptures publiques faites de béton ou d’acier de type « char d’assaut ». C’est lors du contact tactile avec la pièce que les matériaux dévoilent une masse constituée de mousse de polyuréthane soutenue par une armature de PVC, le tout recouvert d’une membrane de silicone blanche. Sous le poids d’un individu, la masse géométrique s’étire, se courbe pour reprendre sa forme après avoir évacué l’utilisateur sous un agréable son de flop. Ses matériaux, principalement utilisés par l’industrie du moulage, ce qui laisse induire une possible production sérielle, auraient été choisis principalement pour leurs caractéristiques mécaniques: élasticité, résistance, durabilité, entretien, etc., faisant du dispositif un objet sécuritaire.
Dernièrement, l’approche médiatique choisie par les artistes, la tournée, ironise la relation qu’aurait le public avec une oeuvre de type participative. N’ayant pas annoncé leurs escales, ce qui élimine la présence volontaire d’un public cible, les artistes installent leur dispositif à des endroits prédéterminés, le documentent, pour ensuite plier bagage et partir en vitesse vers un nouveau lieu d’exposition. Impossible pour le public de prendre la moindre photo, toute la documentation, photo, vidéo et textuel reste sous le contrôle des artistes. De même, dans la vidéo nous pouvons remarquer que les seuls utilisateurs de l’objet sont en fait les artistes eux-mêmes, ce qui élimine toute utilisation possiblement incorrecte du système, critique de la notion de hasard, présent dans plusieurs oeuvres participatives. À la fin de la tournée, le projet, détruit, ne vit qu’à travers sa documentation.
Finalement, en détournant les codes de la sculpture de parc, les artistes remettent en question la place de l’art au sein d’un public élargi. Cependant, en instaurant un contrôle médiatique, privant ce public d’une certaine expérience de l’oeuvre, pouvons-nous toujours parler d’art public ?
Pascal Audet : Hommage aux forces vitales du Québec
C’est dans le parc des Rapides à ville LaSalle que l’on peut voir l’œuvre de Georges Dyens nommée « Hommage aux forces vitales du Québec ». Cette sculpture principalement faite d’acier et béton intègre également des hologrammes. L’œuvre date de 1987 et représente selon l’artiste « l’énergie vitale du peuple québécois [1]».
Par l’intégration des hologrammes et des lumières aux structures d’acier, l’œuvre de Dyens dénote un caractère interdisciplinaire. D’une part, le travail du métal et du béton demande une façon de faire se rapprochant des techniques de sculptures traditionnelles et d’autre part par l’ajout d’hologrammes demande une maîtrise des nouvelles technologies numériques. L’artiste nous prouve qu’il sait tirer partie de différentes disciplines. Car le mariage des disciplines est fait dans l’harmonie totale.
La sculpture de Dyens est constituée de plusieurs fragments semblant tous provenir de l’éclatement d’un bloc central de l’intérieur duquel sont projetés des hologrammes. Les blocs sont disposés au sol à des distances variables du bloc central et selon des trajectoires correspondantes aux régions du Québec[2]. Chacun des blocs a une forme différente, mais quelque peu similaire aux autres blocs du groupe. L’œuvre est installée dans un parc à proximité d’arbres sur un terrain plat et non loin d’une rivière. On peut se demander de quelle manière les formes des éléments de cette œuvre peuvent évoquer les forces vitales du peuple québécois. Je vais analyser l’œuvre selon les aspects de la création de la diffusion et de la réception.
Comment l’assemblage et la disposition sur le terrain de ces blocs monolithiques d’acier chromés peuvent-ils évoquer chez le spectateur les forces vitales du Québec ? Pour débuter l’analyse, prenons l’aspect de la création de l’œuvre. Les éléments de l’œuvre par leurs formes et leurs dimensions donnent tous les indications d’une fabrication nécessitant des efforts et une volonté de manier et de transformer des matériaux robustes pour les façonner à la guise du sculpteur. Par le fait même, voici déjà une évocation claire de la force. Les pièces doivent non seulement être soudée, mais aussi travaillées pour obtenir ces aspects bruts et éméchés que l’on peut observer le long des certaines arêtes des blocs. On imagine une équipe de travailleurs venant en aide au sculpteur afin de déplacer ces énormes pièces dans l’atelier, une quantité remarquable de force est exigée pour accomplir ce genre de tâche. Mais dans la fabrication de l’œuvre, il y a également la production de ces hologrammes qui complète d’une manière plus technologique l’ensemble de l’œuvre. La production d’hologrammes demande la connaissance des technologies informatiques. Des lasers sont utilisés dans la fabrication de ces hologrammes et l’artiste a travaillé avec des spécialistes de cette technologie. Cette partie de l’œuvre peux évoquer l’aspect vital, car la maîtrise des technologies demande un certain acharnement qui est une qualité vitale dans notre monde moderne. L’adjonction des blocs et des hologrammes dans l’œuvre fait appel à différentes forces chez le sculpteur. Il doit avoir à la fois une maîtrise des fonctionnalités plus mathématiques pour la création des hologrammes et plus physique pour les blocs d’acier.
Une fois l’œuvre terminée il faut la transporter et l’installer. Le caractère monumental de l’œuvre ne lui permet pas d’être aisément déménagée. Sa diffusion sera alors limitée à l’emplacement désigné pour recevoir l’œuvre. Et les spectateurs devront se déplacer sur ces lieux afin d’apprécier l’œuvre. Dans le cas d’« Hommage aux forces vitales du Québec », le lieu de diffusion est un parc public près d’une étendue d’eau. Le spectateur qui établit un contact avec l’œuvre peut se rendre compte qu’elle s’intègre admirablement dans le paysage. Selon la saison, les blocs peuvent se confondre avec les morceaux de glaces de la rivière située non loin du site. Les blocs peuvent alors nous rappeler les vestiges de la débâcle printanière et la force de l’eau.
Je crois que l’œuvre de Dyens remplie ses promesses pas l’évocation des forces vitales en utilisant des métaphores entre la force de la nature et la détermination de l’homme à maîtriser les éléments pour arriver à ses fins, en réalisant des constructions qui au moyen de la force physique et de ces connaissances. La force du peuple se reflète par la diversité de l’œuvre et par son caractère interdisciplinaire.
[1]http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154690&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=558
[2] http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=678,1154690&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=558
Révolutions de Michel de Broin, par Majorie Paré
Tout près de l’édicule de métro de la station Papineau se trouve une œuvre publique. Cette sculpture de Michel de Broin a été installée en 2003. Révolutions prend la forme d’un escalier emmêlé. À travers cette sculpture d’aluminium de 500 cm de hauteur par 500 cm de largeur par 850 cm de profondeur, l’interdisciplinarité se fait voir dans l’agencement des notions sculpturales aux concepts d’architecture. Dans ce texte, j’explorerai comment cette œuvre d’art public s’intègre à son lieu d’exposition du point de vue de la création, de la diffusion et de la réception.
D’abord, la création de l’œuvre a nécessité plusieurs collaborateurs. L’artiste a eu recours, entre autres pour les plans de la sculpture, à un ingénieur et un spécialiste en géométrie. Pour la réalisation, il a fait appel à un travailleur du métal et pour l’installation, à un excavateur. Cette œuvre est par conséquent pluridisciplinaire. Elle lie la compétence de plusieurs personnes ressources pour la conceptualisation et pour la réalisation. L’agencement d’escaliers recourbés forme un nœud de trèfle, une sorte de courbe sans fin, tournée sur elle-même. La forme même de l’escalier renvoie à l’architecture. Cet élément architectural est très présent à Montréal. Les escaliers de fer forgé en colimaçon sont même une caractéristique identitaire de la ville. C’est pourquoi la sculpture s’intègre bien à son environnement : elle reprend un élément formel du paysage urbain. De Broin intègre un objet usuel en changeant sa fonction première. Il y a donc détournement puisque l’escalier ici ne mène nulle part. Formé en nœud de trèfle, l’escalier monte et redescend dans un circuit qui ne s’arrête jamais. De plus, le matériau utilisé, l’aluminium, se retrouve presque partout dans l’environnement montréalais. C’est un matériau industriel commun.
Ensuite, le lieu de diffusion de l’œuvre Révolutions influence l’interprétation de l’œuvre. Cette sculpture est située à quelques mètres de l’édicule du métro Papineau, dans un petit parc nommé Maisonneuve-Cartier de l’arrondissement Ville-Marie. L’œuvre fait référence aux éléments du lieu qui l’entoure. Les escaliers roulants fonctionnant à l’intérieur du métro forment une sorte de loupe qui se déroule continuellement. Le fait que la sculpture soit exposée à côté de ce lieu de déplacement qui est le métro peut exprimer la circulation continuelle. Tantôt sur la terre ferme, tantôt dans les sous-terrains, les gens se déplacent dans un mouvement qui se fait et se refait encore.
Du côté de la réception, le spectateur est invité à regarder la sculpture et à la contempler. Il est porté à vouloir explorer et vivre physiquement l’œuvre puisque celle-ci est à échelle humaine. Les escaliers sont de mêmes dimensions que ceux retrouvés sur les maisons montréalaises ce qui appelle d’autant plus le spectateur à expérimenter l’œuvre. Par contre, l’escalier se trouve impraticable par sa forme en noeud.
Enfin, cette œuvre de Michel de Broin intègre les éléments de son lieu d’exposition pour mieux interroger le spectateur à propos de sa signification. Cette sculpture publique peut représenter un certain emmêlement dans le cheminement d’un individu. Les escaliers qui montent et qui descendent peuvent évoquer les bons ou les mauvais moments dans l’évolution d’une personne. Ce nœud de trèfle est comme un engrenage des événements de la vie. Ce qui monte fini par redescendre pour ensuite recommencer le processus d’élévation. Dans le but d’atteindre un peu mieux le public, c’est à se demander si l’œuvre ne gagnerait pas à être installée à la hauteur du sol pour que le public puisse l’expérimenter réellement.

Michel de Broin, photographie du site web http://www.micheldebroin.org/
Continuum 2009 par Julie Grégoire
Photo de Julie Grégoire prise d’une photo d’une affiche située au Centre d’information du Parc Bellerive
L’oeuvre sculpturale décrite ci-dessous s’intitule Continuum 2009 et sera accessible au public (on ne peut la voir présentement) de façon permanente à partir de l’automne 2009 au Parc Bellerive. Le matériau de fabrication est l’acier corten dont le fini est d’une couleur roussie. L’oeuvre est conçue comme un cadre de grande dimension (7,7mX 3mX 3,05m) avec un espace central libre. Elle fut réalisée par Roland Poulin à la mémoire de Pierre Perrault, grand poète et cinéastre québécois. Comment peut-on définir la relation de la présence de Continuum par rapport au contexte géographique (physique et humain) dans le protocole de réception? Les notions de déverrouillage sensoriel, d’adaptation transdisciplinaire et d’environnement générique sont dans ce cas-ci inter reliés.
La démarche in situ fut de rendre indissociables l’oeuvre et le fleuve St-Laurent qui est à proximité. L’aspect « Land art » se concrétise par la voie fluviale, la nature, l’environnement humain et géographique et par la respiration du « grand air ». À ce niveau il y a un déverrouillage sensoriel par le fait que l’oeuvre se trouve dehors. Ainsi conçue, l’oeuvre permet de « cadrer » le fleuve et le paysage humain qui défile devant nos yeux comme au cinéma… Pour réaliser son oeuvre, il fallut que Poulain se réfère aux recherches de Pierre Perrault sur «le visage humain d’un fleuve sans bon sens». Roland Poulin fit référence plus précisément aux « Voitures d’eau » (long métrage fait à Ile-aux-coudres, de 110 min. 33 sec., 1968) portant sur la rencontre des constructeurs/navigateurs de goélettes de bois face aux navires de fer: un monde en déclin où la technologie renverse tout. Par l’oeuvre Continuum 2009 , on en fait une invitation à redonner à la culture québécoise son histoire à travers une « fenêtre », le contraire d’une oeillère. Cette adaptation transdisciplinaire du film de Perrault touche à la perception qu’a une communauté d’elle-même. On s’approche ainsi de l’imaginaire d’un peuple, de son territoire, de sa langue, de sa vie, de ses sensations, c’est-à-dire qu’il y a un usage générique de l’environnement et du sens collectif. On s’emmitoufle d’un contexte comme d’un objet au coeur de l’oeuvre. En effet, il s’établit un lien physique avec Continuum: on peut soi-même se mettre en scène en s’assoyant sur le cadre de l’oeuvre: une appropriation du corps présent qui fait référence à des personnages de cinéma, s’incarnant à travers le médium de la sculpture in situ. Cet hommage est, du point de vue de la forme physique de la sculpture, plutôt moderne. C’est dire que le modernisme s’exerce toujours ici à une époque postmoderne. Mais justement, l’absolu nouveau n’est plus un critère, la réalité présentée n’est pas utopique, il y a une relation directe qui s’effectue entre l’art et la vie. Aussi, ce en quoi cette sculpture n’est pas uniquement moderne, c’est qu’elle ne discalifie pas le passé pour avantager le futur.
En conclusion et pour tenter de répondre à la problématique: par la mise en contact visuel à notre environnement, et même si la sculpture était absente, n’y a-t-il pas de toute façon un engagement social? est-ce que finalement elle est pratiquement un prétexte à parler du vécu des gens d’ici? Et bien en guise de réponse, une citation: comme le disait Bourriaud: «les lieux de convivialité, l’ensemble des modes de rencontre et de l’invention des relations, représentent aujourd’hui des objets esthétiques susceptibles d’être étudiés en tant que tel, allant au-delà de la simple consommation esthétique». Le présent projet anthropologique nous convoque à prendre part à ce que le présent nous donne, pour renforcir, ajouter ou modifier notre rapport sensible au monde, dans un lieu convivial.
NB: la sculpture n’était pas encore installée lorsque j’ai voulu la voir, mais j’ai visité le site avec grand intérêt et de façon minutieuse.
Yves Trudeau: Le Phare du Cosmos par Jacinthe Chevalier
C’est sur l’île Sainte-Hélène, au parc Jean Drapeau ici à Montréal, que l’on peut encore observer l’œuvre du sculpteur Yves Trudeau intitulée Le Phare du Cosmos. Il s’agit d’une sculpture en acier de couleur bleue s’apparentant à une forme de robot : elle se compose d’une tête, d’un tronc et de pattes. Spécialement conçue pour l’Expo 67, la pièce est non seulement une sculpture, mais a aussi été une forme mouvante et sonore avant qu’on procède à sa « remise en état » il y a quelques années. Cette dernière procédure nous intéresse particulièrement. Comment la restauration de l’oeuvre Le phare du cosmos, faite en 1991, va à l’encontre de l’intégrité de la sculpture initiale et de son interdisciplinarité? Pour répondre à cette question nous étudierons cette interdisciplinarité mais aussi quelques notions de représentation, soit la simulation et l’appropriation et nous finirons avec l’aspect de diffusion de l’œuvre.
Tout d’abord, on peut parler d’interdisciplinarité dans l’œuvre si on regarde la sculpture comme une machine construite à la manière d’une structure de pont ou de d’autres structures importantes d’acier. La structure conçue pour être mobile, avec ses mouvements du tronc et de la tête, peut nous rappeler facilement certains appareils de machinerie lourde en plein travaux. En ce sens, l’œuvre de Trudeau offre une combinaison de la sculpture associée avec le mouvement et le son. Le mécanisme demande des connaissances autres que seulement artistiques pour permettre les mouvements du tronc et de la tête du personnage ainsi que pour les sons sortant de petites boîtes situées à la base de la pièce.
On peut parler également de simulation du robot. Celui-ci est construit pour bouger à l’aide d’un système de rotation au niveau de la tête et du tronc. Il se fait également entendre par des sons appelés « bruits cosmiques ». Malgré ces quelques caractéristiques de robot, nous savons qu’il n’en est pas un mais qu’il s’agit bien d’une sculpture représentant le robot. Par ailleurs, on ne peut pas dire que ce gros jouet au visage sympathique n’est pas tout à fait un robot non plus. Il serait vrai de dire alors qu’il y a appropriation du robot, qui adopte plusieurs positions différente dans le temps. Ses rotations s’approprient de la mécanique. On voit aussi dans sa construction et sa structure, une certaine similitude avec le pont Jacques Cartier, situé à proximité.
Enfin, l’œuvre étant dans un parc, nous sortons des portes du musée pour diffuser l’art dans l’environnement dont il fait partie. Cependant, le milieu dans lequel l’œuvre a été imaginée et son époque propre sont aujourd’hui très différents. Autrefois, elle se fondait dans l’univers innovateur de l’Expo ‘67, aujourd’hui elle se trouve dans le parc, entourée de la nature, loin de ce monde effervescent des années ‘60. L’œuvre n’est donc qu’une trace, un souvenir, de cet évènement du passé. De plus, avec ce mode de diffusion, l’artiste n’a pas vraiment d’emprise sur ce que peut subir son œuvre au fil du temps : vandalisme par les gens, usure par la température, rouille, peinture…
L’œuvre, bien qu’elle représente néanmoins encore une image de robot, n’est plus entière. Plusieurs composantes qui constituaient son interdisciplinarité sont aujourd’hui manquantes. En effet, depuis la restauration de la pièce en 1991, les parties constituant l’œuvre sont soudées mettant fin au mouvement que nous avons traité plus tôt. Le système permettant la partie sonore est lui aussi hors d’usage maintenant. C’est pourquoi il est possible d’affirmer que la restauration de l’oeuvre Le phare du cosmos, va bel et bien à l’encontre de l’intégrité de la sculpture initiale et de son interdisciplinarité tels qu’imaginée par Yves Trudeau en 1967. Nous pouvons même aller jusqu’à se questionner sur l’importance de conserver cette sculpture dont le sens est grandement affecté par l’époque et dont plusieurs composantes importantes sont, de toute façon, retirées.
Linda Covit : Caesura par Maude Godbout
Pour réaliser cette analyse d’œuvre publique, j’ai choisi l’installation de Linda Covit Caesura, qui est située au Parc Jarry. Malheureusement, l’œuvre est présentement en restauration. Je ferai donc cette analyse en me basant sur les souvenirs que je garde de cette œuvre que j’ai pu admirer il y a quelques mois. Cette installation de Covit, composée d’acier inoxydable, de granit, de laiton, intègre divers éléments, comme la commémoration, qui dévoile la particularité interdisciplinaire de l’œuvre. Il serait intéressant au cours de cette analyse, de voir de quelle manière la démarche entreprise par le Comité régional intersyndical de Montréal, avant la production de Caesura, joue sur la réception de l’œuvre auprès du public. J’étudierai l’installation de Covit sous les aspects de création et de diffusion, et je me référai également à la notion d’intégration.
D’abord, il est important et intéressant de connaître la démarche, le processus de création d’une œuvre contemporaine et plus particulièrement dans le cas de Caesura de l’artiste Linda Covit. Ce qu’il faut savoir à la base, c’est qu’en 1988, « dans un geste symbolique, les enfants de la région de Montréal se départissent de quelque 12 700 jouets de guerre »1. Ces jouets sont tous collectionnés par le Comité régional intersyndical de Montréal qui les remet par la suite à la Ville de Montréal. Puis, par la suite, le Conseil de la Sculpture et le collectif Pacijou lancent l’idée d’utiliser ces 12 700 jouets de guerre pour la production d’une œuvre d’art publique ayant pour thématique la paix.
L’idée originale, la contrainte de l’intégration de ces objets usuels dans l’œuvre ne sont pas de l’intention de Covit. Un appel de dossiers est organisé et on attend des propositions d’œuvres d’art public qui intègre la contrainte d’une manière brillante.
De plus, si un spectateur, un public initié, n’avait pas accès à cette information majeure du processus de création de Caesura, il n’en ferait sûrement par la même interprétation. Quand je me suis retrouvée pour la première fois au Parc Jarry, face à l’installation de Covit, l’ouverture créée par les deux parois d’acier m’a surtout fait pensé à une brèche, à une rupture entre deux époques, ou deux mondes. L’intégration d’objets usuels, des jouets de guerre, aurait pu me faire réfléchir sur le passage de l’enfance à l’adolescence. La violence s’imposait de façon évidente par la nature des jouets. On peut sentir un déchirement, même dans le titre de l’œuvre (Caesura réfère à une interruption dans plusieurs langues2). Toutefois, sans connaître la démarche entreprise en 1988, je pouvais facilement, comme n’importe quel spectateur, passer à côté du sens premier que devait avoir l’œuvre de Linda Covit, soit un travail dédié à la paix.
Ensuite, dans un autre ordre d’idées, le fait que Caesura soit une œuvre d’art publique, installée dans un parc aussi fréquenté que le Parc Jarry, n’est pas banal. L’espace de diffusion de l’œuvre publique est accessible à tous. On n’est pas forcé d’entrer dans un espace fermé, comme le musée pour en faire l’expérience, pour en faire l’observation. Le musée aseptise souvent l’œuvre. Toutefois, il ne faut pas oublier que des milliers d’enfants ont contribué, sans le savoir à l’origine, à la création de cette installation. Ils se sont départis de leurs jouets de guerre. Linda Covit, les a coulé et les a intégré à son œuvre. Une œuvre produite (en partie) par le public se doit, enfin je crois, d’être diffusée publiquement, au dehors des murs de l’institution.
Le cadre d’un parc se trouve également approprié puisque les gens s’y retrouvent principalement, surtout les enfants pour le divertissement, le jeu. Non pas que Caesura soit une œuvre d’art au sujet futile, mais plutôt qu’elle peut interpeller le spectateur sur sa propre place à prendre dans le monde, sur son propre jugement moral. Linda Covit dédie cette œuvre à la paix, mais également à « Aung San Suu Kyi (Prix Nobel de la paix en 1991) et à tous ceux et celles qui sont engagés dans la poursuite de la paix.»3. L’artiste intègre ici un caractère interdisciplinaire à son installation. Elle traduit la sculpture commémorative et traditionnelle, en une installation contemporaine.
En somme, Linda Covit a travaillé son installation à partir d’objets à intégrer et d’une thématique imposée par la Ville de Montréal. Une démarche était déjà pré-établie. Si le spectateur n’en est pas informé, sa réception ou son interprétation peut diverger légèrement. Toutefois, l’espace de diffusion, en l’occurrence le Parc Jarry, vient préciser la signification. L’installation, avec ses deux parois d’acier, dans ce lieu dirige le public davantage vers une opposition entre le jeu et la guerre. Il serait intéressant de voir comment d’autres artistes, ceux qui ont déposé un dossier, auraient intégrés les jouets de guerre pour le même projet d’œuvre d’art public.
Révolutions de Michel de Broin par Myriam Sylvestre
Dès le début du 19e siècle, la première œuvre d’art public faisait son apparition dans le paysage montréalais, devenant ainsi le pilier d’une riche collection qui allait s’agrandir au fil des ans. Ainsi, en 2003, par le biais d’un concours organisé par la ville, cette collection accueillait parmi ses rangs une œuvre de Michel de Broin intitulée Révolutions. Installée au Parc Maisonneuve-Cartier, qui jouxte le métro Papineau, cette sculpture d’aluminium, de huit mètres de haut, possède un caractère interdisciplinaire de par son installation en un lieu public. De plus, elle semble autant appartenir au milieu de l’architecture qu’à celui des arts visuels. Tout ceci m’amène à me demander : de quelle manière la notion d’architecture est-elle traitée dans l’œuvre Révolutions de Michel de Broin? Cette question sera étudiée sous deux aspects : ceux de l’intégration et de la mise en abîme.
Tout d’abord, l’un des éléments primordiaux de Révolutions est certes l’intégration d’un élément d’architecture à sa composition, soit, celui d’escaliers. En fait, il serait même possible de parler de simulation car, si ce n’eut été de leur forme, les escaliers créés par Michel de Broin auraient été très similaires à ceux empruntés tous les jours par le spectateur. Cet effet a pu être réalisé grâce au partenariat avec de nombreux collaborateurs, tels des ingénieurs, qui ont enrichi le projet de leur savoir-faire technique. L’emploi d’un matériel davantage industriel confirme d’ailleurs l’appartenance de l’œuvre au monde de l’architecture. Un détournement de la signification des escaliers est cependant présent au sein de l’œuvre, et ce, en raison de leur mise en espace en forme de nœud de trèfle qui détourne la fonction d’origine de cet élément. Ce détournement a été réalisé grâce à la répétition de la marche et de la contremarche, créant l’illusion que l’escalier se poursuit à l’infini en défiant la gravité. De cette façon, la fonction première des escaliers étant usuelle en permettant d’accéder à un autre niveau, Michel de Broin la brouille, car ses escaliers ne permettent pas l’accessibilité dans leur forme actuelle. Le spectateur ne peut ainsi tout simplement pas expérimenter physiquement cette configuration de l’œuvre. Il ne peut que s’y projeter mentalement et y découvrir ce cycle qui escamote toutes références au sommet et à la base des escaliers. De surcroît, une mise en abîme semble présente au sein de l’œuvre, car cette dernière semble parler du lieu dans lequel elle s’imprègne. Révolutions fait écho à de nombreux éléments du paysage urbain qui l’entoure. Outre la référence explicite aux escaliers en colimaçon montréalais des habitations, son architecture de type industriel rappelle la proximité du Pont Jacques-Cartier, tandis que sa forme convie au même jeu que les montagnes russes de La Ronde situées sous ce pont.
En conclusion, l’œuvre Révolutions de Michel de Broin nous parle de la ville dans laquelle elle s’enracine, en raison de l’architecture de ses escaliers, tout en s’en détachant, grâce à sa forme inaccoutumée. Elle semble ainsi nous rappeler la beauté et la poésie de ces paysages urbains qui sont trop souvent oubliés par les montréalais par trop d’habitude. À la lumière de cette analyse, une question reste cependant en suspens : comment notre lecture de l’œuvre serait-elle modifiée si cette sculpture se trouvait exposée à l’intérieur d’un musée à l’étranger, plutôt que dans un espace public extérieur de Montréal?